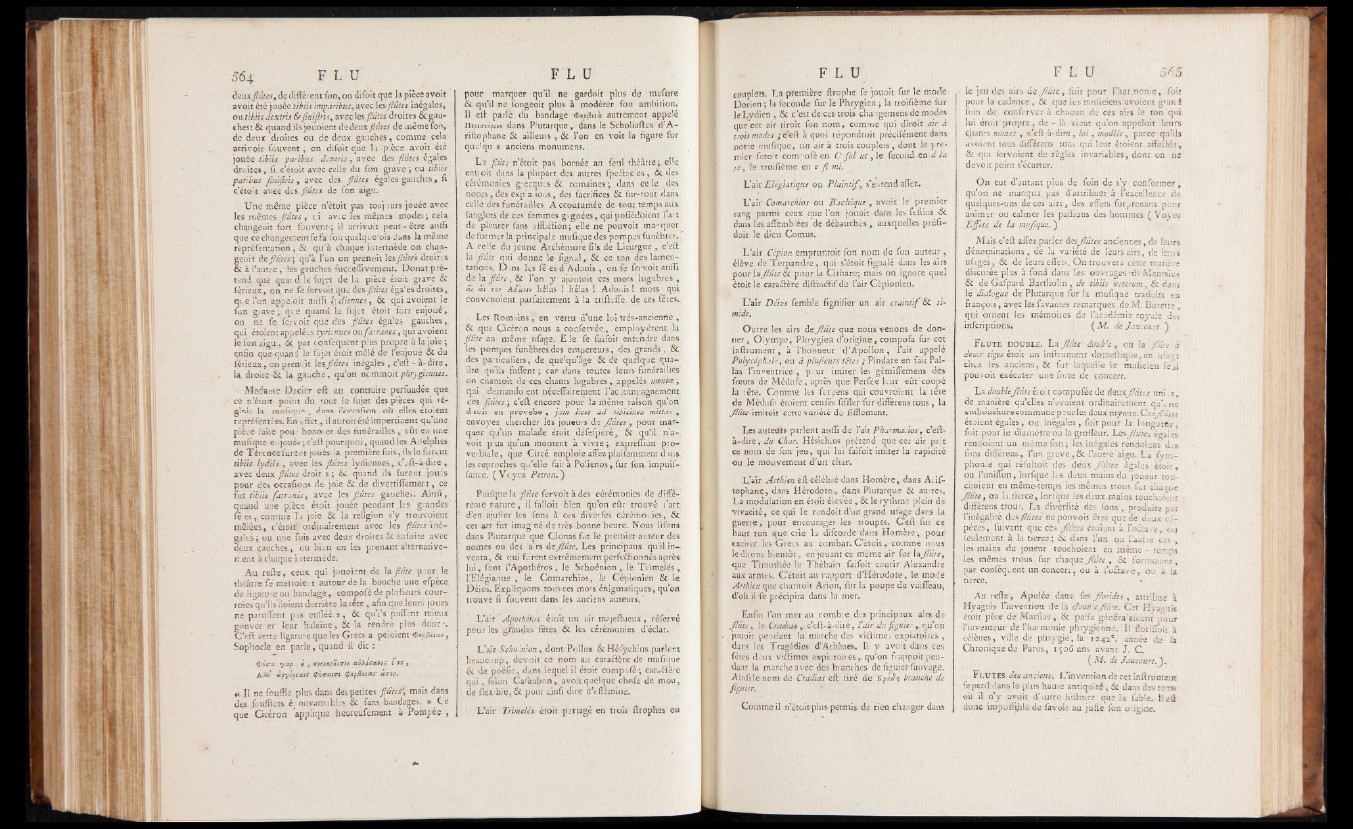
5 6 4 F L U
deux flûtes y de différent fon, on difoit que la pièce avoit
avpit été jouée tibiis ïmparibus, avec les flûtes inégales,
ou tibiis dextris&fini fins, avec les flûtes droites & gauches:
& quand ils jouoient dedeuxjf/h« de même fon,
de deux droites ou de deux gauches, comme cela
arrivoit fouvent, on difoit que la pièce avoit eié
jouée tibiis panbus dextris, avec des flûtes égales
droites , fi c’étoit avec celle du fon grave ; ou tibiis
panbus finiflris, avec des flûtes égales gauches, fi
c’étoit avec des. flûtes- de fon aigu.
Une même pièce n’étoit pas touj mrs jouée avec
les mêmes flûtes, r.i avec les mêpies modes; cela
changeoit fort fouvent-; il arrivoit peut - être aufli
que ce changement fe fa;foiiquelquefois dans la même
repréfentation , & qu’ à chaque intermède on changeoit
de flûtes', qu’à l’un on prenoit les flûtes droites
& à l’autre , les gauches fucceffiventent. Donat prétend
que quand le fujet de la pièce étoit grave &
férieux, on ne fe fervoit que desflûtes éga'es droites,
que l’on appe.oit aufli lydiennes, & qui avoient le
fon grave; que quand le fujet étoit fort enjoué,
on ne fe fer voit que des flûtes égales gauches,
qui étoient appelées tyricnnes ou farranes, qui avoient
le fon aigu, par conféquent plus propre à la joie ;
enfin que-quand le fujet étoit mêlé de l’enjoué & du
lérieux, on prencit les flûtes inégales , c’eft - à- dire,
la. d r o i t e l a gauche, qu’on nemmoitphrygiennes.
Madame Dacier eft au contraire perfuadée que
ce n’étoit point du tout le fujet des pièces qui région
la mufique, dans i’occafion où. elles étoient
représentées. En effet, il auroit été impertinent qu’une
pièce faite- pou/ hono-er des funérailleseût eu une
mufique er.jouée; c’eft pourquoi, quand les Adel plies
de Térence furent- joués- la première fois, ils le furent
tibiis lydiis , avec les flûtes lydiennes,, cteft-à-dire ,
avec deux flûtes droit s ; & quand ils furent joués
pour des Qçcafions de joie & de diverti ffemert, cè
fut tibiis farranis, avec les flûtes gauches. Ain f i ,
quand une pièce étoit jouée pendant les grandes
fê-es, comme la joie & la religion s’y trouvoient
mêlées, c’éjeit ordinairement avec les flûtes inégales;
ou une fois avec deux droites & enfuice avec
deux g a u c h e s e u bien en les prenant alternativement
à chaque intermède.
Au relie, ceux qui jouoient de la flûte p,:ur le
théâtre fe niettoier.t autour delà bouche une efpèce
de ligatureou bandage, compoféde plufieurs courroies
qu’ilslioient derrière la tête, afin que leurs joues,
ne paruffent pis enfléé/s, & qu’i's puffent mieux
gouver. er leur haleine, & la rendre plus douce.
C ’eft cette ligature que les Grecs a pelotent ®opfiua.v,
Sophocle en parle, quand il d it .:
<t>vca yup » , ïrftjx.p'ojcriv uvXi<TKOtç t Tl ,
Axd apyipiais (flvvcua-i qiopfieictr ctrep.
h II ne fouffie plus dans des petites f lû t e smais dans
des feuffiets é. buvantabhs &. fans bandages. » Ce
que Cicéron applique heureufement a Pompee ,
F L U
pour marquer qu’il ne gardoit plus de mefu-re
& qu’il ne iongeoit plus à modérer fon ambition.
Il eft parlé du bandage Qtpgtiu autrement appelé,
IJepHriôfHov dans Plutarque, dans le Scholiaftes d’A -
riflophane & ailleuis , & l’on en voit la figure fur
quc'qu s anciens monumens.
La flûte n’étoit pas, bornée au feul théâtre; elle
entroit dans la plupart des autres fpeétec'es, & des
cérémonies grecques & romaines; dans ce le des
noces, des exp:a ions, des facrifices & fur-tout dans
celle des funérailles A ccoutumée de tout temps aux
fanglots de ces femmes gagnées, qui pofféd’oient l’a.t
de pleurer fans affliélion; elle ne pouvoit manquer
de former la principale mufique des pompes funèbres.
A celle du jeune Arehémore fils de Licurgue, c’eft
la flûte qui donne le fignal, & ce ton des lamen-
. tâtions. D.ms les fê es d'Adonis , on fe fer voit -aufli
de la flûte, & l’on y ajoutait ces. mots lugubres ,
û) ut tov Aê%viy hélas ! hél'as ! Adonis ! mots qui
convenoient parfaitement à la trifteffe. de ces fêtes.
Les Romains en vertu d’une loi très-ancienne ,
& que Cicéron nous a. confervée, . employèrent la
flûte au même ufage. E le fe faifoit entendre dans
les pompes funèbres des empereurs, des. grands , &
des particuliers, de quel qu’âgé & dé quelque, qualité
qu’ils fuffent ; car- dans toutes leurs funérailles'
•on chantait de ces chants lugubres ». appelés noenioe,
qui de.mando'ent ncceflairement 1,’ac rompagjiement
des, flûtes ; c’eft encore pour la même raison qu’on
d soit en provebe , jam licet ad tïbicines mutas ,
envoyez, chercher les joueurs, de flûtes, pour marquer
qu’un malade étoit défefpéré * & qu’il, n’a-
voit p us qu’un moment: à vivre ;. expreffion proverbiale,
que Circé emploie affez plaifammenr ch ns
les reproches qu’elle fait à Polienos, fur fon impuif-
fance. (V c y e z Petron. )
Puifquela flûte fervoit à des cérémonies de différente
rature, il falloir bien qu’on eut trouvé-.l’art
d’en ajufier les fons à ces dtverfes cérémonies, &
cet art fut imag né de très-bonne heure. Nous lifons
dans Piutarque que Clonas fut le premier auteur des
nomes ou des a:rs de fliite. Les principaux qu’il inventa,
& çiui furent extrêmement perfectionnés après
lui, font l’Apothétos, le Schoénion, lè Trîmelés,
l’Elégiaque , lé Comarchios, le Cépionien & le
Déios. Expliquons tons ces mots énigmatiques, qu’on
trouve fi fouvent dans les anciens auteurs.'
L’air Apothétos étoit un air majeftueux, réfervé
pour les gfandes fêtes & les cérémonies d’éclat.
L’air Schoénion, dont Pollux & Héfÿch'us parlent
beaucoup, devoit ce nom au caraélère de mufique
& de poëfic, dans lequel il étoit compofé ; caractère
qui, félon Cafaubon, avoit quelque chofe de mou,
de. flexibje, & pour ainfi dire d’tfféminé.
L’air Trimelés étoit partagé en trois ftrophes ou
F L U
couplets. La première flrophe fe jouoit fur le mode
Dorien ; la fécondé fur le Phrygien ; la troifième fur
le Lydien , & c’est de ces trois changemens de modes
que cet air tiroir fon nom, comme qui diroit air à
trois modes ; c’eft à quoi répondroit précifément dans
notre mufique, un air à trois couplets, dont le premier
feroit compofé en C flot u t, le fécond en d la
je , le troifième eu e f l mi.
L’air EUgiatique ou Plaintif, s’entend affez.
L’aïr Comarchios-ou Bachique , avoit le' premier
rang parmi ceux que l’on jouoit dans-les feflins &
dans les affembîées de débauchés, auxquelles préfi-
doit le dieu Cornus.
L ’air Cépion empruntoit fon nom de fon auteur ,
élève de Terpandre, qui-s étoit fignalé dans les airs
pour laflûte & pour la Cithare; mais on ignore quel
étoit le caraélère diftinélifde l’air Cépionien.
L’air Déios femble fignifier un air craintif & timide.
Outre les airs de flûte que nous venons de donner,
Olympe, Phrygien d’origine, compofa fur cet
inftrument, à l’honneur d’Apollon, l’air appelé
Polycèphak, ou à plufieurs têtes ; Pindare en fait Pal-
las l’inventrice , p:ur imiter les gémiffemens des
foeurs de Médivfe, après que Perfée leur eût coupé
la lête. Comme les ferpens qui couvroient la tête
de Médufe étoient cenfés fiffler fur différens tons , la
flûte imitoit cette variété de fifflement.
Les auteiïrs parlent aufli de l’air Pharmacios, c’eft-
à-dire, du Char. Hésichius prétend que cet air prît
ce nom de fon jeu, qui lui faifoit imiter la rapidité
ou le mouvement d’un char.
L’air Arthien eft célébré dans Homère, dans A:if~
tophane, dans Hérodpte, dans Plutarque & autres.
La modulation en étoit élevée, & le rythme plein de
vivacité, ce qui le rendoit d’un grand ufage dans la
guerre, pour encourager les troupes, C’eft fur ce
haut ton que crie la difeorde dans Homère, pour
exciter les Grecs au combat. C ’étoit, comme nous
le dirons bientôt, en jouant ce même air fur la flûte,
que Timothée le Thébain faifoit- courir Alexandre
aux armes. C ’étoit au rapport d’Hérodote, le mode
Arthien que chantoit Arion, fur la poupe du vaiffeau,
d’où il fe précipita dans la mer.
Enfin l’on met au nombre des principaux airs de
flûte, le- Cradias , c’eft-à-dirél'air du fig u ie r qu’on
jouoit pendant la marche dès viélimeâ expiatoires ,
dans les Tragédies d’Athènes^ Il y avoit dans ces
fêtes deux victimes expi toit es,- qu’on frappoit pendant
la marche avec dès branches de figuier fauvage.
Ainfi le nom de Cradias eft tiré de Kpûh branche de
figuier.
Comme il n’étoit plus permis de rien changer dans
F L U » 1
• le jeu des airs de flû te , foie pour l’harmonie, Toit
pour la cadence , & que les muficiens avoient grand
foin de conferver à chacun de ces airs le ton qui
lui étoit- propre, de - là vient qu’on appeloit leurs
chants nomes , c’eft-à-dire, lo i, modèle, parce qu’ils
avoient tous différens tons qui leur étoient affeélés,
& qui fervoient de règles invariables', dont on ne
devoit point s’écarter.
On eut d’autant plus de foin de s y conformer,
qu’on ne manqua, pas d'attribuer à l’excellence de
quelques-uns de ces airs, des effets furprenans peur
animer ou calmer les pallions des hommes ( Voyez
Effets de la mufique. )
Mais e’eft affez parler desflûtes anciennes, de leurs
dénominations , de .la variété de leurs airs, de leurs
ufages, & de leurs effet*. On trouvera cette matière
discutée plus à fond dans les ouvrages “de Meursius
& de Gafpard Bartholin , de tibiis veterum, & dans
le dialogue de Plutarque fur la mufique traduits en
françois, avec les fa van tés remarques de M. Burette,
qui ornent les mémoires de l’académie royale des
-inferiptions. ( M, de J amans. )
F lûte double. La flûte daubée, ou la flûte à
deux tiges étoit un inftrument domeftique, en
chez les anciens, & fur laquelle le muficién fétd
pouvoit exécuter une forte de concert.
La doubleflûte étoit compofée de deuxflûtes uni.s,
de manière qu’elles n’a voient ordinairement qu’une
embouchure commune pourles deux tuyaux. Ces f/ûtes
étoient égales, ou inégales, foitpour la longueftr,
foit pour le diamètre ou la grofleur. Les flirtes égales
rendoient un même fon ; les inégales rendaient d.s
fons'différens, l’un grave ,& l’autre aigu. La fym-
phonle qui réfultoit des deux flûtes égales étoit,
ou l’uniffon, lorfque les deux-mains du joueur tou-
choiénr en même-temps les mêmes trous fur chaque
flûte, ou la tierce, lorîque les deux mains touchoieut •
différens trou*. La diverfité des fons , produite par
l’inégalité des flûtes' ne pouvoit être que de deux ef-
péces, fuivant que ces flûtes étoient à l’octave, ou
lentement à la tierce; & dans l’un ou l’autre cas
les mains du joueur touchoient en même - temos
les mêmes trous fur chaque flûte , & formoienc
par conféquent un Goncert, ou à i’o&ave, ou à la
tierce.
Au refte, Apulée dans fes florides, attribue à
Hyagnis l’invention de là double.flûte. Cet Hya^nis
étoit père dé Marfias, & paffa généralement pour
l’inventeur de l’harmonie phrygienne. II floriffoit à
célènes, ville de phrygie, la 1242e. année de- la
Chronique de Paros, 150Û ans avant J. C.
( M. de Jaucourt. ).-
F l û t e s - des anciens. L’ invention de cet inftrument
fe perd-dans la plus haute antiquité, & dans des ternis
où il n’y avoit d’ vutre hiftoire que la fable.. Il eft
-donc impoiiible de favoir.au julie fon origine.