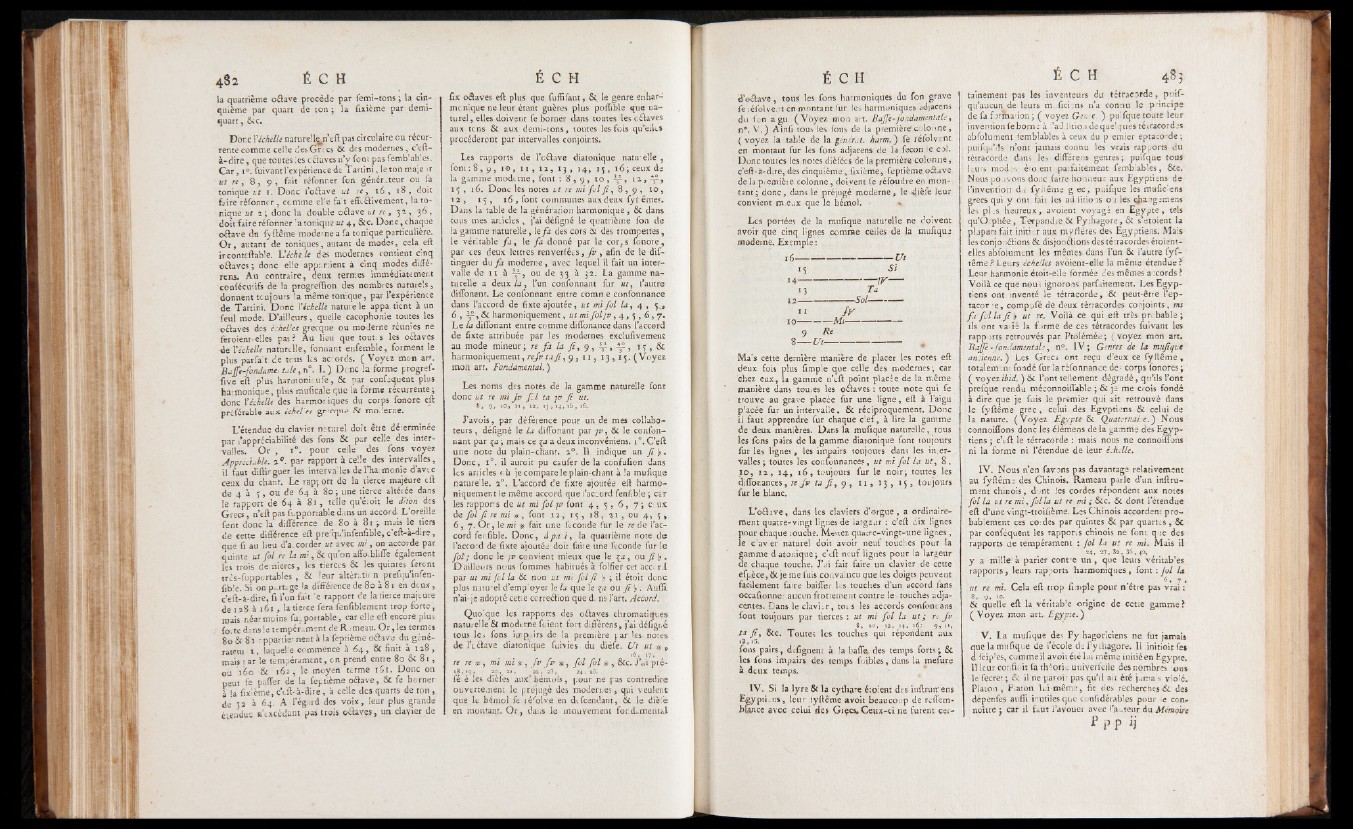
la quatrième oftave procède par femi-tons ; la cinquième
par quart de ton ; la fixième par demi-
quart, &c.
Dor.c Yéchelle naturellen’eft pas circulaire ou récurrente
comme celle des Gr; es & des modernesc’eft-
à-dire, que toutes les céïaves n’y font pas femb’ables.
C a r , t°. fuivant l'expérience de Tartini, letonmaje ir
ut re, 8 , 9 , fait réfonner fon générateur ou fa
tonique ut i. Donc l’oélave Ml rc, 16 , 18 , doit
faire réfonner, comme elle fa t effectivement, la tonique
ut 2 ; donc la double oétave ut re, 3 2 , 36 ,
doit faire réfonner 'a tonique ut 4, &c. Donc, chaque
oéfave dn fyftême moderne a fa tonique particulière.
O r , autant de toniques, autant de modes, cela eft
ireonteftabîe. Véchele des modernes contient cinq
oélaves ; donc elle appartient à cinq modes diffé-
rens* Au contraire, deux termes immédiatement
confécurifs de la progreffion des nombres naturels,
donnent toujours la même tonique, par l’expérience
de Tartini. Donc YécheUe natute le appa tient à un
feul mode. D ’ailleurs, quelle cacophonie toutes les
oélaves des échelles grecque ou moderne réunies ne
feroienr-elles pas? Au lieu que tout:s les oélaves
de l’échelle naturelle, fonnant enfemble, forment le
plus parfait de tous les accords. ( Voyez mon art.
Buffe-fondamet taie, n°. I .) Donc la forme progref-
five eft plus harmonieufe, & par confiquent plus
harmonique, plus muftcale que la forme récurrente ;
donc l’échelle des harmoniques du corps fonore efl
préférable aux echel es grecque & moderne.
L’étendue du clavier naturel doit être déterminée
par l’apprériabilité des fons & par celle des intervalles.
Or , i° . pour celle des fons voyez
Appréciable. z ° . par rapport à celle des intervalles,
il faut diflirguer les intervalles de l’harmonie d’avec
ceux du chant. Le rapport de la tiercé majeure efl
de 4 à ; , ou de 64 à 80 ; une tierce altérée dans
le rapport de 64 à 8 1 , telle qu’é.-oit le diton des
Grecs, n’efl pas fupportable dans un accord. L ’oreille
fent donc la différence de 80 à 81 p mais le tiers
de cette différence efl pre'qu’infenfible, c’eft-i-dire,
que fi au lieu d’a. corder ut avec mi, on accorde par
quinte ut fol re lamé, & qu’on affo.bliffe également
les trois dernieres , les tierces & les quintes feront
trcs-fuppcrtables , & leur âltérctir n prefqu’infen-
fib'e. Si on partage la différence de 80 à 81 en deux,
c’eft-à-dire, fi l’on fait 'e rapport de la tierce majeure
de 128 à 161, la tierce fera fenfiblement trop forte,
mais néanmoins fupportable, car elle efl encore plus
forte dans le tempérament de Rameau. O r , les termes
8 0 & 8 1 r ppariier nent à la feptième oétave du gèné-
rateut 1 , laquel'e commence à 6 4 , & finit à 1 z 8 ,
mais r ar le tempérament, on prend entre 80 & 8 1 ,
ou 160 & 162, le moyen terme ról . Donc on
peut fe paffer de la feptième oétave, & fe borner
l la fixième, c’ifl- à-dire, à celle des quarts de ton,
de 32 à 64. A l’égard des voix , leur plus grande
étendue »’excédant pas trois oélaves, un clavier de
fix oélaves eft plus que fuffifant, & le genre enhar-
me nique ne leur étant guères plus poffible que naturel
, elles doivent fe borner dans toutes les cétaves
aux te ns & aux demi-tons, toutes les fois qu’èlks
procéderont par intervalles conjoints.
Les rapports de l’céfave diatonique natirelle ,
font 1 8 , 9 , i o , 1 1 , 1 2 , 13, 14, i<, 16; ceux de
la gamme moderne, font : 8 , 9 , 10, 12, -^,
15 , 16. Donc les notes i t re mi fo l f i , 8 , 9 , 10,
12 , i f , 16 , font communes aux deux fyhêmes.
Dans la table de la génération harmonique, & dans
•tous mes articles , j’ai défigné le quatrième fon de
la gamme naturelle, le fa des cors & des trompettes,
le véritable fa , le fa donné par le corps fonore,
par ces deux lettres ren v e r fé e s ,^ , afin de le distinguer
du fa moderne, avec lequel il fait un intervalle
de 11 à ou de 33 à 32. La gamme naturelle
a deux la , l’un confonnant fur ut, l’autre
diflonant. Le confonnant entre comit é confonnance
dans l’accord de fixte ajoutée, ut mi fol la, 4 , 5..,
6 , i ç , & harmoniquement, ut mi f i l j v , 4 , 5 , 6 , 7 .
Le la diftonant entre comme diftona.nce dans l’accoFd
de fixte attribuée par les modernes exclufivemenc
au mode mineur; re fa la f i , 9 , i f , , 15 , &
harmoniquement, r e jv t .if , 9 , 1 1 , 13, 15. (Voyez
mon art. Fondamental. )
Les noms des notes de la gamme naturelle font
donc ut re mi Jv f l ta iv f i ut.
8, 9, a o y n , i 2 , 1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ;
J’avois, par déférence pour un de mes collabo-
teurs, défigné le la diflonant par jv , & le confonnant
par [a ; mais ce %a a deux inconvéniens. i°. C ’eft
une note du plain-chant. 20. 11 indique un f i b.
Donc, i° . il aurait pu caufer de la confuficn dans
les anicles cù je compare le plain-chant à îa mufique
nature'le. 20. L’accord de fixte ajoutée eft harmoniquement
le même accord que l’accord fenfible ; car
les rapports de ut mi fol p font 4 , 5 , 6 , 7 ; c:ux
de fol f i re mi «?, font 12, 15 , 18, 2 1 , ou 4, 5 ,
6 , 7 . O r , le mi * fait une fécondé fur le re de l’accord
fenfible. Donc, àpa i , la quatrième note de
l’accord de fixte ajoutée doit faite une fécondé fur le
f i t ; donc le j v convient mieux que le % a , ou f i }>.
D’ailleurs nous fommes habitués à folfier cet acc< r i
par ut mi fol la & non ut mi f i l f i j> ; il étoit donc
plus naturel d’emp’oyer le la que le ou f i ^ . Auflî
n’ai-je adopté cette ccrreélion que d. ns l’art. Accord.
Quo'que les rapports des oélaves chromatiques
naturelle & moderne fuient fort di^érens, j’ai défigr.é
tous les fons impairs de la première par les notes
de l’c éiave diatonique fuivies du dièfe. Ut ut % ,
>6, 17,
re re #, mi mi # , Jv Jv , fol fo l # , &c. J’ai pré-
18, 19 , 20 , 21, 22 , 2.3, 24. 2-5, .
fé.é les dièfes aux" bémols, pour ne pas contredire
ouvertement le préjugé des moden.es, qui veulent
que le bémol fe jéfolve en dvfcendant, & le dièfe
en montant. O r , dans le mouvement fondamental
«Toélave, tous les fons harmoniques du fon grave
fe léfolve.'t en montant fur les harmoniques adjacens
du fon a gu. (V oy e z mon art. Baffe-fondamentale,
n*. V . ) Ainfi tous les fons de la première colonne,
(voyez la table de la générât, harm. ) fe réfolvent
en montant fur les fons adjacens de la fecon ie col.
Donc toutes les notes dièfées de la première colonne,
c’eft-à-dire, des cinquième , fixième, feptième.o&ave
de la p?emière colonne, doivent fe réfoudre en montant;
donc, dans le préjugé moderne, le -dièfe leur
convient m.ejx que le bémol. •
Les portées de la mufique naturelle ne doivent
avoir que cinq lignes comme celles de la mufique
moderne. Exemple:
16------------------------------Ut
15 Si
! 4------------------------ IV----
13 Ta
12----------------- Sol---------- -
" M V
9 Re
8----Ut------------------------
Ma:s cette dernière manière de placer les rotes eft
deux fois plus fimple que celle des modernes; car
chez eux, La gamme n’eft point placée de la même
manière dans touses les oélaves : route note qui fe
trouve au grave placée fur une ligne, eft à l’aigu
p'acée fur un intervalle, & réciproquement. Donc
il faut apprendre fur chaque clef, à lire la gamme
de deux manières. Dans la mufique naturelle, tous
les fons pairs de la gamme diatonique font toujours
furies lignes, les impairs toujours dans les in.er-
valles; toutes les confonnance«, ut mi fo l la ut, 8.
10, 12 , 14 , 1 6 , toujours fur le noir; toutes les
difTor.ances, re Jv ta f i , 9 , 1 1 , 13 , 15 , toujours
fur le blanc.
L’oélave, dans les claviers d’orgue, a ordinairement
quatre-vingt lignes de largeur : c’eft dix lignes
pour chaque touche. Mwez quatre-vingt-une lignes ,
le c'av er naturel doit avoir neuf touches pour la
gamme d atonique ; c’eft neuf lignes pour la largeur
ae chaque touche. J’ai fait faire un clavier de cette
efp.èce, & je me fuis convaincu que les doigts peuvent
facilement faire bailler k s touches d’un accord fans
occafionne: aucun frottement contre le> touches adjacentes.
Dans le c la vi.r , tors les accords confonrans
font toujours par tiefees : ut mi fo l la ut ; re Jv
8, io ,:-'12, 14. 1^; 9 » I».
ta f i , &c. Toutes les touches qui repondent aux
fons pairs, defignent à !a bafift. des temps forts; &
les fons impairs des temps foifiles, dans la mefure
à deux temps.
IV. Si la lyre & la cythare é:o’:ent des inftrumens
Egypti-ns, leur fyftême avoit beaucoup de reflem-
felance avec celui des Gtçc$» Ceux-ci ne furent çertainement
pas les inventeurs du tétracorde, puif-
qii’aucun de leurs m <fici:ns n’a connu le principe
de fa f :>rmarion ; ( voyez Gen e ) pulfque toute leur
invention fe borne à l’ad.ütio.» de quelques tétracordes
abfolument fëmblables à ceux du p emier eptaco-de ;
puifqu’iîs n’ont jamais connu les vrais rapports du
tétracorde dans le» différens genres; puifque tous
leurs modes éto.ent parfaitement femblables, &c.
Nous pouvons donc faire honneur aux Egyptiens de
l’invention d i fynême g e c, puifque les muûciens
grecs qui y ont fait les additions 0.1 les ejiangemens
les pl.s heureux, avoient voyagé en Egypte, tels
qu’O.'phée, Terpandre & Pyrhagore, & s’etoient la
plupart fait Initier aux myftéres des Egyptiens. Mais
les conjonélions & disjonftions des técracordes étoient-
elles abfoiument les mêmes dans l’un & l’autre fyftême
? Leurs échelles avoient-elle la même étendue ?
Leur harmonie étoit-eile formée ces mêmes accords ?
Voilà ce que nou» ignorons parfaitement. Les Egyptiens
ont inventé le tétracorde, & peut-être l’ep-
tacor ‘e , compofé de deux tétracordes conjoints, mi
fa fo lia f i b ut re. Voilà ce qui eft très pre bable ;
ils ont vaaé la forme de ces tétracordes fuivant les
rapports retrouvas par Ptplémée; (voyez mon art.
Baffe - fondamental: , n°. IV ; Genres de la mufique
antienne.') Les Grecs ont reçu d’eux ce fyftême ,
totalement fondé fur la rèfonnance de; corps fonores ;
( voyez ibid. ) & l’ont tellement dégradé, qu’ils l’ont
prefque rendu méconnoiffable ; & je me crois fondé
à dire que je fuis le premier qui ait retrouvé dans
le fyftême grec, celui des Egyptiens & celui de
la nature. (V oy e z Egypte & Quaternaire.) Nous
connoiffons donc les élémens de la gamme des Egyptiens
; c’tft le tétracorde : mais nous ne connoiffons
ni la forme ni l’étendue de leur é.hdle.
IV. Nous n’en favons pas davantage relativement
au fyftême des Chinois. Rameau parle d’un inftru-
ment chinois, dont les cordes répondent aux notes
fo l la ut re mi, folia ut re mi ; &c. & dont l’étendue
eft d’une vingt-troifième. Les Chinois accordent probablement
ces cordes par quintes & par quartes, &
par conféquent les rapporis chinois ne font que des
rapports de tempérament : fol la ut re mi. Mais il
24, 27, 3 2 , 3 6 , 40,
y a mille à parier contre un , que leurs véritab’es
rapports, leurs rapports harmoniques, font : f i l la
A 6 , 7 ,
ut re mi. Cela eft trop fimple pour n’etre pas vrai :
8, ÿ , 10.
& quelle eft la véritable origine de cette gamme ?
(V o y e z mon art »Egypte.)
V . La mufique des Pythagoriciens ne fut jamais
que la mufique de l’école de Pythagore. Il initioit fes
d fcip’es, comme il avoit été lui même initié en Egypte.
11 leur cor.fioit fa théorie univerfelle des nombres ous
le fecret ; & il ne paroi: pas qu’il ait été j«ima s violé.
Platon, Piaton lui-même, fit des recherches & des
dépenfes aufii inutiles que confidérables pour ie con-
noître 3 car il Lut l’avouer avec l’a-teur du Mémoire
p p p ij