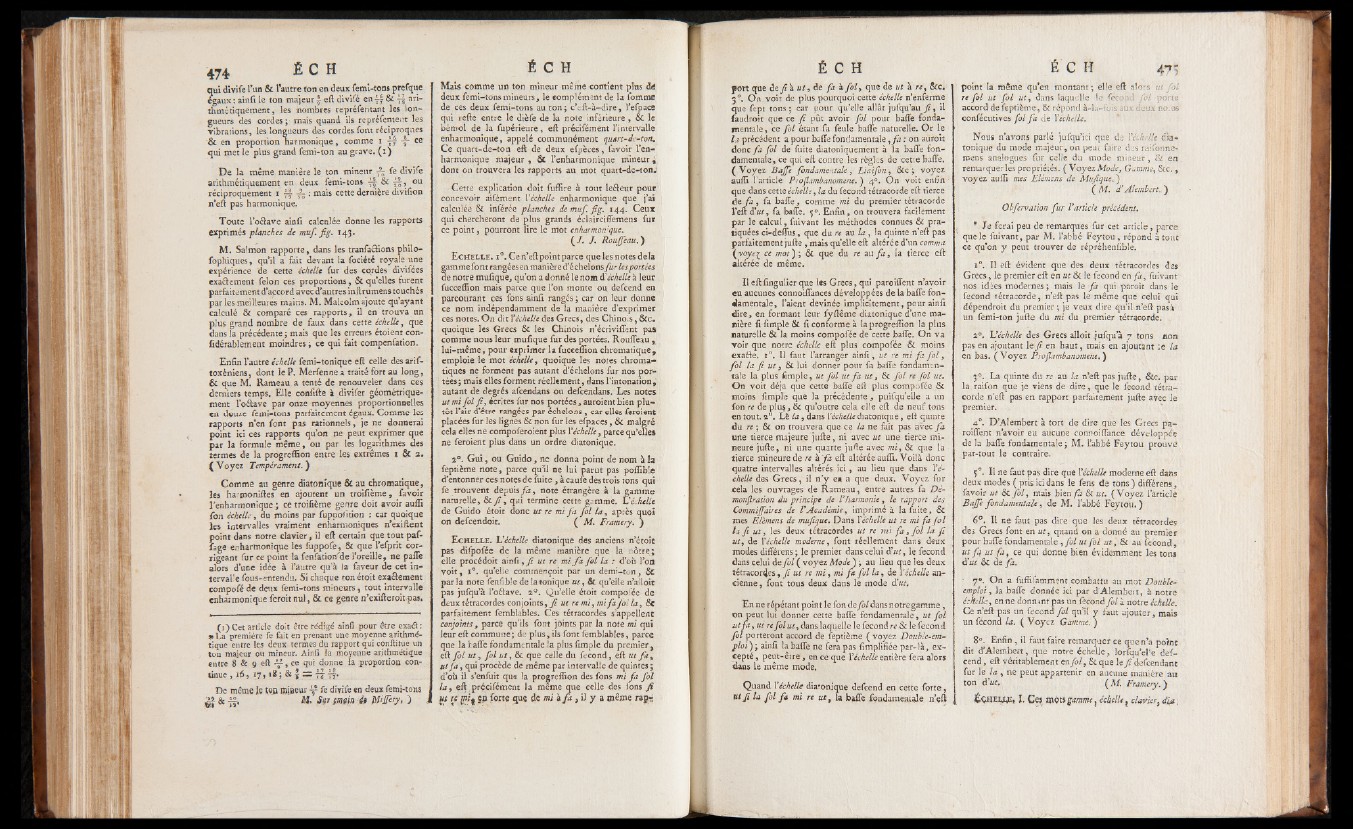
qui divife l’un & l'autre ton en deux femi-tons prefque
égaux : ainfi le ton majeur £■ eft divifé en & 75 arithmétiquement,
les nombres repréfentant les longueurs
des cordes; mais quand ils repréfentent les
vibrations, les longueurs des cordes font réciproques
& en proportion narmonique, comme 1 -fy ce
qui met le plus grand femi-ton au grave. (1)
De la même manière le ton mineur fe divife
arithmétiquement en deux, femi-tons & yf»- ou
réciproquement 1 — fz : mais cette dernière divifion
n'eft pas harmonique.
Toute l’oâave ainfi calculée donne les rapports
exprimés planches de muf. fig. 143.
M. Salmon rapporte, dans les tranfa&ions philo-
fophiques, qu'il a fait devant la fociété royale une
expérience de cette échelle fur des cqrdes divifées
exa&ement félon ces proportions, qu'elles furent
parfaitement d'accord avec d’autres inftrumens touchés
par les meilleures mains. M. Malcolm ajoute qu’ayant
calculé & comparé ces rapports, il en trouva nn
plus grand nombre de faux dans cette échelle, que
dans la précédente ; mais que les erreurs étoient considérablement
moindres ; ce qui fait compenfation.
Enfin l’autre échelle femi-tonique eft celle des arif-
toxèniens, dont le P. Merfenne a traité fort au long,
& que M. Rameau a tenté de renouveler dans ces
derniers temps. Elle confifte à divifer géométriquement
l’oétave par onze moyennes proportionnelles
en douze femi-tons parfaitement égaux. Comme les
rapports n'en font pas rationnels, je ne donnerai
point ici ces rapports qu’on ne peut exprimer que
par la formule même, ou par les logarithmes des
termes de la progreffion entre les extrêmes 1 & 2,
( Voyez Tempérament. )
Comme au genre diatonique & au chromatique,
les harmoniftes en ajoutent un troifième, lavoir
l ’enharmonique; ce troifième genre doit avoir auffi
fon échelle, du moins par fuppofition : car quoique
les intervalles vraiment enharmoniques n'exiftent
point dans notre clavier, il eft certain que. tout paf-
fage enharmonique les fuppofe, & que l'efprit corrigeant
fur ce point la fenfationde l’oreille, ne paffe
alors d’une idée à l’autre qu a ia faveur de cet in-
terval’e fous-entendu, Si chaque ton étoit exa&ement
compofé de deux femi-tons mineurs, tout intervalle
enharmonique feroit nul, & ce genre n’exifteroitpas.
(i)C e t article doit être rédigé ainfî pour être exaét:
»La première fe fait en prenant une moyenne arithmétique
entre les deux termes du rapport qui conftitue un
ton majeur ou mineur. Ainfi la moyenne arithmétique
entre 8 & 9 eft ~ , ce qui donne la proportion continue
, 1 6 5 1 7 J |8 , & 'ÿ ' I ÿ J J*
De même le tf&k mineur — fe divife en deux femi-tons
g j & ff» M. S<fr m m fo Mffiry, )
Mais comme un ton mineur même contient plus dé
deux femi-tons mineurs, le complément de la fommfi
de ces deux femi-tons au ton ; c’eft-à-dire, l’efpace
qui refte entre le dièfe de k note inférieure , & le
bémol de la fupérieure, eft précifément l’intervalle
enharmonique, appelé communément quart-de-ton*
Ce quart-de-ton eft de deux efpèces, favoir l’enharmonique
majeur , ôc l’enharmonique mineur ;
dont on trouvera les rapports au mot quart-de-ton.)
Cettë explication doit fuffire à tout leâeur pour
concevoir aifément Xéchelle enharmonique que j’ai
calculée & inférée planches de muf. fig. 144. Ceux
qui chercheront de plus grands éclairciffemens fur
ce point, pourront lire le mot enharmonique.
(ƒ. J. Roujfeau.)
Echelle. i °. Ce n’eft point parce que les notes delà
gamme font rangées en manière d’échelons fur les portées
de notre mufique, qu’on a donné le nom à?échelle à leur
fucceffion mais parce que l’on monte ou defeend en
parcourant ces fons ainfi ranges ; car on leur donne
ce nom indépendamment de la manière d’exprimer
ces notes. On dit Xéchelle des Grecs, des Chinois, &c.
quoique les Grecs & les Chinois n’écriviffent pas
comme nous leur mufique fur des portées. RoufTeau *
lui-même, pour exprimer la fucceffion chromatique,
emploie le mot échelle, quoique les notes chromatiques
ne forment pas autant d’échelons fur nos portées;
mais elles forment, réellement, dans l’intonation^
autant de degrés afeendans ou defeendans. Les notes
ut mi fol fi, écrites fur nos portées, auroient bien plutôt
l’air d’être rangées par échelons, car elles feroient
placées fur les lignes & non fur les efpaces, & malgré
cela elles ne compoferoient plus Xéchelle, parce qu’elles
ne feroient plus dans un ordre diatonique.
i°. Gui, ou Guido, ne donna point de nom à la
feptième note, parce qu’il ne lui parut pas poffibîe
d’entonner ces notes de fuite , à caufe des trois tons qui
fe trouvent depuis fa , note étrangère à la gamme
naturelle, SL f i , qui termine cette gamme. L’échelle
de Guido étoit donc ut re mi fa fol la, après quoi
on defeendoit. ( M. Framery. )
Echelle. U échelle diatonique des anciens n’étoit
pas difpofée de la même manière que la nôtre;
elle procédoit ainfi, fi ut re mi fa fol la : d’ou l’on
voit, i°. qu'elle commençoit par un demi-ton, &
parla note fenfible de la tonique ut, & qu’elle n'ailoit
pas jufqu’à l’oâave. oP. Qu’elle étoit compofée de
deux tétracordes conjoints, f i ut re mi,mifa folia, Sc
parfaitement femblables. Ces tétracordes s’appellent
conjoints, parce qu’ils font joints par la note mi qui
leur eft commune; de plus, ils font femblables, parce
que la baffe fondamentale la plus fimple du premier,
eft fol ut, fol ut, & que celle du fécond, eft ut fa ,
ut fa , qui procède de même par intervalle de quintes ;
d’oii il s’enfuit que la progreffion des fons mi fa fol
la, eft,précifément la même que celle des fons f i
ÿt re SP forte que de mi à f a , il y a même rapport
que de j î à ut, de fa à fo l, que de ut à re, &c.
3 °. On voir de plus pourquoi cette échelle n’enferme
que fept tons ; car pour qu’elle allât jufqu’au f i , il
faudroit que ce f i pût avoir fol pour baffe fondamentale
, ce fol étant fa feule baffe naturelle. Or le
la précédent a pour baffe fondamentale ,fa : on auroit
donc fa fol de fuite diatoniquement à la baffe fondamentale,
ce qui eft contre les règles de cette baffe.
(V o y e z Baffe fondamentale, Liaifon', &c ; voyez
auffi l'article Proflambanomene. ) 40. On voit enfin
que dans cette échelle, la du fécond tétracorde eft tierce
de f a , fa baffe , comme mi du premier tétracorde
l’eft d'ut, fa baffe. 5 °. Enfin, on trouvera facilement
par le calcul, fuivant les méthodes connues & pratiquées
ci-deffus, que du re au la , la quinte n’eft pas
parfaitement jufte, mais qu elle eft altérée d’un comma
( voye^ ce mot) ; & que du re au fa , la tierce eft
altérée de même.
Ileftfingulierque les Grecs, qui paroiffent n’avoir
eu aucunes connoiffances développées de la baffe fondamentale,
l’aient devinée implicitement, pour ainfi
dire, en formant leur fyftême diatonique d’une manière
fi fimple & fi conforme à la progreffion la plus
naturelle & la moins compofée de cette baffe. On va
voir que notre échelle eft plus compofée & moins
exafte. 1 °. Il faut l’arranger ainfi, ut re mi fa fo l ,
fol la f i ut, & lui donner pour fa baffe fondamentale
la plus fimple, ut fo l ut fa ut, & fo l re fol ut.
On voit déjà que cette baffe eft plus compofée .&
moins fimple que la précédente , puifqu’elle a un
fon re de plu$ , & qu’outre cela elle eft de neuf tons
en tout. a°. Lè la , dans Xéchelle diatonique, eft quinte
du re ; & on trouvera que ce la ne fait pas avec fa
une tierce majeure jufte, ni avec ut une tierce mineure
jufte, ni une quarte jufte avec mi, & que la
tierce mineure de re à fa eft altérée auffi. Voilà donc
quatre intervalles altérés ic i, au lieu que dans IV-
chelle des Grecs, il rt y e* a que deux. Voyez fur
cela les ouvrages de Rameau, entre autres fa Dé-
monfiration du principe de l’harmonie, le rapport des
Commiffaires de l'Académie, imprimé à la fuite, &
mes Elémens de mufique. Dans l'échelle ut re mi fa fo l
la f i ut, les deux tétracordes ut re mi f a , fol la f i
ut, de Xéchelle moderne, font réellement dans deux
modes différens ; le premier dans celui déut, le fécond
dans celui de fol ( voyez Mode') ; au lieu que les deux
tétracordes, f i ut re mi, mi fa fo l la , de Xéchelle ancienne,
font tous deux dans le mode dé ut.
En ne répétant point le fon de fo l dans notre gamme,
on peut lui donner cette baffe fondamentale, ut fol
ut fit , ut re fol ut, dans laquelle le fécond re & le fécond
fol porteront accord de feptième ( voyez Double-emploi)
; ainfi la baffe ne fera pas fimplifiée par-là, excepté
, peut-être, en ce que Xéchelle entière fera alors
dans le même mode.
Quand Xéchelle diatonique defeend en cette forte,
ut f i la fol fa mi re ut, la baffe fondamentale n’eft
point la même qu’en montant ; elle eft alors ut fol
re fol ut fol ut, dans laquelle le fécond fol porte
accord de feptième, & répond à-la-fois aux deux no.os
confécutives fol fa de l'échelle.
Nous n’avons parlé jufqu’ici que de l'échelle diatonique
du mode majeur, on peut faire des raifonne-
mens analogues- fur celle du mode mineur, & en
remarquer les propriétés. ( Voyez Mode, Gamme, & c.,
voyez auffi mes Elémens de Mufique..')
( M. d’Alembert. )
Obfervation fur l'article précédent.
* Je ferai peu de remarques fur cet article, parce
que le fuivant, par M. l’abbé Feytou, répond à tout
ce qu’on y peut trouver de répréhenfible.
i°. Il eft évident que des deux tétracordes des
Grecs, le premier eft en ut & le fécond en fa, fuivant
nos idées modernes ; mais le fa qui paroît dans le
fécond tétracorde, n’eft pas le même que celui qui
dépendroit du premier ; je veux dire qu’il n’eft pas*
un femi-ton jufte du mi du premier tétracorde.
20. échelle des Grecs alloit jufqu a 7 tons non
pas en ajoutant le f i en haut, mais en ajoutant Je la
en bas. (Voyez P roflambanomene.)
3°. La quinte du re au la n’eft pas jufte, &c. par
la raifon que je viens de dire, que le fécond tétracorde
n’eft pas en rapport parfaitement jufte avec le
premier.
4°. D’Alembert à tort de dire que les Grecs paroiffent
n’avoir eu aucune connoiffance développée
de la baffe fondamentale ; M. l!abbé Feytou prouvé
paT-tout le contraire.
50. Il ne faut pas dire que Xéchelle moderne eft dans
deux modes ( pris ici dans le fens de tons) différens,
favoir ut & fol, mais bien fa & ut. ( Voyez l’article
Baffe fondamentale, de M. l’abbé Feytou. )
6°. Il r.e faut pas dire que les deux tétracordes
des Grecs font en ut, quand on a donné au premier
pour baffe fondamentale, fol ut fol ut, & au fécond ,
ut fq ut fa , ce qui donne bien évidemment les tons
dlut & de fa.
7®. On a fufnfamment combattu au mot Double-
emploi, la baffe donnée ici par d'Alembert, à notre
échelle, en ne donnant-pas un fécond fol à notre échelle.
Ce n’eft pas un fécond fol qu’il y faut ajouter, mais
un fécond la. ( Voyez Gamme. )
8°. Enfin, il faut faire remarquer ce que n’a point
dit d’Alembert, que notre échelle, lorfqu’el’e defeend
, eft véritablement en fol, & que le f i defeendant
fur le la , ne peut appartenir en aucune manière au
ton d ut. ( M. Framery. )
ÉÇHEW* I. Çe> JX\Qt$ gamme i échelle} clavier, diq ]