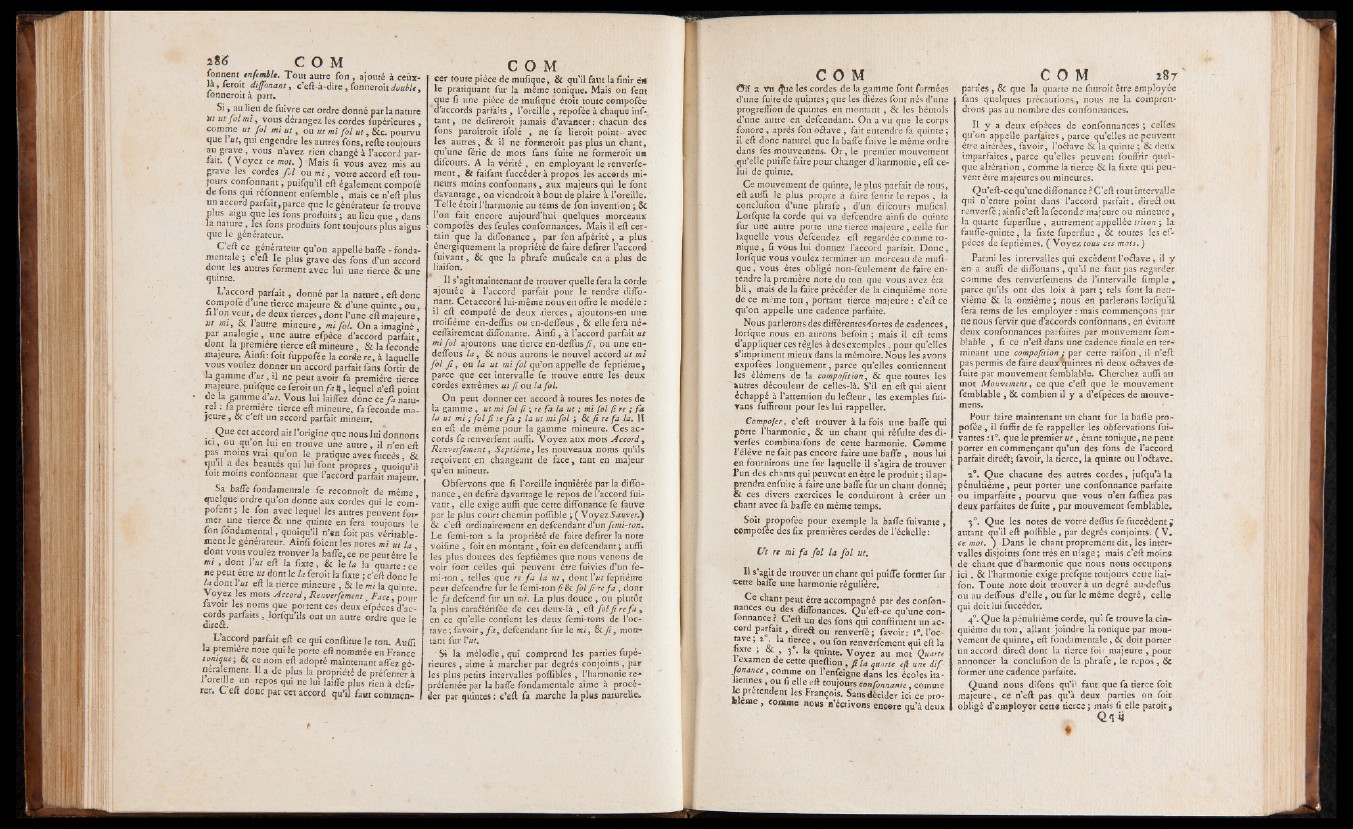
a*« C O M
fonnent tnfemble. Tout autre fon , ajouté à ceux-
là , feroit dijfonant, c’eft-à-dire, fonneroit double,
fonneroità part.
S i , au lieu de fuivre cet ordre donné par la nature
ut ut fo l mi , vous dérangez les cordes fupérieures ,
comme «/ fo l mi ut , ou ut mi fo l u t , &c. pourvu
que 1 ut, qui engendre les autres fons, refte toujours
au grave, vous n’avez rien changé à l’accord parfait.
(V o y e z ce mot, ) Mais fi. vous avez mis au
grave les cordes fo l ou mi, votre accord efi toujours
confondant ; puifqu’il eft également compofé
de fons qui réfonnent enfemble, mais ce n’efi plus
lin accord parfait, parce que le générateur fe trouve
p.us aigu que les fons produits ; au lieu que , dans
la nature , les Ions produits font toujours plus aigus
que le générateur.
C eft ce générateur qu’on appelle baffe - fondamentale
; c eft le plus grave des fons d’un accord
dont les autres forment avec lui une tierce & une
quinte.
L accord parfait, donné par la nature, eft donc
compofé d’une tierce majeure & d’une quinte, o u ,
fi 1 on veut, de deux tierces, dont l’une eft majeure,
ut mi, 8c l’autre mineure, mi fol. On a imaginé,
par analogie, une autre efpèce d’accord parfait,
dont la première tierce eft mineure , & la fécondé
majeure. Ainfi: foit fuppofée la corde re, à laquelle
vous voulez donner un accord parfait fans fortir de
'la gamme d’u t , il ne peut avoir fa première tierce
majeure, puifque ce feroit un fa #, lequel n’eft point
de la gamme d'ut. Vous lui laiffez donc ce fa natu-
rel : fa première tierce eft mineure, fa fécondé majeure
, & c eft un accord parfait mineur.
Que cetaccord ait l ’origine que nous lui donnons
ic i, ou qu’on lui en trouve une autre, il n’en eft
pas moins vrai qu’on le pratique avec fuccès , &
qu’il a des beautés qui lui fout propres , quoiqu’il
foit moins confonnant que l’accord parfait majeur.
Sa baflè fondamentale fè reconnoît de même
quelque ordre qu’on donne aux cordes qui le com-
pofent; le fon avec lequel lès autres peuvent foi).
mer une tierce & une quinte en fera toujours le
fon fondamental, quoiqu’il ri’en foit pas véritablement
le générateur. Ainfi foient les notes mi ut U -
dont vous voulez trouver la baffe, ce ne peut être le
mi , dont l’ut eft la fix te, & 1 e la la quarte : ce
ne peut être ut dont le la feroit la fixte ; c eft donc le
la dont l’ut eft la tierce mineure , & le mi la quinte
Voyez les mots Accord, Renversementi Face, pour
favoir les noms que portent ces deux efpèces d’accords
parfaits, lorfqu’ils ont un autre ordre que le
direct. *
L’accord parfait eft ce qui conftitue le ton. Aufli
la première note qui le porte eft nommée en France
tonique-, & ce nom eft adopté maintenant afl'ez généralement.
Il a de plus la propriété de préfenter à
1 oreille un repos qui ne lui laiffe plus rien à déférer,
C eft donc par cet accord qu’il faut commen-
C O M
cer toute pièce de mufique, 8c qu’il faut la finir 6n
le pratiquant fur la même tonique. Mais on fent
que fi une pièce de mufiqué étoit toute compofée
d’accords parfaits , l’oreille , repofée à chaque inf-
tant, ne defireroit jamais d’avancer : chacun des
fons paroîtroit ifolé , ne fe lieroit point- avec
les autres, & il ne formeroit pas plus un chant,
qu une férié de mots fans fuite ne formeroit un
difeours. A la vérité , en employant le renverfe-
ment, & faifant fuccéder à propos les accords mineurs
moins confonnans, aux majeurs qui le font
davantage, on viendroit à bout de plaire a l’oreille.
Telle étoit l’harmonie au tems de fon invention ; &
l’on fait encore aujourd’hui quelques morceaux
compofés des feules confonnances. Mais il eft cer-
| tain que la diffonance , par fon afpérité, a plus
énergiquement la propriété de faire defirer l’accord
fuivant, & que la phrafe muficale en a plus de
liaifon.
Il s’agit maintenant de trouver quelle fera la corde
ajoutée à l’accord parfait pour le rendre diflb-
nant. Cetaccord lui-même nous en offre le modeler
il eft compofé de deux .tierces, ajoutons-en une
troifième en-deffus oh en-defl©us, & elle fera né-
ceffairement diffonante. Ainfi, à l’accord parfait ut
mi fo l ajoutons une tierce en-deffus f i , ou une en-
deffous la , 8c nous aurons le nouvel accord ut mi
fo l f i , ou la ut mi fol qu’on appelle de feptième,
parce que cet intervalle fe trouve entré les deux
cordes extrêmes ut f i ou la fol.
On peut donner cet accord à toutes les notes de
la gamme , ut mi fo l f i ’, te fa la ut ; mi fol f i re ; fa
la ut mi ; fol f i re fa ; la ut mi fo l ; & f i re fa la. Il
i en eft de même pour la gamme mineure. Ces acr
cords fe renverfent aufli. Voyez aux mots Accord,
Renverfement, Septième, les nouveaux noms qu’ils
reçoivent en changeant de fa ce , tant en majeur
qu’en mineur.
Obfervons que fi l’oreille inquiétée par la diffo-
nance, en defire davantage le repos de l’accord fui«*
vaut, elle exige aufli que cette diffonance fe fauve
par le plus court chemin poflible ; ( Voyez Sauver?)
& c’eft ordinairement en defeendant d’un femi-ton.
Le femi-ton a la propriété de faire defirer la note
voifine , foit en montant, foit en defeendant ; aufli
les plus douces des feptièmes que nous venons de
voir font celles qui peuvent être fitivies d’ un femi
ton , telles que re fa la ut, dont Mut feptième
peut defeendre fur le femi-ton^ & fol f i refit, dont
le fa defeend fur un mi, La plus douce , ou plutôt
la plus cara&érifée de ces deux-là , eft fo lfi re fa ,
en ce qu’elle contient les deux fèmi-tons de l ’octave;
favoir, fa , defeendant fur le mi, & f i , mottr
tant fur Vut,
Si la mélodie, qui comprend les parties fupérieures
, aime à marcher par degrés conjoints, pair
les plus petits intervalles'poflibles , Tharmonie re-*
présentée par la baffe fondamentale aime à procéder
par quintes ; c’eft fa marche la plus naturelle.
C O M
C if a vu <Jtie les cordes de la gamme font formées
d’une fuite de quintes; que les dièzes font nés d’une
progreflion de quintes en montant, & les bémols
d’une autre en defeendant. On a vil que le corps
fonore , après fon o&ave , fait entendre fa quinte ;
il eft donc naturel que la baffe fuive le même ordre
dans fes mouvemens. O r , le premier mouvement
qu’elle puifle faire pour changer d’harmonie, eft celui
de quinte.
Ce mouvement de quinte, le plus parfait de tous,
eft aufli le plus propre à faire fentir le repos , la
conclufion d’une phrafe , d’un difeours mufical.
Lorfque la corde qui va defeendre ainfi de quinte
fur une autre porte une tierce majeure, celle fur
laquelle vous defeendez eft regardée comme tonique
, fi vous lui donnez l’accord parfait. D o n c ,
lorfque vous voulçz terminer un morceau de mufi-
que, vous êtes obligé non-feulement de faire entendre
la première note du ton que vous avez éta
b li, mais de la faire précéder de la cinquième note
de ce même ton, portant tierce majeure : c’eft ce
qu’on appelle une cadence parfaite.
Nous parlerons des différentesdortes de cadences,
lorfque nous en aurons befoin ; mais il eft tems
d’appliquer ces règles à des exemples , pour qu’elles
s’impriment mieux dans la mémoire. Nous les avons
expofées longuement, parce qu’elles contiennent
les élémens de la compofition, 8c que toutes les
autres découlent de celles-là. S’il en eft qui aient
échappé à l ’attention du le&eur, les exemples fui-
vans luffiront pour les lui rappeller.
Compofer, c’eft trouver à la fois une baffe qui
pôrte l’harmonie, & un chant qui réfulte des di-
yerfes combinai fons de cette harmonie. Comme
l’élève ne fait pas encore faire une baffe , nous lui
-en fournirons une fur laquelle il s’agira de trouver
Tun des chants qui peuvent en être le produit ; il apprendra
enfuite à faire une baffe fur un chant donné;
& ces divers exercices le conduiront à créer un
chant avec fa baffe en même temps.
Soit propofée pour exemple la baffe fuivante,
compofée des fix premières cordes de l’échelle :
Ut re mi fa fo l la fo l ut.
Il s’agit de trouver un chant qui puiffe former fur
cette baffe une harmonie régulière.
Ce chant peut être accompagné par des confonnances
ou des diffonances. Q u ’eft-ce qu’une con-
lonnance. C ’eft un des fons qui conftituent un accord
parfait , dired ou renverfé; favoir: i°. l’octave
, i . la tierce, ou fon renverfement qui eft la
nxte ; oc , 3 . la quinte. V o y e z au . mot Quarte
1 examen de cette queftion , f i U quarte e(l une d if
fonance, comme on 1 enfeigne dans les écoles italiennes
, ou fi elle eft toujours confonnante, comme
le prétendent les François. Sans décider ici ce problème
, comme nous n’écrivons encore qu’à deux
C O M î 8 t
parties , & que la quarte ne fauroît être employée
, fans quelques précautions., nous ne la comprendrons
pas au nombre des confonnances.
11 y a deux efpèces de confonnances ; celles
qu’on appelle parfaites , parce qu’elles ne peuvent
être altérées, favoir, l’o&ave & la quinte ; & deux
imparfaites, parce qu’elles peuvent fouffrir quelque
altération , comme la tierce & la fixte qui peuvent
être majeures ou mineures.
Q u ’eft-ce qu’une diffonance ? C ’eft tout intervalle
qui n’entre point dans l’accord parfait, dired ou
renverfé ; ainfi c’eft la fécondé majeure ou mineure,
la quarte fuperflue , autrement appellée triton ; la
faufle-quinte, la fixte fuperflue , & toutes les efpèces
de feptièmes. ( V oyez tousses mots. )
Parmi les intervalles qui excèdent l’o d a v e , il y
en a aufli de diffonans , qu’il ne faut pas regarder
comme dfes renverfemens de l’intervalle fimple,
parce qu’ils ont des loix à part ; tels font la neuvième
8c la onzième ; nous en parlerons lorfqu’il
fera tems de les employer : mais commençons par
ne nous fe.rvir que d’accords confonnans, en évitant
deux confonnances parfaites par mouvement fem-
blable , fi ce n’eft dans une cadence finale en terminant
une compofition : par cette raifon , il n’eft
pas permis de faire deuxijuintes ni deux odaves de
fuite par mouvement femblable. Cherchez aufli au
mot Mouvement, ce que c’eft que le mouvement
femblable , & combien il y a d’efpèces de mouvemens.
Pour faire maintenant un chant fur la baffe propofée
, il fuflït de fe rappeller les obfervations fui-
vantes : l°. que le premier u t , étant tonique,ne peut
porter en commençant qu’ un des fons de l’accord
parfait dired; favoir, la tierce, la quinte ou l’odave.
2°. Que chacune des autres cordes, jufqu’à la
pénultième, peut porter une confonnance parfaite
ou imparfaite, pourvu que vous n’en fafliez pas
deux parfaites de fuite , par mouvement femblable.
3°. Que les notes de votre deffus fe fuccèdent ;
autant qu’il eft poflible, par degrés conjoints. ( V .
ce mot. ) Dans le chant proprement dit, les intervalles
disjoints font très en ufage ; mais c’eft mcrtns
de chant que d’harmonie que nous nous occupons
i c i , & l’harmonie exige prefque toujours cette liaifon.
Toute note doit trouver à un degré au-deflus
ou au-deffous d’e lle , ou fur le même degré, celle
qui doit lui fuccéder.
4°. Que la pénultième corde, qui fe trouve la cinquième
du ton, allant joindre la tonique par mouvement
de quinte, eft fondamentale, 8c doit porter
un accord dired dont la tierce foie majeure , jjour
annoncer la conclufion de la phrafe, le repos , &
former une cadence parfaite.
Quand nous difons qu’i‘: faut que fa tierce foit
majeure, ce n’eft pas qu’à deux parties on foit
obligé d’employer cette tierce; mais fi elle paroît,
Q q ÿ
$