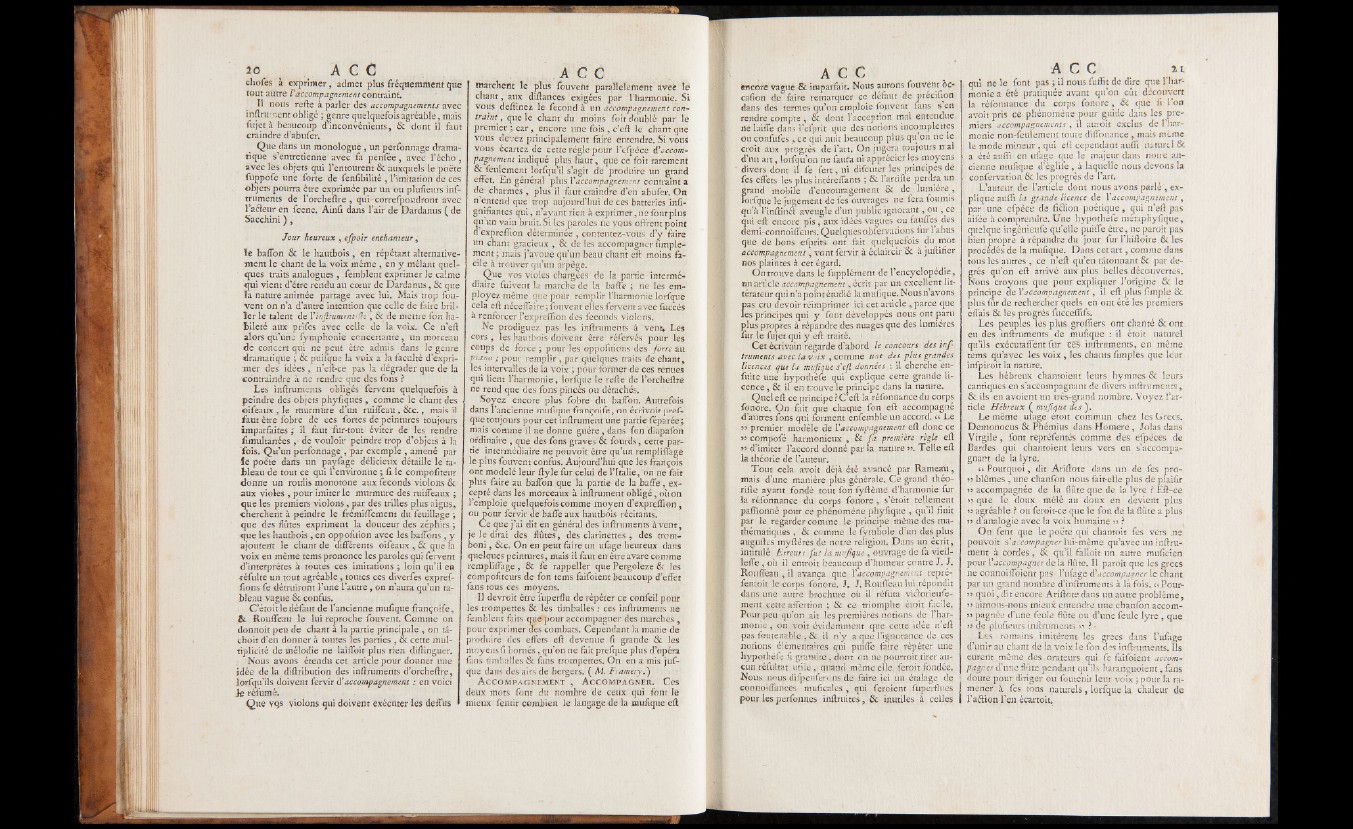
ehofes à exprimer, admet plus fréquemment que
tout autre l'accompagnement contraint.
Il nous refie à parler des accompagnements avec
infini nient obligé ; genre quelquefois agréable, mais
fujet. à beaucoup d inconvénients, & dont il faut
craindre d’abufer.
Que dans un monologue , un perfonnage dramatique
s’entretienne avec fa penfée, avec l’écho,
avec les objets qui l’entourent & auxquels le poète
fuppofe une forte de fenfibilité , l ’imitation de ces
objets pourra être exprimée par un ou plufieurs inf-
truments de l’orcheflre , qui-correfpondront avec
l’aéleur en fcene. Ainfi dans l ’air de Dardanus ( de
Sacchini ) ,
Jour heureux , efpoir enchanteur
le ballon & le hautbois, en répétant alternativement
le chant de la voix même , en y mêlant quelques
traits analogues , femblent exprimer le calme
qui vient d’être rendu au coeur de Dardanus, & que
la nature animée partage avec lui. Mais trop fou-
vent on n’a d’autre intention que celle de faire briller
le talent de Y infiniment! (le , & de mettre fon habileté
aux* prifes avec celle de la voix. Ce n’efl
alors qu’une fymphonie concertante , un morceau
de concert qui ne peut être admis dans le genre
dramatique ; & puifque la voix a la faculté d’exprimer
des idées , n’eil-ce pas la dégrader que de la
contraindre à ne rendre que des fons ?
Les inflruments obligés fervent quelquefois à
peindre des objets phyfiques , comme le chant des
oifeaux , le murmure d’un ruiffeau, & c . , mais il
faut être fobre de ces fortes de peintures toujours
imparfaites ; il faut fur-tout éviter de les rendre
fîmultanées , de vouloir peindre^trop d’objets à la
fois. Q u’un perfonnage , par exemple , amené par
te poète dans un payfage délicieux détaille le tableau
de tout ee qui l’environne ; fi le compofiteur
donne un roulis monotone aux féconds violons &
aux violes , pour imiter le murmure des ruiffeaux ;
que les premiers violons, par des trilles plus aigus,
cherchent à peindre le frémiffement du feuillage ;
que des flûtes expriment la douceur des zéphirs ;
que les hautbois , en oppofition avec les ballons , y
ajoutent le chant de différents oifeaux , & que la
voix en même tems prononce les paroles qui fervent
d’interprêtes à toutes ces imitations ; loin qu’il en
réfulte un tout agréable , toutes ces diverfes expref-
fions fe détruiront l ’une l’autre, on n’aura qu’un tableau
vague & confus.
C ’étoit le défaut de l'ancienne mufique françoife,
& Rouffeau le lui reproche fouvent. Comme on
donnoit peu de chant à la partie principale , on tâ-
choit d’en donner à toutes les parties , & cette multiplicité
de mélodie ne laiffoit plus rien diflinguer.
Nous avons étendu cet article pour donner une
idée de la diflribution des inflruments d’orcheflre,
lorfqu’ils doivent fervir d'accompagnement : en voici
Je réfumé.
Que yqs violons qui doivent exécuter les deffus
A C C
marchent le plus fouvent paralleleftient avec le
chant, aux diflances exigées par l'harmonie. Si
vous deflinez le fécond à un accompagnement con-
traînt t que le chant du mdins foit doublé par le
premier ; car, encore une fois , c’efl le chant que
vous devez principalement faire entendre. Si vous
vous écartez de cette règle pour l’efpéce d’accompagnement
indiqué plus haut, que ce foit rarement
& feulement lorfqu’il s’agit de produire un grand
effet. En général plus Y accompagnement contraint a
de charmes , plus il faut craindre d’en abufer. On
n’entend que trop aujourd’hui de ces batteries infi-
gnifiantes qui, n’ayant rien à exprimer,ne fontplus
qu’un vain bruit. Si les paroles ne vous offrent point
d’expreffion déterminée , contentez-vous d’y faire
un chant gracieux , & de les accompagner Amplement
; mais j’avoue qu’un beau chant efl moins facile
à trouver qu’un arpège.
Que vos violes chargées de la partie intermédiaire
fiiivent la marche de la baffe ; ne les employez
même que pour remplir l’harmonie lorfque
cela efl néceffaire ; fouvent elles fervent avec fuccès
a renforcer l’exprefïion des féconds violons.
Ne prodiguez pas les inflruments à vent* Les
cors , les hautbois doivent être réfervés pour les
coups de force ; pour les oppobtiens des forte au
piano ; pour remplir , par ^quelques traits de chant,
les intervalles de la voix pour former de ces tenues
qui lient l’harmonie, lorfque le relie de l’orcheflre
ne rend que des fons pinces ou détachés.
Soyez encore plus fobre du baffon. Autrefois
dans l’ancienne mufique françoife, on écrivoit pref-
que toujours pour cet infiniment une partie féparée;
mais comme il ne donne guère, dans fon diapafon
ordinaire , que des fons graves & fourds, cette partie
intermédiaire ne pouvoit être qu’un rempliffage
i le plus fouvent confus. Aujourd’hui que les françois
ont modelé leur flyle fur celui de l’Italie, on ne fait
plus faire au baffon que la partie de la baffe, excepté
dans les morceaux à infiniment obligé, ou on
1 emploie quelquefois comme moyen d’exprefîion,
ou pour fervir de baffe aux hautbois récitants^
Ce que j’ai dit en général des inflruments à vent,
je le dirai des flûtes, des clarinettes , des trom-
boni, Sec. On en peut faire un ufage heureux dans
quelques peintures, mais il faut en être avare comme
rempliffage , & fe rappeller que Pergoleze & les
compofiteurs de fon tems faifoient beaucoup d’effet
fans tous ces moyens. .
Il devreit être fuperfîu de répéter ce confeil pour
les trompettes & les timballes : ces inflruments ne
femblent faits que pour accompagner des marches ,
pour exprimer des combats. Cependant la manie de
produire des effets efl devenue fi grande & les
moyens fi bornés, qu’on ne fait prefque plus d^opéra
fans timballes & fans trompettes. On en a mis juf-
que dans des airs de bergers. ( M. Framery.')
A ccompagnement , A ccompagner. Ces
deux mots font du nombre de ceux qui font le
mieux fentir combien le langage de la mufique efl
encore vague & imparfait. Nous aurons fouvent oc-
cafion de faire remarquer ce défaut .de precifion
dans des termes qu’on emploie fouvent fans s en
rendre compte * & dont l’acception mal entendue
ne laiffe dans l’efprit que des notions incomplettes
ou confufes , ce qui nuit beaucoup plus qu’on ne le
croit aux progrès de l’art. On jugera toujours mal
d’nn art, lorfqu’on ne faufa ni apprécier les moyens
divers dont il fe fe r t, ni difeuter les principes de
fes effets les plus intéreffants ; & l’artifle perdra un
grand mobile d’encouragement & de lumière ,
lorfque le jugement de fes ouvrages ne fera fournis
qu’à l’inflinét aveugle d’un public ignorant, ou , ce
qui efl encore pis , aux idées vagues ou fauffes des
demi-connoiffeurs. Quelques obfervations fur l’abus
que de bons efprits ont fait quelquefois du mot
accompagnement, vont fervir à éclaircir & à juflifier
nos plaintes à cet égard.
On trouve dans le fupplément de l’encyclopédie,
un article accompagnement, écrit par un excellent littérateur
qui n’a point étudié la mufique. Nous n’avons
pas cru devoir réimprimer ici cet article , parce que
les principes qui y font développés nous ont paru
plus propres à répandre des nuages que des lumières
fur le fujet qui y efl traité, i
Cet écrivain regarde d’abord le concours des inf-
trumenis avec la voix rccmme une des plus grandes
licences que l.i mufique s'efl données : il cherche en-
fuite une hypothèfe qui explique cette grande licence
, & il en trouve le principe dans la nature.
• Quel efl ce principe ? C ’efl la réfonnance du corps
fbnore. On fait que chaque , fon efl accompagné
d’autres fons qui forment enfemble un accord. “ Le
52 premier modèle de Y accompagnement efl donc ce
»5 compofé harmonieux , & fa première règle efl
»5 d’imiter l’accord donné par la nature T elle efl
la théorie de l’auteur.
Tout cela avoit déjà été avancé par Rameau,
mais d’une manière plus générale. Ce grand théo-
rifle ayant fondé tout fon fyflêmé d’harmonie fur
la réfonnance du corps fonore , : s’étoit tellement
pafïionnè pour ce phénomène phyfique , qu’il finit
par le regarder comme le principe même des mathématiques
, & comme le fymbole d’un des plus
augufles myflères de notre religion. Dans un écrit,
intitulé Erreurs fur la. mufique , ouvrage de fa vieil-
leffe , où il entroit beaucoup d’humeur contre J. J.
Rouffeau , il avança que Y accompagnement repré-
fentoit le corps fonore. J. J. Rouffeau lui répondit
dans une autre brochure où il réfuta vieforieufe-
ment cette affertion ; & ce triomphe étoit facile.
Pour peu qu’on ait les premières notions de l’harmonie
, on voit évidemment que cette idée n’efl
pas feutenable , & il n’y a que l’ignorance de ces
notions élémentaires qui puiffe faire répéter une
hypothèfe fi gratuite , dont on ne pourroit tirer aucun
réfultat ; utile , quand même elle feroit fondée.
Nous nous difpenferons de faire ici un étalage de ]
çonnoiffances muficales , qui feroient fuperflues j
pour les perfonnes infimités, & inutiles à celles |
qui ne le font pas ; il nous fufïit de dire que l’harmonie
a été pratiquée avant qu’on eût découvert
la réfonnance du corps fonore, & que fi l ’on
avoit pris ce phénomène pour guide dans les premiers
accompagnements , il auroit exclus de l'harmonie
non-feulement toute diffonance , mais même
le mode mineur , qui efl cependant aufli naturel &
a été aufli en ufage que le majeur dans notre ancienne
mufique d’églife , à laquelle nous devons la
confervation & les progrès de l’art.
L’auteur de l’article dont nous avons parlé', explique
aufli la grande licence de Y accompagnement,
par une efpèce de fiélion poétique, qui n’efl pas
aifée à comprendre. Une hypothèfe métaphyfique,
quelque ingénieufe qu’elle puiffe être, ne paroît pas
bien propre à répandre du jour fur l’hifloire & les
procédés de la mufique. Dans cet a r t , comme dans
tous les autres , ce n’efl qu’en tâtonnant & par degrés
qu’on efl arrivé aux plus belles découvertes.
Nous croyons que pour expliquer l’origine & le
principe de Y accompagnement, il efl plus fimple &
plus fur de rechercher quels en ont été les premiers
effais & les progrès fucceflifs.
Les peuples les plus grofliers ont chanté & ont
eu des inflruments de mufique : il étoit naturel
qu’ils exécutaffent fur cês inflruments, en même
tems qu’avec les v o ix , les chants fimples que leur
infpiroit la nature.
Les hébreux chantoie-nt leurs hymnes & leurs
cantiques en s’accompagnant de divers inflruments,
& ils en avoient un très-grand nombre. Voyez l'article
Hébreux ( mufique des \
Le même ufage étoit commun chez les Grecs.
Demonocus & Phémius dans Homere , Jolas dans
Virg ile , font repréfentés comme des efpëces de
Bardes qui chantoient leurs vers en s’accompagnant
de la lyre.
« Pourquoi, dit Ari Ilote dans un de fes pro-
53 blêmes, une chanfon nous fait-elle plus de plaifir
35 accompagnée de la flûte que de la lyre ? Èfl-ce
33 que le doux mêlé au doux en devient plus
33 agréable ? ou feroit-ce que le fon de la flûte a plus
33 d’analogie avec la voix humaine »3 ?
On fent que le poète qui chantoit fes vers jie
pouvoit £ accompagner lui-même qu’avec un i nflru-.
ment à cordes, & qu’il falloit un autre muficien
pour Y accompagner deYa flûte. Il paroît que les grecs
ne connoiffoient pas l’ufage Raccompagner le chant
par un grand nombre d’inflruments à là fois. ctPour-
33 quoi, dit encore Ariflote dans un autre problème,
33 aimons-nous mieux entendre une chanfon accom-
33 pagnée d’une feule flûte ou d’une feule lyre , que
33 de plufieurs inflruments >î ? -
Les romains imitèrent- les grecs dans l’ufage
d’unir au chant de la voix le fon des inflruments. fis
eurent .même des orateurs qui fe faifoient accompagner
d’une flûte pendant qu’ils haranguoient, fans
doute pour diriger ou fouteriir leur voix ; pour la ramener
à fes tons naturels, lorfque la chaleur de
l’aélion l ’eu écartoit,