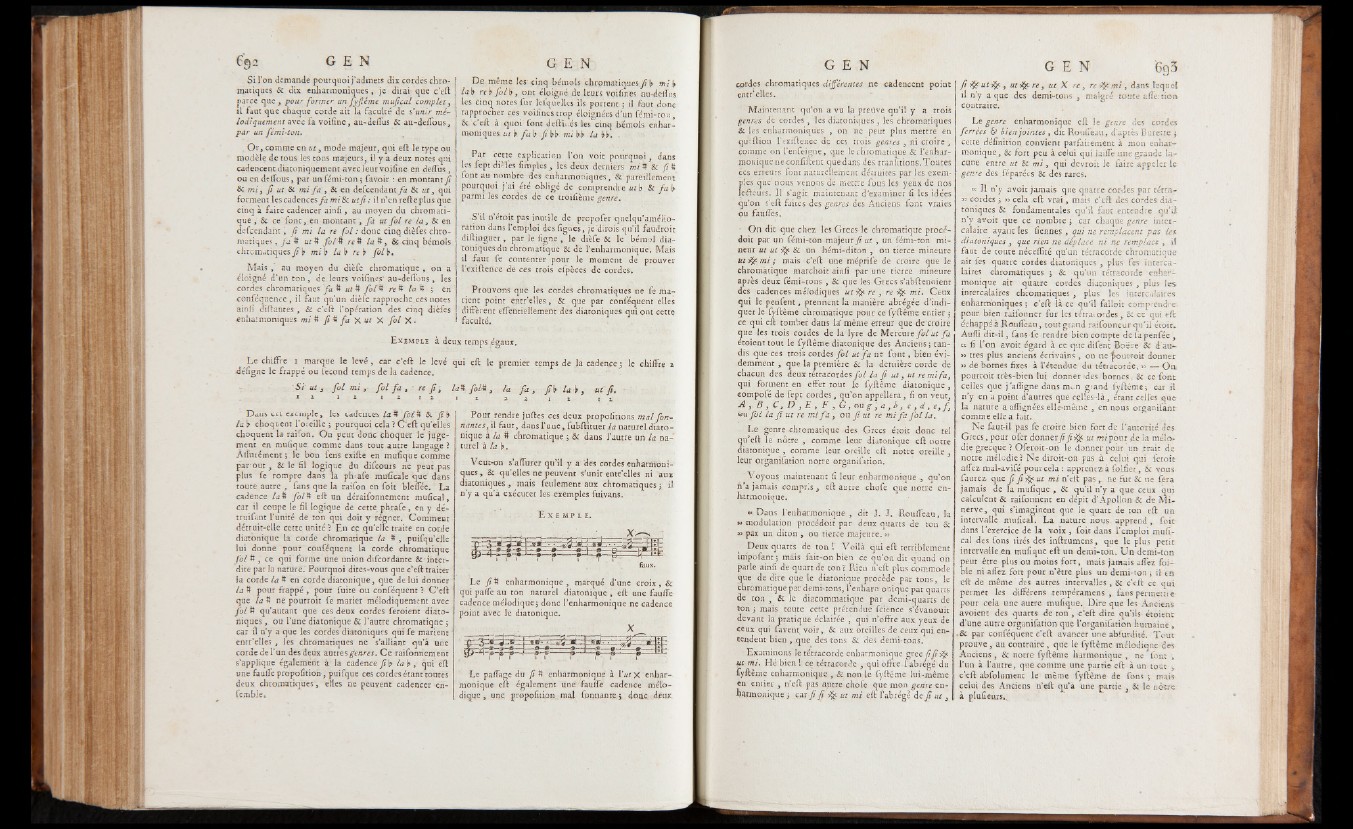
€ § 2 G E N
. Si l’on demande pourquoi j’admets dix cordés chromatiques
& dix enharmoniques, je dirai que c’eft
parce que , pour former un fyfiême mufical complet ,
il faut que chaque corde ait la faculté de s’unir mé-
lodiquement avec fa voifine, au-deflus &: au-deffous,
par un fémi-ton.
. O r , comme en ut, mode majeur, qui eft le type ou
modèle de tous les tons majeurs, il y a deux notes qui
cadencent diatoniquement avec leur voifine en delfus ,
ou en delfous, par un fémi-ton s favqir : en montant fi
& mi, f i ut & mi fa y & en defeendant/a & ut 3 qui
forment les cadences fa mi & utfi ; il n’en refte plus que
cinq à faire cadencer ainfî, au moyen du chromatiq
u e , & c e 'fo n t , èn montant, f d ut fo l re la, & en
defçendant \ f i mi la re fo l : donc cinq dièfes chromatiques,
f'a # ut# fo l * re# la # , & cinq bémols
chromatiques f i b mi b la b re b folb.
Mais , au moyen du dièfe chromatique , on a
éloigné d’ un to n , de leurs voifînes' au-defîbus, les
cordes chromatiques yà # ut # fol# re# /a# ; en
conféquence , il faut qu’un dièfe rapproche ces notes
ainfî diftantes , & c’eft l’opération des cinq dièfes
«enharmoniques mi # f i # fa X ut X fo l X .
G E N
De même les cinq bémols chromatiques yf b mi b
la]} reb fo lb , ont éloigné de leurs voifir.es au-deifus
les cinq notes fur lèlquellcs ils portent ; il faut donc
rapprocher ces voifincs trop éloignées d’un fémi-ton,
& c eft à quoi font deftii.és les cinq bémols enharmoniques
ui b fa b .f i b b mi bb la bb. .
Par cette explication l'on voit pourquoi, dans
les fept dièfes fimples, les deux derniers mi'# & fi#
font au nombre des enharmoniques , & pareillement
pourquoi j ’ai été obligé de comprendre ut b & fa b
parmi les cordes de ce troifième genre.
•S’il n’etoit pas inutile de propofer quclqu’améiio-
ration dans l’emploi des lignes, je dirois qu’il faudroit
diftinguer, par le figne , le dièfe & le bémol diatoniques
du chromatique & de l’enharmonique. Mais
il faut fe contenter pour le moment de prouver
l'exiftence de ces trois efpèces de cordes.
Prouvons que les cordes chromatiques ne fe marient
point entr’elles , & que par conféquent elles
diffèrent elfentieltement des diatoniques qui ont cette
faculté. ' . ■ ,
Exemple à deux temps .égaux.
Le chiffre 1 marque le le v é , car c ’eft le levé qui çft le premier temps de la cadence; le chiffre a
défigne le frappé ou fécond temps de la cadence.
' Si ut , fo l mi y fo l fa , re f i ;
I i - I Z I X I .2,
Dans cet exemple, les cadences /a# fol# & f i b
la b choquent l’oreille j pourquoi cela? C 'e ft quelles
choquent la raifon. On peut donc choquer le jugement
en mufique comme dans tout autre langage ?
Alfurécnent ; le bon fens exifte en mufique comme
p a rou t , & le fil logique du difeours ne peut pas
plus fe rompre dans la p'hiafe mnficale que' dans
toute autre , fans que la raifon en fôit blefTée. La
cadence /a# fol# eft un déraifonnement mufical,
car il coupe le fil logique de cette ph.rafe, en y dé-
truifant l’unité de ton qui doit y régner. Comment
détruit-elle cette unité ? En cç qu’elle traire en corde
diatonique la corde chromatique la # , puifqu’clle
lui donne pour conféquent la corde chromatique
fo l # , ce qai forme une union difcordance & ' interdite
par la nature. Pourquoi dites-vous que c’eft traiter
la corde la # en corde d iatonique, que de lui donner
la # pour frappé , pour fuite ou conféquent ? C ’eft
que la # ne pourroit fe marier mélodiquement avec
fo l # qu’autant que ces deux cordes feroient diatoniques
,. ou l’une diatonique & l’autre chromatique ;
car fl n’y a que les cordes diatoniques qui fe marient
entr’elles , les chromatiques ne s’alliant qu’à une
corde de l’un des deux autres genres. C e raifonhement
s’applique également à la cadence y# b la b , qui eft
une fauffe p ropofîtion, puifque ces cordes étant toutes
deux chromatiques, elles ne peuvent cadencer en-
fembje«.
la# fol# * la fa y f i b la b , ut fi,
1 z . x -X 1 x - "j, r- ' ;
Pour rendre juftes ces deux propofîtions mal fon-
nantes, il faut, dans l’une, fubftituer la naturel diatonique
à la # chromatique ; & dans l’autre un la naturel
à la b.
Veut-on s’afTurer qu’il y a dés cordes enharmoniques
, & qu’elles ne peuvent sfonir entr’elles ni aux
diatoniques, mais feulement aux chromatiques ; il
\ n’y a qu’à exécuter les exemples fuivans.
E x e m p l e .
Le f i # enharmonique , marqué d’une croix , &
qui paffe au ton naturel diatonique , eft une fauffe
cadence mélodique; donc l’enharmonique ne cadence
point avec le diatonique.
X
Ç S —■A— f*—-J— » —s --------- *— ©.— ®.—— —0— - f i t
. r 1 1 1 >• * .. 1 1' 1. ■ 1 - i-
Le pafTage du fi # enharmonique à Y ut X enharmonique
eft également unëTaulTe cadence mélodique,
une: propofition. mal formante; donc, deux
G E N G E N 6g 3
eprdes chromatiques différentes ne cadencent point
entr’elles.
Maintenant qu’on a vu la preuve qu’il y a trois
genres de cordes, les diatoniques, les chromatiques
& les enharmoniques , on ne peut plus mettre en
queftion l'exiftence de ces trois genres , ni croire ,
comme on l’en feigne, que le chromatique & l'enharmonique
ne confident quedans des transitions. Toutes
ces erreurs four naturellement détruites par les exemples
que nous venons de mettre fous les yeux de nos
Ie&eürs. II s’agit maintenant d ’examiner fi les idées
qu’on s’eft faites des genres des Anciens font vraies
ou faufTes.
• On dit que chez les Grecs le chromatique procé-
doit par un fémi-ton majeur f i u t , un fémi-ton mineur
ut ut c & un hémi-diton , ou tierce mineure
lu mi ; mais c’eft une méprife de croire que le
chromatique marchoit ainfî par une tierce mineure
après deux fémi-tons , & que les Grecs s’abftenoient
des cadences mélodiques ut-fy re , re mi. Ceux
qui le penfent, prennent la manière abrégée d’indiquer
le fyftême chromatique pour ce fyftême entier ;
ce qui eft. tomber dans la' même erreur que de croire
que les trois cordes de la lyre de Mercure fo l ut fa
étoienttout le fyftême diatonique des Anciens; tandis
que ces trois cordes fo l ut fa ne font » bien évidemment
, que la première & la dernière corde de
chacun des deux tetracordes fo l la f i ut, ut re mifat
qui forment en effet toüt le fyftême diatonique ,
compofé de fept cordes, qu’on appellera, fi on veut,
A 3 B y C y D 3 E y F y G y OU g y a 3b 3 C y d y e3fy
ou fo l la f i ut re mi fa , ou f i ut re mi fa fo l la.
L e genre chromatique des Grecs étoit donc tel
qu’eft le nôtre , comme leur diatonique eft notre
diatonique , comme leur oreille eft notre oreille ,
leur organifation notre organifation.
“Voyons maintenant fi leur enharmonique , qu’on
n ’a jamais compris , eft autre chofe que notre enharmonique.
« Dans l’enharmonique , dit J. J. Roufleau, la
*> modulation procédoir par deux quarts de ton &
» par un diton , ou tierce majeure. «
Deux quarts de ton I V o ilà qui eft terriblement
impofant 3 mais fait-on bien ce qu’on dit quand on
parle ainfî de quart de ton? Rien n’cft plus commode
que de dire qu.e le diatonique procède par ton s, le
chromatique par demi-tons, l'enharn onique par quarts
de ton , & le diacommatique par demi-quarts de
ton ; mais toute cette prétendue feiènee s’évanouit
devant la pratique éclairée , qui n’offre aux. yeux de
ceux qui favent v o ir , & aux oreilles de ceux qui.entendent
bien , que des tons & des de mi-tons.
Examinons letétracorde enharmonique grec fifify
Ut mi. Hé bien 1 ce té tra cordé. , qui o ffre .f abrégé du
fyftême enharmonique , & non le fyftême lui-même
en entier , n’eft pas autre chofe que mon genre enharmonique
; car f i f i fy-ut mi eft f abrégé de f i ut ,
f i >>£ ut 3 uffy re, ut X re 3 re j$c m i, dans lequel
il n’y a que des demi-tons , malgré toute affe. tioiv
contraire.
Le genre enharmonique eft le genre des cordes
ferrées & bien jointes, dit Rondeau, d’après Burette ;
cette définition convient parfairement à mon enharmonique,
& fort peu à celui qui laifi'e une grande lacune
entre ut & mi , qui devroit le faire appeler le
genre des féparées & des rares.
« J1 n’y avoir jamais que quatre cordes par tétra-
35 cordes ; 33 cela eft v r a i, mais c’eft des cordes diatoniques
& fondamentales qu’il faut entendre qu’il
n’y avoir que ce nombre ; car chaque genre interr-
cal aire ayant les. fi entres , qui ne remplacent pas les
diatoniques y que rien ne déplace ni ne remplace , il
faut de toute néceffité qu’un técracorde chromatique
ait les quatre cordes diatoniques, plus fes intercalaires
chromatiques ; & qu’un tétracordc enharmonique
ait quatre cordes diatoniques , plus les
intercalaires chromatiques, plus les intercalaires
enharmoniques ; c ’eft là ce qu’il falloir comprendre-
pour bien roifonner fur les té tra» ordes y & ce qui eft
échappé à Roufièau, tout grand raifonneur qu’il étoit..
AufG d it- il, fans fë rendre bien compte de l'apenfée,
ce fi l’on avoit égard à ce que difent Boëce & d'au-
33 tres plus anciens écrivains , on ne pourroit donner
33 de bornes fixes à l’ étendue du tétracorde. 33 — O a
pourroit très-bien lui donner -des bornes, & ce font
celles que j ’afligne dans mon giand fyftême; car il
n’y en a point d’autres que celles -là, érant ceires que
la nature a aflîgnéës elle-même , en. nous organifant
comme elle a faft.
N e faut-il pas fe croire bien fort de l’autorité des
Grecs, pour ofer donner y? fiify ut 772/ pour de la mélodie
grecque ? Oferoit-on le donner pour un trait de
notre mélodie? N e diroit-on pas à celui qui feroit
alfez mal-avifé pour cela : apprenez à Coiffer, & vous
faurez que f i f i fy ut mi n’eft pas ne fut & ne fera
jamais de la mufique , & qu’il n’y a que ceux qui
calculent & raifonnent en dépit d’Apollon & de M inerve,
qui s’imaginent que le quart de ton eft un
intervalle mufical. L a nature nous apprend, foie
dans l ’exercice de la voix , foie dans l’emploi mufical
des fons tirés des inftrumens, que le plus petit
intervalle en mufique eft un demi-ton. U n demi-ton
peut être plus ou moins fo r t , mais jamais allez foi-
ble ni affez fort pour n’être plus un demi-ton ; il en
eft de même des autres intervalles , & c’eft ce qui
permet les différens -tempéramens , fans pertnettie
pour cela une autre mufique. Dire que les Anciens
avoient des quarts de ton , c ’eft dire qulils- étoient
d’une autre organifation que l’organifation humaine,
.& par conféquent c’eft avancer une abfurdi té. T ou t
prouve, au contraire , que le fyftême mélodique des
Anc iens, & notre fyftême harmonique , ne font ,
l’un à l’autre, que comme une partie eft à un tout ,
c’eft abfolument le même fyftême de fons ; mais-
celui des Anciens n’eft qu’ à une partie , & le nôtre
à pluûeurs.