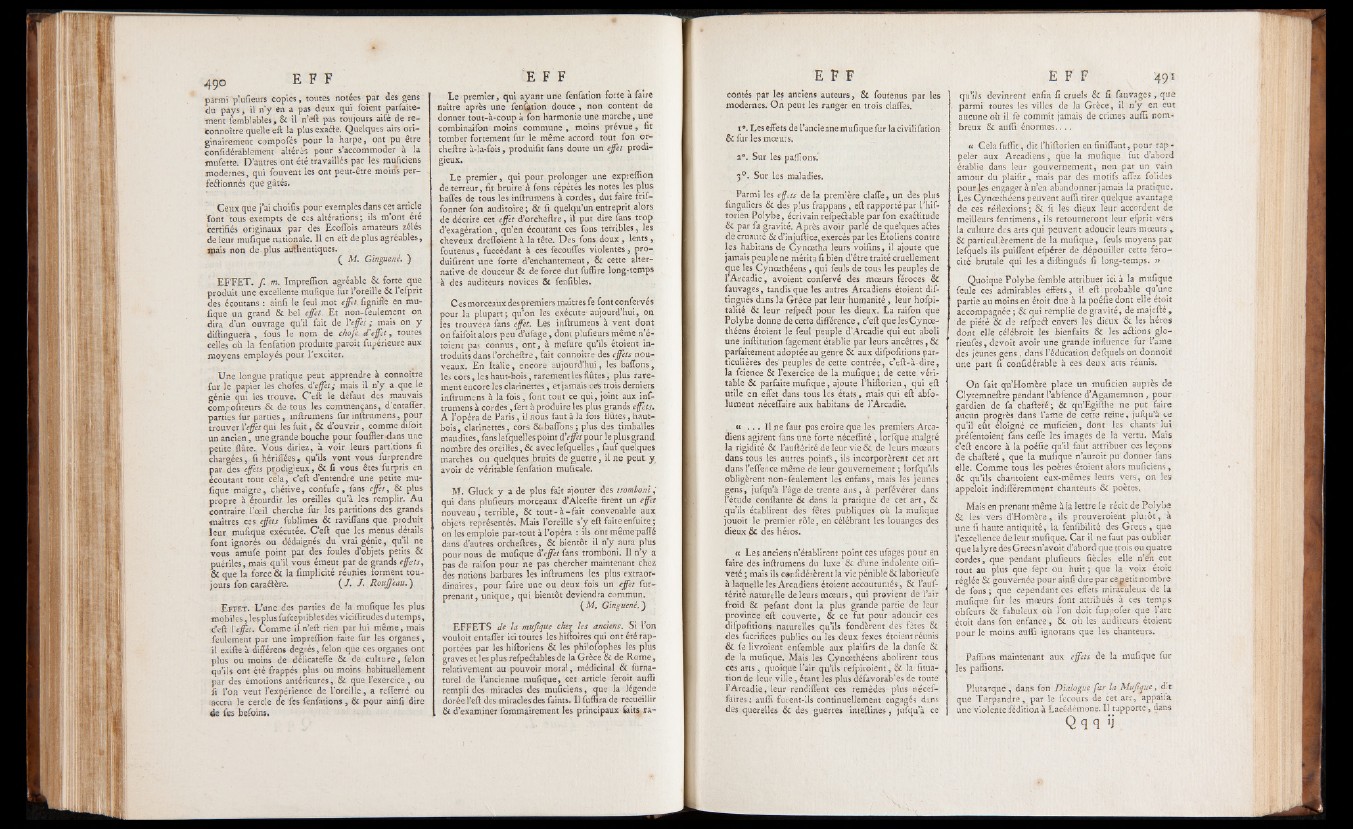
parmi"'plufieurs copies, toutes notées par des gens
du pays, il n'y en a pas deux qui foient parfaite«*
ment femblables, & il n’eft pas toujours aifé de re-
fconnoître quelle eft la plus exaéle. Quelques airs originairement
compofés pour la harpe, ont pu^etre
confidérablemerit altérés pour s’accommoder a la
mufette. D ’autres ont été travaillés par les muficiens
modernes, qui fouvent les ont peut-être inouïs perfectionnés
que gâtés.
Ceux que j’ai choifis pour exemples dans cet article
font tous exempts de ces altérations ; ils m’ont été
certifiés originaux par des Ecoffois amateurs zélés
de leur mufique nationale. 11 en eft de plus agréables,
mais non de plus aifthentiques.
( M . Ginguené. )
EFFET, ƒ. m. Impreflion agréable & forte que
produit une excellente mufique fur l’oreille & l’efprit
des écoutans : ainfi le feul mot effet, fignifîe en mufique
un grand & bel Et non-feulement on
dira d’un ouvrage qu’il fait de Y effet ,■ mais on y
diftinguera , fous le nom de chojk d ’e ffe t, toutes
celles ou la fenfation produite paroit fupérieure aux
moyens employés pour l ’exciter.
Une longue pratique peut apprendre à connoître
fur le papier les chofes. d’effet; mais il n’y a que le
génie qui les trouve. C ’tft le défaut des mauvais
compofiteurs & de tous les commençans, d’entaffer.
parties fur parties, inftrumens fur inftrumens, pour
trouver X effet qui les fuit, & d’ouvrir, comme difoit
un ancien, une grande bouche pour fouiller-dans une
petite flûte. Vous diriez, à voir leurs partitions fi
chargées, fi hériffées, qu’ils vont vous furprendre
par des effets prodigieux, & fi vous êtes furpris en
écoutant tout cela, c’eft d’entendre une petite mufique
maigre, chétive, confufe, fans effe t, & plus
propre à étourdir les oreilles qu’à les remplir. Au
contraire l’oeil cherche fur les partitions des grands
maîtres ces effets fublimes & raviffans que produit
leur mufique exécutée. C ’eft que les menus détails
font ignorés ou dédaignés du vrai génie, qu’il ne
vous amufe point par des foules d’objets petits &
puériles, mais qu’il vous émeut par de grands e ffets,
& que la force & la fimplicité réunies forment toujours
fon caraétère. ( / . J- Rouffeau. )
Effet. L’unedes parties de la mufique les plus
mobiles, les plus fufcept ibleS des viciflitudes du temps,
c’eft Xeffet. Comme il.n’eft rien par lui même, mais
feulement par une impreflion faite fur les organes,
il exifte à différens degrés, félon que ces organes ont
plus ou moins de delicateffe & de culture, félon
qu’ils ont été frappés plus ou moins habituellement
par des émotions antérieures, & que l’exercice , ou
fi l’on veut l’expérience de l’oreille, a reflerré ou
*accru le cercle de fes fenfations, & pour ainfi dire
de fes befoins.
Le premier, qui ayant une fenfation forte à faire
naître après une fenfotion douce , non content de
donner tout-à-coup à fon harmonie une marché, une
combinaifon moins commune , moins prévue, fit
tomber fortement fur le même accord tout fon or-
cheftre à-la-fois, produifit fans doute un effet prodigieux.
Le premier, qui pour prolonger une expreflio»
de terreur, fit bruire à fons répétés les notes les plus
baffes de tous les inftrumens à cordes, dut faire frif-
fonner fon auditoire ; & fl quelqu’un entreprit alors
de décrire cet effet d’orcheftre, il put dire fans trop
d’exagération, qu’en écoutant ces fons terribles, les
cheveux dreffoient à la tête. Des fons doux, lents ,
foütenus, fuccédant à ces fecouffes violentes, pro-
duifirent une forte d’enchantement, & cette alternative
de douceur & de force dut fuflire long-temps
à des auditeurs novices & fenfibles.
Ces morceaux des premiers maîtres fe fontconfervés
pour la plupart j qu’on les exécute* aujourd’hui, on
les trouvéra fans effet. Les inftrumens à vent dont
on faifoit alors peu d’ufage, dont plufieurs même n’é-
toient pas connus, ont, à mefure qu’ils étoient introduits
dans l’orcheftre, fait connoître des effets nouveaux.
En Italie, encore aujourd’hui, les baffons,
les cors, les haut-bois, rarement les flûtes, plus rarement
encore les clarinettes, et jamais ces trois derniers
inftrumens à la fois, font tout ce qui, joint aux inftrumens
à cordes ,fert à produire les plus grands effets.
A l’opéra de Paris, il nous faut à la fois flûtes, hautbois,
clarinettes, cors & .baffons; plus des timballes
maudites, fans lesquelles point $ effet pour le plus grand
nombre des oreilles, & avec lefquelles, fauf quelques
marches ou quelques bruits de guerre, il ne peut y
avoir de véritable fenfation mufieale.
M. Gluck y a de plus fait ajouter des trom lo n i,
qui dans plufieurs morceaux d’Alcefte firent un effet
nouveau, terrible, & tout-à-fait convenable aux
objets représentés. Mais l’oreille s’y eft faite enfuite ;
on les emploie par-tout à l’opéra : ils ont memepaffé
dans d’autres orcheftres, & bientôt il n’y aura plus
pour nous de mufique d'effet fans tromboni. Il n’y a
pas de raifon pour ne pas chercher maintenant chez
des nations barbares les inftrumens les plus extraordinaires
, pour faire une ou deux fois un effet fur-
prenant , unique, qui bientôt deviendra commun.
( M , Ginguené.y
EFFETS de la mufique cher les anciens. Si l’on
vouloit entaffer ici toutes les hiftoires qui ont été rapportées
par les hiftoriens & les philosophes les plus
graves et les plus refpeétables de la Grèce & de Rome,
relativement au pouvoir moral, médicinal & furna-
turel de l’ancienne mufique, cet article feroit aufli
rempli des miracles des muficiens, que la légende
dorée l’eft des miracles des faints. Il Suffira de recueillir
, & d’examiner Sommairement les principaux Saits racontés
par les anciens auteurs, & Soutenus par les
modernes. On peut les ranger en trois claffes.
I e. Les effets de l’ancieane mufique fur la civilifation-
& fur les moeurs.
a*. Sur les pallions.*
3°. Sur les maladies.
Parmi les effets de la première claffe, un des plus
finguliers & des plus frappans, eft rapporté par l’hif-
torien Polybe, écrivain refpeélable par fon exa&itude
& par fa gravité. Après avoir parlé de quelques aétes
de cruauté & d’injuftice, exercés par les Etoliens contre
les habitans de Cynoetha leurs voifins, il ajoute que
jamais peuple ne mérita fi bien d’être traité cruellement
que les Cynoethéens, qui feuls de tous les peuples de
l’Arcadie, avoient confervé des moeurs féroces &
fauvapes, tandis que les autres Arcadiens étoient dif-
tingues dans la Grèce par leur humanité, leur hofpi-
talité & leur refpeét pour les dieux. La raifon que
Polybe donne de cette différence, c’eft que les Cynoethéens
étoient le feul peuple d’Arcadie qui eut aboli
une inftitution fagement établie par leurs ancêtres, &
parfaitement adoptée au genre & aux difpofitions particulières
des peuples de cette contrée, c’eft-à-dire,
la fcience & l’exercice de la mufique ; de cette véritable
& parfaite mufique, ajoute l ’hiftorien, qui eft
utile en effet dans tous les états, mais qui eft abfo-
lument néceflaire aux habitans de l’Arcadie.
. « . . . Il pe faut pas croire que les premiers Arcadiens
agirent fans une forte néceflité, lorfque malgré
la rigidité & l’auftérité de leur vie & de leurs moeurs
dans tous les autres points, ils incorporèrent cet art
dans l’effence même de leur gouvernement ; lorfqu’ils
obligèrent non-feulement les enfans, mais les jeunes
gens, jufqu’à l’âge de trente ans, à perfévérer dans
l’étude confiante & dans la pratique de cet art, &
qu’ils établirent des fêtes publiques où la mufique
jouoit le premier rôle, en célébrant les louanges des
dieux $£ des héros.
« Les anciens n’établirent pointées ufages pour en
faire des inftrumens du luxe & d’une indolente oifi-
veté ; mais ils cor.fidérèrent la vie pénible & laborieufe
à laquelle les Arcadiens étoient accoutumés, & l’auf-
térité naturelle de leurs moeurs, qui provient de l’air
froid & pefant dont la plus grande partie de leur
province eft couverte, & ce fut pour adoucir ces
difpofitions naturelles qu’ils fondèrent des fêtes &
des facrifices publics ou les deux fexes étoient réunis
& fe livroient enfemble aux plaifirs de la danfe &
de la mufique. Mais les Cynoethéens abolirent tous
ces arts, quoique l’air qu’ils refpiroient, & la fitua-
tion de leur v ille, étant les plus défavorab’es de toute
l’Arcadie, leur rendiffent ces remèdes plus nécef-
faires ; auffi furent-ils continuellement engagés dans
des querelles & des. guerres inteftines , jufqu’à ce
qu’ils devinrent enfin fi cruels & fi fauvages, que
parmi toutes les villes de la Grèce, il n’y en eut
aacune où il fe commît jamais de crimes auffi nombreux
& auffi énormes.. . .
« Cela fuffit, dit l’hiftorien en finiflant, pour rappeler
aux Arcadiens, que la mufique fut d’abord
établie dans leur gouvernement, non par un vain
amour du plaifir , mais par des motifs allez folides
pour Jies engager à n’en abandonner jamais la pratique.
Les Cynoethéens peuvent auffi tirer quelque avantage
de. ces réflexions ; & fi les dieux leur accordent de
meilleurs fentimens, ils retourneront leur efprit vers
la culture des arts qui peuvent adoucir leurs moeurs y
& particulièrement de la mufique, feuls moyens par
lefquels ils puiflent efpérer de dépouiller cette férocité
brutale qui les a diftingués fi long-temps. »
Quoique Polybe femble attribuer ici à la mufique
feule ces admirables effets, il eft probable qu’une
partie au moins en étoit due à la poéfie dont elle etoic
accompagnée ; & qui remplie de gravité, de majefté,
de piété & de refpeél envers les dieux & les héros
dont elle célébroit les bienfaits & les aélions glo-
rieufes, devoit avoir une grande influence fur l’ame
des jeunes gens , dans l’éducation defquels on donnoit
une part u confidérable à ces deux arts réunis.
On fait qu’Homère place un muficien auprès de
Clytemneftre pendant l’abfence d’Agamemnon, pour
gardien de fa chafteté ; & qu’Egifthe ne put faire
aucun progrès dans l'amè de cette reine, jufqu’à ce
qu’il eût éloigné ce muficien, dont les chants* lui
préfentoient fans ceffe les images de la vertu. Mais
c’eft encore à la poéfie qu’il faut attribuer ces leçons
de chafteté, que la mufique n’auroit pu donner fans
elle. Comme tous les poètes'étoient alors muficiens,
& qu’ils chantoient eux-mêmes leurs vers, on les
■ appeloit indifféremment chanteurs & poètes,
Mais en prenant même à la lettre le récit de Polybe
& les vers d’Homère, ils prouveroient plutôt, à
une fi haute antiquité, la fenfibilité des Grecs , que
l’excellence de leur mufique. Car il ne faut pas oublier
que la lyre des Grecs n’avoit d’abord que trois ou quatre
cordes, que pendant plufieurs fiècles elle n’en eut
tout au plus que fept ou huit ; que la voix étoit
réglée & gouvernée pour ainfi dire par ce nëtit nombre
de fons ; que cependant ces effets miraculeux de la
mufique fur les moeurs font attribués à ces temps
obfcurs & fabuleux ou l’on doit fuppofer que l’art
étoit dans fon enfance, & oii les auditeurs étoient
pour le moins auffi ignorans que les chanteurs.
Paffons maintenant aux effets de la mufique fur
les paffions.
Plutarque, dans fon Dialogue fu r la Mufique, d,t
que Terpandre, par le fecours de cet art, appaifa
une violente fédition à Lacédémone. 11 rapporte, dans
Q q q