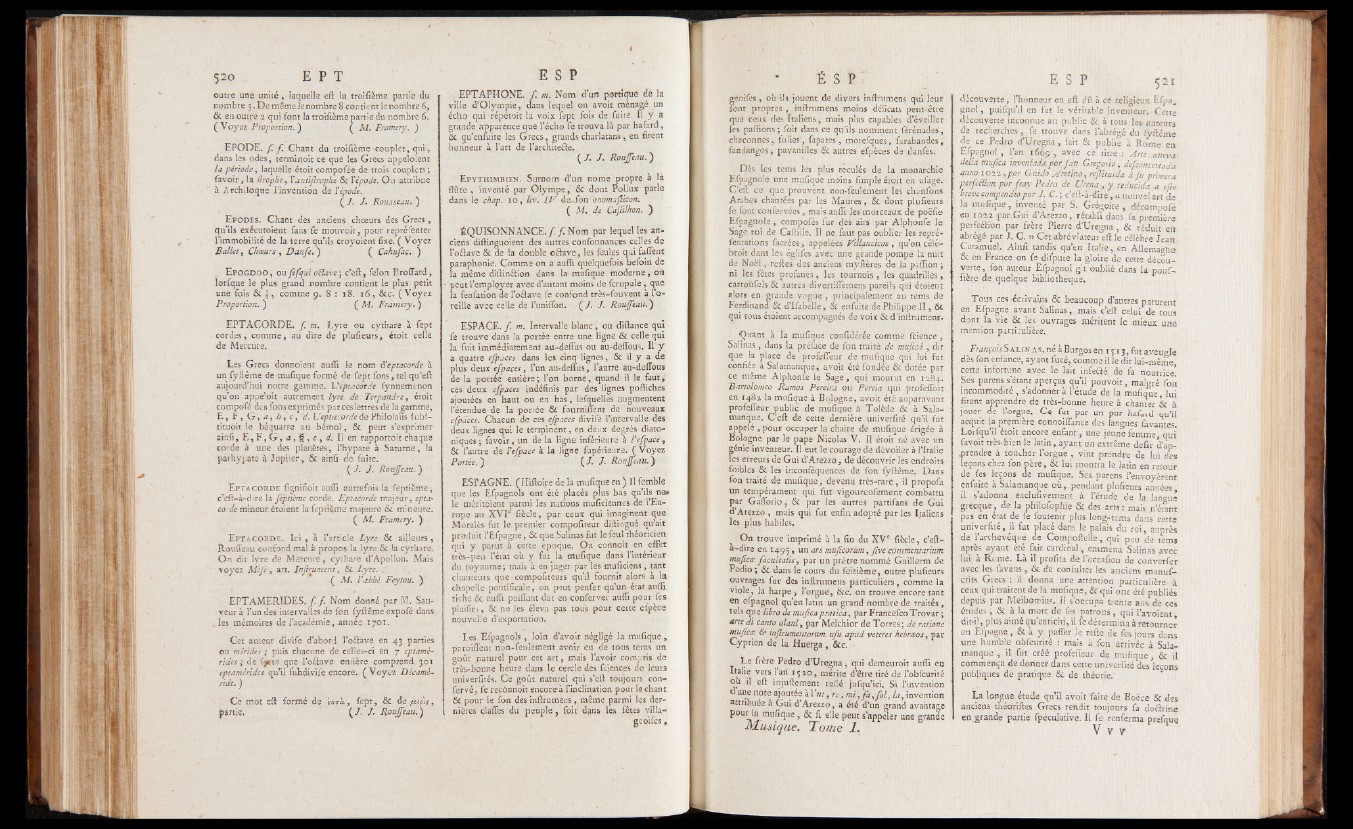
outre une u n ité , laquelle eft la troifième partie du
nombre 3. D e même le nombre 8 contit nt lenombre 6,
& en outre 2 qui font la troifième partie du nombre 6.
( V o y e z Proportion, ) ( M. Framery. )
E PO D E . f . f . Chant du troifième'couplet, qui,
dans les odes, terminoit ce que les Grecs appeloient
la période, laquelle étoit compofée de trois couplets;
fa voir , la flrop/ie, Yantijlrophe &i Xépode. O n attribue
à Archiloque l’invention de Xépode.
( J. J. Rousseau. )
E po d e s . Chant des anciens choeurs des G re c s ,
qu’ils exécutoient fans fe mouvoir, pour repréfenter
l’immobrüté de la terre qu’ils croyoient fixe. ( V o y e z
Ballet, Choeurs , Danfe.) ( Cahufaç. , )
E po g d o o , ou fifqui oElave ; c’e ft , félon Broffard,
lorfque le plus grand nombre contient le plus petit
une fois & f , comme 9» 8 : 18. 1 6 , & c . (V o y e z
Proportion. ) ( M. Framery. )
E P T A C O R D E . f . m. L y re ou cythare à fept
cord es, comme, au dire de plufieurs, étoit celle
de Mercure.
Les Grecs donnoient aufîi le nom d'eptacorde à
un fyftême de mufique formé de fept fons, tel qu’eft
aujourd’hui notre gamme. Ueptacovde fynnemenon
qu’on appel oit autrement lyre de Terpandre, étoit
compofé des fons exprimés par ces lettres de la gammé,
E , F , G , a -, b , c , d. Veptacorde de Philolaüs fubf-
tituoit le béquarre au bém o l, & peut s’exprimer
ainfi, E , F , G , a , , c , d. Il en rapportoit chaque
corde à une des planètes, l’hypate à Saturne, la
parhypate à Jupiter, & ainfi de fuite.
( J. J. Rouffeau. )
E p t a c o r d e fignifioit aufli autrefois la feptième,
c’eft-à-dire là feptième corde. Eptacorde majeur, eptacorde
mineur, étoient la feptième majeure & mineure.
( M. Framery. )
E p t a c o r d e . I c i , à l’ article Lyre & ailleurs,
Rouffeau confond mal à propos la ly re & la cythare,
O n dit lyre de Mercure, cythare d’Apollon. Mais
v o y e z Mèfe, art. Inflrument, & Lyre, d
( M. l ’abbé Feytou. ) '
E P T AM E R ID E S . f . f . Nom donné par M. Sauveur
à l’un des intervalles de fon fyftême expofé dans
l'es mémoires de l’académie, année 170 1 .
Ce t auteur divife d’abord l’oélave en 43 parties
ou mer ides ; puis chacune de celles-ci en 7 eptamé-
rides ; de fgsrte que l’o â a v e entière comprend 301
eptamérides qu’il fubdivife encore, f V o y e z Décamé-r
ride. )
C e mot eft formé de b r r» , fep t , & de /uep)s,
partie. ( / . / . Rouffèau.)
E P T A PH O N E , f . m. Nom d’un portique de la
ville d’O lym p ie , dans lequel on avoit ménagé un
écho qui -répétoit la vo ix fept fois de fuite. Il y a
grande apparence que l’écho fe trouva là par hafard,
6c qu’enfuite les G re c s , grands charlatans, en firent
honneur à l’art de l’architeéle.
( J. J. Roujfedu. )
E p y th im b ien . Surnom d’un nome propre à la
flûte , inventé par O lym p e , & dont Pollux parle
dans le chap. 1 0 , liv. I V de~fon onomajlicon.
( M. de Cajlilhon. )
É Q U ISO N N A N C E . ƒ. ƒ Nom par lequel les anciens
diftinguoient des autres confonnances celles de
l’oéfave & de la double oêlave, les feules qui faffent
paraphonie. Comme on a aufîi quelquefois befoin de
la même diftinélion dans la mufique moderne, on
peut l’emplpyer avec d’autant moins de fcrupule, que
la fenfation de l’oêlave fe confond très-fouvent à l’o reille
avec celle de l’uniflbn. ( J. J. Rouffeau. )
E SPA C E , f . m. Intervalle blanc ou diftance qui
f e trouve dans la portée entre une ligné & celle qui
la fuit immédiatement au-deffus ou au-defïbus. Il y
a quatre efpaces dans les cinq lignes, & il y a de
plus deux efpaces , l’un au-deffus, l’autre au-deffous
de la portée entière ; l’on borne, quand il le faut,
ces deux efpaces indéfinis par des lignes pofîiches
ajoutées en haut ou en b a s , lefquelles augmentent
l’étendue de la portée & fourniffent de nouveaux
efpaces. Chacun de ces efpaces divife l’intervalle des
deux lignes qui le terminent, en deux degrés diatoniques
; fa voir , un de la ligne inférieure à l’efpace ,
& l’autre de l’efpace à la ligne fupérieure. (V o y e z
Portée. ) ( J. J. Rouffeau. )
ESPA GN E . ( Hiftoire de la mufique en ) Il femble
que les Efpagnôls ont été placés plus bas qu’ils ne*
le méritoient parmi les nations muficiennes de l’Europe
au X V I e fiècle, par ceux qui imaginent que
Moralès fut le premier compofiteur diftingué qu’ait
produit l’Efpagne, & que Salinas fut le feul théoricien
qui y parut à cette époque. O n connoît en effet
très-péu- l’ état où y fut la mufique dans l’intérieur
du royaume; mais à en juger par les muficiens, tant
chanteurs que compofiteurs qu’il fournit alors à la
chapelle pontificale, on peut penfer qu’un état aufîi
riche & aufîi puiffant dut en conferver aufîi pour fes
plaifirs, & ne les éleva pas tous pour cette efpèce
nouvelle d’exportation.
Les Efpagnôls, loin d’avoir négligé la mufique,
paroiffent non-feulement avoir eu de tous tems un
goût naturel pour cet a r t , mais lavoir compris de
très-bonne heure dans le cercle des fciences de leurs
universités. C e goût naturel qui s’eft toujours con-
fe rvé , fe recônnoît encore à l’inclination pourléchant
& pour le fon des inflrumens, même parmi les dernières
çlafïes du p eu p le , foii! dçtns les fêtes villa -
g eo ifes ,
geoifes, où ils jouent de divers inflrumens qui leur
font propres , inflrumens moins délicats peut-être
que ceux des Italiens, mais plus capables d’éveiller
les pallions ; foit dans ce qu’ils nomment férénades.,
chaconnes, folie s, fapates , morefques, farabandes,
fandangos, pavanilles & autres efpèces de danfes.
Dès les tems les plus reculés de la monarchie
Efpagnole une mufique moins fimple étoit en ufage./
C ’efl ce que prouvent non-feulement les chanfons
Arabes chantées par les Mau res, & dont plufieurs
fe font confervées, mais aufîi les morceaux de poëfie
Efpagnole, compofés fur des airs par Alphonfe le
Sage roi de Caflille. Il ne faut pas oublier les repré-
fentations facrées , appelées Villancicos , qu’on célé—
broit dans les églifes avec une grande pompe la nuit
de N o ë l, refies des anciens myflères de la pafïion ;
ni les fêtes profanes, les tournois , les quadrilles,
carroufels & autres divertifiemens pareils qui étoient
alors en grande vogue , principalement au tems de
Ferdinand & d’Ifabelle, & enfuite de Philippe I I , 6c
qui tous étoient accompagnés de vo ix & d ’inflrumens.
<^uant à la mufique confidérée comme fcience,
Salinas, dans la préface de fon traité de muficâ , dit
que la place de -pro&ffeur de mufique qui lui fut
confiée à Salamanque j avoit été fondée & dotée par
ce même Alphonfe ie S a g e , qui mourut en 1284.
Bartolomeo Ramos Pereira ou Pereia qui profeffoit
en 1482 la mufique à Bologne, avoit été auparavant
profeffeur public de mufique à Tolède & à Salamanque.
C ’efl de cette dernière univerfité qu’il fut
appelé, pour occuper la chaire de mufique érigée à
Bologne par le pape Nicolas V . Il étoit né avec un
génie inventeur. Il eut le courage de dévoiler à l’Italie
les erreurs de G ui d’A re z zo , de découvrir les endroits
foibles & lés inconféquences de fon fyftême. Dans
fon traité de mufique, devenu très-rare, il propofa
un tempérament qui fut vigoureufement combattu
par Gafforio, & par les autres partifans de Gui
d’Arezzo , mais qui fut enfin adopté par les Italiens
les plus habiles.
On trouve imprimé à la fin du X V e fiècle, c’efl-
a-dire en 1495 » un ars uiufîcorum, five commentarium
muficot facultatis, par un prêtre nommé Guiderai de
Podio; & dans le cours du feizième, outre plufieurs
ouvrages fur des inflrumens particuliers, comme la
v io le , la ha rpe, l’orgue, &c. on trouve encore tant
en efpagnol qu’en latin un grand nombre de traités,
tels que libro de mujicapratica, par Francefco Trovar ;
arte di canto olanl, par Melchior de T orres; de ratione
muficez 6 » inflrumentorum ufu apud veteres hebrceos, par
Cyprien de la Huerga, & c . I
Italie vers l’an 15 2,0, mérite d’être tiré de l’obfcurit
ou fi eft injuftement refié jufqu’ici. Si l’inventioi
d une note ajoutée à l ’ut, re 1 mi, fa , fol, la, inventioi
attribuée a G ui d’Arez zo, a été d’un grand avantag
Pou^® mu^ ue s & fi elle peut s’appeler une grand Musique. Tome 1,
découverte, l’honneur en eft dû à ce religieux Elpa;
g n o l, puisqu'il en fut le véritable inventeur. Cette
découverte inconnue au public & à tous les auteurs
d e . recherches , fe trouve dans l’abrégé du fyftême
de ce .Pedro d’U regn a, fait & publié à Rome en
E fp agn o l, l’an 166.9-, avec ce titre : A n e nueva
délia mujîca invcntada fo r Jan Gregorio , defconcertada.
anno 1022 , fo r Guido Aretino, rejlituida à fu. primera
perfection por fray Pedro de Urena , y reducida a elle
brève compendia por J. C. ; c’eft-à-dire, <1 nouvel art de
la mufique , inventé par S. Grégoire , déesmpofé '
en J022 par.Gui d’A re z zo , rétabli dans fa première
perfeâion par frère Pierre d’Uregna , & réduit en
abrégé par J. C . n C e t abré viateur eft le célèbre Jean
Caramuel. Ainfi tandis qu’ert Ita lie, en Allemagne
& en France on fe difpute la gloire de cette découverte
, fon auteur Efpagnol git oublié dans la p ou f-
fière de quelque bibliothèque.
Tous ces-écrivains & beaucoup d’autres parurent
en Efpagne avant Salinas, mais c’eft celui de tous
dont la vie & les ouvrages méritent le mieux une
mention particulière.
François Sa l in a s , né à Burgos en 1 ç 15 , fut aveugle
dès fon enfance, ayant fucé, comme il le dit lui-même
cette infortune avec, le lait in fe â é de fa nourrice!
Ses parens s’étant aperçus qu’il pou voit, malgré fort
incommodité, s’adonner à l’étude de la mufique, lui
firent apprendre de très-bonne heure à chanter & à
jouer de l’orgue. C e fut par un pur hafard qu’il
acquit la première connoiffance des langues favantes.
Lorlqu’il étoit encore enfant, une jeune femme, qui
favoit très-bien le latin, ayant un extrême defir d’apprendre
à toucher l’orgue , vint prendre de lui des
leçons chez fon pè re , & lui montra le latin en retour
de fes leçons de mufique. Ses, parens l’envoyèrent
enfuite à Salamanque o ù , pendant plufieurs années
il s’adonna, exclufivement à l’étude de la langue
grecque , de la philofophie & des arts : mais n’étant
pas en état de fe foutenir plus long-tems dans cette
univerfité, il fut placé dans le palais du ro i, auprès
de l’archevêque. de Compoftelle, qui peu de tems
après ayant été fait cardinal-, emmena Salinas avec
lui à Rome. Là il profita de l’occafion de converfer
avec les fav an s, & de confulter les anciens manuf-
crits Grecs : il donna une attention particulière à
ceux qui traitent de la mufique, & qui ont été publiés
depuis par Meïbomius. Il s’occupa trente ans dé ces
études , & à la mort de fes patrons , qui l’avoient
dit-il, plus aimé qu’enriebi, il fe détermina à retourner
en Efpagne, & à y paffer le.refte de fes jours dans
une humble obfcurité : mais à fon arrivée à Salamanque
, il fut créé profeüèur de mufique, & il
commença de donner dans cette univerfité des leçons
publiques de pratique & de théorie.
La longue étude qu’il avoit faite de Boëce & des
anciens théoriftes Grecs rendit toujours fa doâ rine
en .grande partie fpéculative. Il fe renferma prefqua
V v v