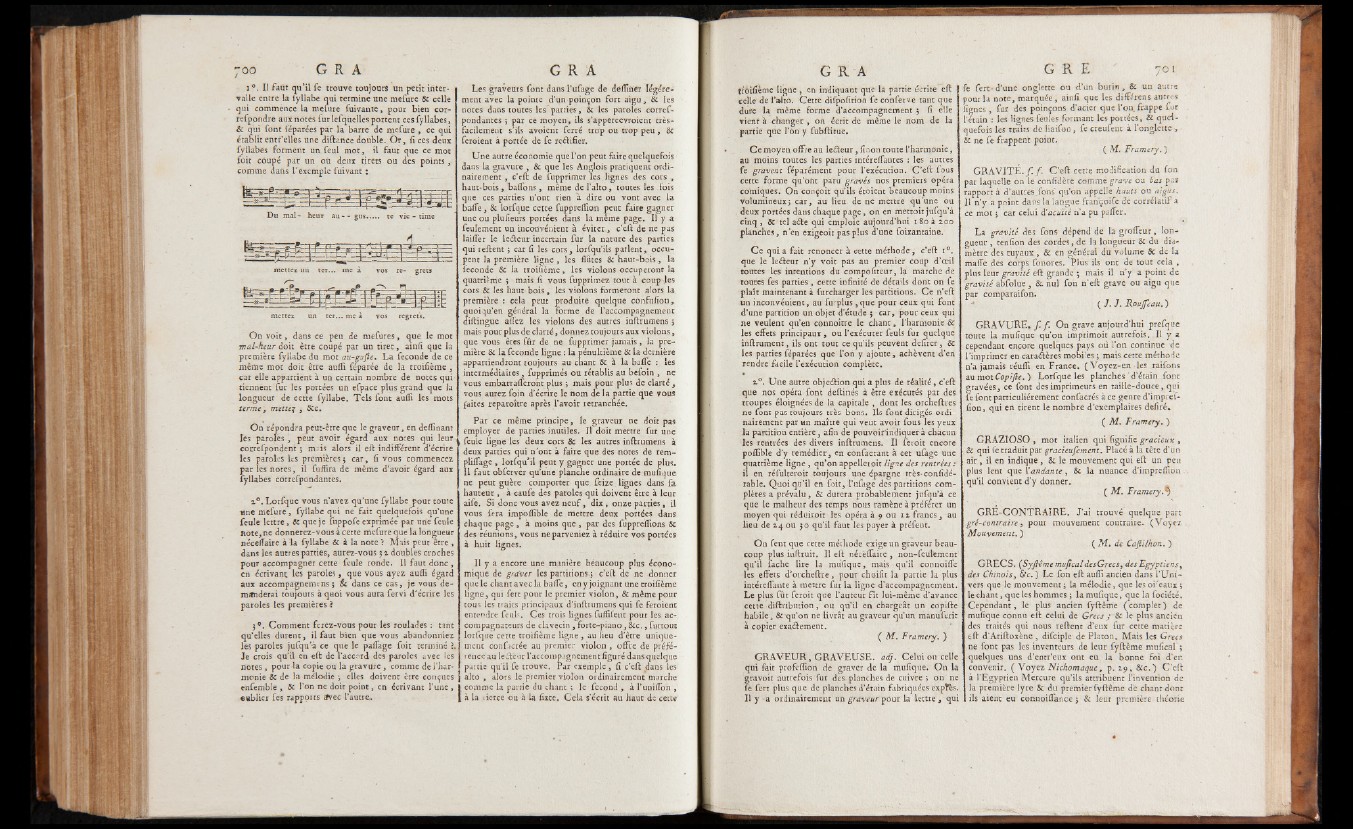
i ° . Il faut qu’il fe trouve toujours un petit intervalle
entre la fyllabe qui termine une mefure Sc celle
qui commence la mefure fuivante, pour bien cor-
refpondre aux notes fur lefquelles portent ces fyllabes,
& qui font léparées par la barre de mefure, ce qui
établit entr’elles une diftance double. O r , fi ces deux
fyllabes forment un feul mot, il faut que ce mot
foit coupé par un ou deux tirets ou des points ,
comme dans l'exemple fuivant :
Du mal- heur au - - gus.
mettez un ter... me à vos re- grets
»P
—M — T
mettez un ' ter... me à vos regrets.
On vo it, dans ce peu de mefures, que le mot
mal-heur doit être coupé par un tiret, ainfî que la
première fyllabe du mot au-gufte. La fécondé de ce
même mot doit être aufli féparée de la troifième ,
car elle appartient à un certain nombre de notes qui'
tiennènt fur les portées un efpace plus grand que la
longueur de cette fyllabe. Tels font aufli les mots
terme, mette? , &c.
On répondra peut-être que le gravear, en deflinant
les paroles !t peut avoir égard aux notes qui leur
correfpondent ; msis alors il eft indifférent d’écrire
les paroles les premières 5 car, fi vous commencez
par les notes, il fuffira de même d’avoir égard aux
fyllabes correfpondantes.
x°. Lorfque vous n’avez qu’une fyllabe pour toute
une mefure, fyllabe qui ne fait quelquefois qu’une
feule lettre, & que je fuppofe exprimée par une feule
note, ne donnerez-vous à cette mefure que la longueur
néceflaire à la fyllabe & à la note ? Mais peut être ,
dans les autres parties, aurez-vous 3 z doubles croches
pour accompagner cette feule ronde. 11 faut donc ,
en écrivant les paroles , que vous ayez aufli égard
aux accompagnemc-ns ; Sc dans ce cas, je vous demanderai
toujours à quoi vous aura fervi d’écrire les
paroles les premières i
3°. Comment ferez-vous pour les roulades : tant
qu’elles durent, il faut bien que vous abandonniez
les paroles jufqu’-à ce que le paflage foit terminé
Je crois qu’il en eft de l’accord des paroles avec les
notes, pour la copie ou la gravure, comme de l’harmonie
& de la mélodie 3 elles doivent être conçues
enfemble , & l’on ne doit point, en écrivant l’une,
oublier fes rappçits £vec l’autre.
Les graveurs font dans l’ufage de deflmer légèrement
avec la pointe d’un poinçon fort a igu , & les
notes dans toutes les parties, Sc les paroles correfpondantes
; par ce moyen, ils s’appercevroicnt très-
facilement s’ ils avoient ferré trop ou trop p eu , Sc
feroient à portée de fe reftifiér.
Une autre économie que l’on peut faire quelquefois
dans la gravure , & que les Anglois pratiquent ordinairement
, c’ eft de fnpprimcr les lignes des cors ,
haut-bois , Eaffons, même de l’a lto , toutes les fois
que ces parties 11’ont rien à dire ou vont avec la
bafle, & lorfque cette fuppreflion peut faire gagner
une ou plufleurs portées dans la même page. 11 y a
feulement un inconvénient à éviter, c’eft de ne pas
laifler le ledeur incertain fur la nature des parties
qui refirent 3 car fi les co r s , lorfqu’ils parlent, occupent
la première ligne , les flûtes & haut-bois, la
fécondé & la troifième, les violons occuperont la
quatrième 3 mais fi vous fupprimez tout à coup les
cors & les haut- bois , les violons formeront alors la
première : cela peut produire quelque cônfufion,
quoiqu’en général la forme de l’accompagnement
diftingue allez les violons des autres inftrumens 5
mais pour plus de clarté, donnez toujours aux violons,
que vous êtes fur de ne fupprimer jamais , la première
& la fécondé ligne : la pénultième & la dernière
appartiendront toujours au chant & à la bafle : les
intermédiaires, fupprimés ou rétablis au befoin , ne
vous embarrafleront plus 5 mais pour plus de clarté ,
vous aurez foin d’écrire le nom de la partie que vous
faites reparoître après l’avoir retranchée.
Par ce même principe, le graveur ne doit pas
employer de parties inutiles. Il doit mettre fur une
! feule ligne les deux cors & les autres inftrumens à
deux parties qui n'ont à faire que des notes de rem-
pliflage , lorfqu’ il peut y gagner une portée de plus.
11 faut obferver qu’une planche ordinaire de mufique
ne peut guère comporter que fe iz e , lignes dans fa
hauteur , à caufe des paroles qui doivent être à leur
aife. Si donc vous avez n eu f, dix , onze parties, il
vous fera impoflible de mettre deux portées dans
chaque p a g e , à moins q u e , par des fuppreflions 8c
des réunions, vous ne parveniez à réduire vos portées
à huit lignes.
Il y a encore une manière béaucoup plus économique
de grdver les partitions .5 c’eft de ne donner
que le chant avec la bafle, en y joignant une troifième
ligne, qui fert pour le premier violon, & même pour
tous les traits principaux d’inftrumens qui fe feroient
entendre feuls. Çes trois lignes fuflxfent pour les accompagnateurs
de clavecin , forte-piano , & c . , furtout
lorfque cette troifième ligne , au lieu d’être uniquement
confacrée au premier violon , offre de préférence
au lefteur l’accompagnement figuré dans quelque
partie qu’il fié trouve. Par exemple, fi c’eft dans les
alto , alors le premier violon ordinairement marche
comme la partie du chant ; le fécond , à l’ uniflon ,
à la lierce ou à la fixte. Ce la s’écrit au haut de cette
ttèifi^me ligne , en indiquant que la partie écrite eft
celle de l’alto. Cette difpofîtion fe conferve tant que
dure la même forme d’accompagnement ,5 fi éilé
vient à changer , on écrit de même le nom de la
partie que l’on y fubftitue.
Ce moyen offre au lefteur , fi non toute l’harmonie,
au moins toutes les parties intéreflantes : les autres
fe gravent féparément pour l’exécution. C ’eft fous
cette fqrme qu’ont paru gravés nos premiers opéra
comiques. On conçoit qu’ils étoient beaucoup moins
Volumineux 5 car, au lieu de ne mettre qu’une ou
deux portées dans chaque page, on en mettoit jufqu’à
cinq , & tel a<fte qui emploie aujourd’hui 180 à zoo
planches, n’en exigeoit pas plus d’une foixantaine.
Ce quia fait renoncer à cette méthode, c’eft i°.
que le leéteur n’y voit pas au premier' coup d’oeil
toutes les intentions du compofiteur, la marche de
toutes fes parties , cette infinité de détails dont on fe
plaît maintenant à furcharger les partitions. Ce n’cft
un inconvénient, au furplus ,que pour ceux qui font
d’une partition un objet d’étude 5 car, pour ceux qui
ne veulent qu’en connoître le chant, l'harmonie &
les effets principaux, ou l’exécuter feuls fur quelque
ioftrument, ils ont tout ce qu’ils peuvent defirer, &
les parties féparées que l’on y ajoute, achèvent d’en
rendre facile l’exécution complète.
z°. Une autre obje&ion qui a plus de réalité, c’eft
que nos opéra font deftinés à être exécutés par des
troupes éloignées de la capitale , dont les orcheftres
ne font pas toujours très bons. Ils font dirigés ordinairement
par Hn maître qui veut avoir fous les yeux
la partition entière, afin de pouvoirindiquer à chacun
les rentrées des divers inftrumens. Il ieroit encore
polfible d’y remédier, en confacrant à cet ufage une
quatrième ligne , qu’on appelleroit ligne des rentrées:
il en réfulteroit toujours une épargne très-confîdé-
rable. Quoi qu’il en foit, l’ufage des partitions complètes
a prévalu, & durera probablement jufqu’à ce
que le malheur des temps nous ramène à préférer un
moyen qui réduiroit les opéra à 9 ou i z francs, au
lieu de 14 ou 30 qu’il faut les payer à préfent.
On fent que cette méthode exige un graveur beaucoup
plus inftruit. Il eft néceflaire , non-feulement
qu’il fâche lire la mufique, mais qu’il connoîfle
les effets d’orcheftre, pour choifir la partie la plus
intéreflante à mettre fur la ligne d’accompagnement.
Le plus fur feroit que l’auteur fît lui-même d’avance
cette diftribution, ou qu’il en chargeât un copifte
habile, & qu’on ne livrât au graveur qu’un manuferi:
à copier exactement.
( M. Framery. )
GRAVEUR, GRAVEUSE, ad). Celui ou celle
qui fait profeflion de graver de la mufique. On la
gravoit autrefois fur des planches de cuivre ; on ne
le fert plus que de planches d’étain fabriquées expïès.
Il y a ordinairement un graveur pour la lettre, qui
fe fert*d’une onglette ou d’un bu rin , Sc un autre
pour la noce, marquée, ainfi que les différens autres
lignes, fur des poinçons d’acier que l’on, frappe fur
l’étain : les lignes feules formant les portées, & quelquefois
les traits de liaifon, fe creufeut à l’onglette ,
Sc ne fe frappent point.
( M. Framery. )
G R A V IT É , f. f . C ’eft cetre modification du fon
par laquelle on le confidère comme grave ou bas pai?
rapport à d’autres Tons qu’on appelle hauts ou aigus.
11 n’y a point dans la langue françoife de corrélatif a
ce mot 3 car celui $ acuité n’a pu pafler.
La gravité des fons dépend de la grofleur, longueur
, tenfion des cordes, de la longueur & du diamètre
des tuyaux , & en général du volume & de la
mafle des corps fonores. Plus ils ont de tout cela ,
1 plus leur gravité eft grande ; mais il n’y a point de
gravité abfolue , & nul fon n’eft grave ou aigu que
par comparaifon.
“ . . {J . J. R o u f eau.)
G R A V U R E , f . f . On grave aujourd’hui prefque
toute la mufique qu’on imprimoit autrefois. Il y a
cependant encore quelques pays où l’on continue de
l'imprimer en caradères mobiles 3 mais cette méthode
n’a jamais réuffi en France. (V o y e z -e n les raifons
au mot Copifte. ) Lorfque les planches ' d’étain font
gravées, ce font des imprimeurs en taille-douce, qui
fe font particuliérement confacrés à ce genre d’imprei-
fion, qui en tirent le nombre d’exemplaires defiré.
( M. Framery. )
G R A Z IO SO , mot italien qui fignifie gracieux ,
& qui le traduit par gracieufement. Placé à la tête d’un
a i r , il en indique , & le mouvement qui eft un peu
plus lent que Xandante, Sc la nuance d’impreflion
qu’il convient d’y donner.
( M. Framery $
G R É -C O N T R A IR E . J’ai trouvé quelque part
gré-contraire, pour mouvement contraire. (V o y e z .
Mouvement. )
(M . de Caftilhon. )
G R E C S . (Syftême muftcaldesGrecs^ des Egyptiens,
des Chinois, &c. ) L e fon eft aufli ancien dans l’U n ivers
que le mouvement 5 la mélodie, que les oifeaux 5
le chant, que les hommes 3 la mufique, que la fociété.
Cependant, le plus ancien fyftême ( complet ) de
mufique connu eft celui de Grecs y & le plus ancien
des traités qui nous reftent d’eux fur cette matière
eft d'Ariftoxène, difciple de Platon. Mais les Grecs
ne font pas les inventeurs de leur fyftême mufical 3
quelques uns d’entr’eux ont eu la bonne foi d’en
convenir. ( V o y e z Nickomaque, p. 1 9 , & c . ) C ’eft
à l’Egyptien Mercure qu’ils attribuent l’invention de
la première lyre & du premier fyftême de chant donc
ils aient eu connoiflance 3 & leur première théorie