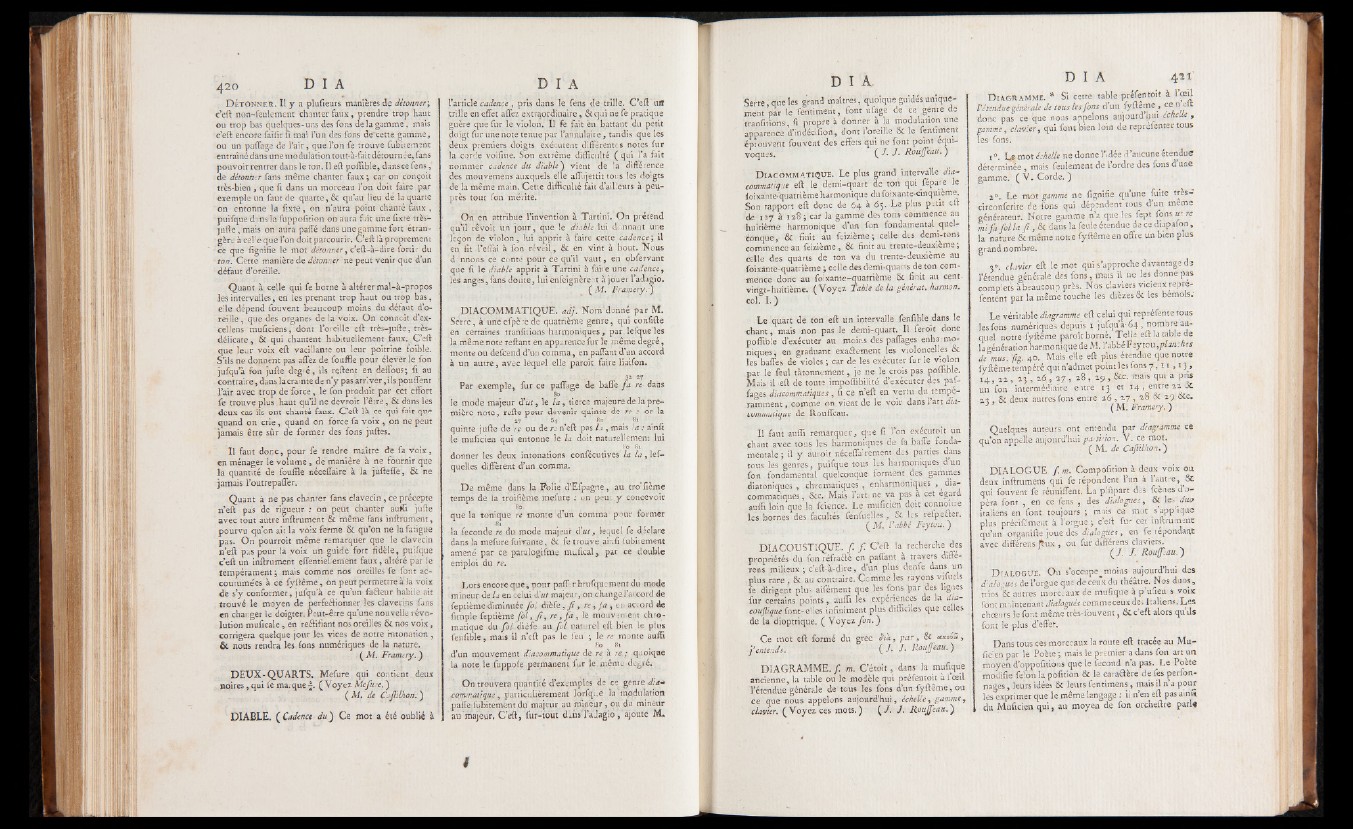
D étonner. Il y a plufieurs manières de détonner;
c’eft non-feulement chanter faux, prendre trop haut
ou trop bas quelques-uns des fons de la gamme, mais
c’eft encore faîfir ii mal i’un des fons de'cette, gamme,
ou un paffage de l’air, que l’on fe trouve fubitement
entraîné dans une modulation tout-à-fait détournée, fans
pouvoir rentrer dans le ton. Il eft poffible, dans ce fens,
de détonner fans même chanter faux ; car on conçoit
très-bien, que fi dans un morceau l’on doit faire par
exemple un faut de quarte, & qu’au lieu dé la quarte
on entonne la fixte, on n’aura point chanté faux ,
puifque dans la fuppofition on aura fait une fixte très-
jufte, mais on aura paffé dans une gamme fort étrangère
à cel’e que l’on doit parcourir, üeft là proprement
ce que fignlfie le mot détonner, c’eft-à-dire fortir du
ton. Cette manière de détonner ne peut venir que d’un
défaut d’oreille.
Quant à celle qui fe borne à altérer mal-à-propos
les intervalles en les prenant trop haut ou trop bas,
elle dépend foùvent beaucoup moins du défaut d’oreille,
que des organes de la voix. On connoît d’ex-
cellens muficiens, dont l’oreille eft très-jufte, très-
délicate, & qui chantent habituellement faux. .C’eft
que leur voix eft vacillante ou leur poitrine foible.
S’ils ne donnent pas affez de fouffle pour élever le fon
jufqu’à fon jufte deg'é, ils refient en deffoüs; fi au
contraire, dans la crainte de n’y pas arriver, ils pouffent
l’air avec trop de force, le fon produit par cet effort
fe trouve plus haut qu’il ne devroit l’être, ôt dans les
deux cas ils ont chanté faux. C ’eft là ce qui fait que
quand on crie, quand on force fa voix , on ne peut
jamais être sûr de former des fons juftes.
Il faut donc, pour fe rendre maître de fa voix,
en ménager le volume, de manière à ne fournir que
la quantité de fouffle néceffaire à la jufteffe, & ne
jamais l’outrepaffer.
Quant à ne pas chanter fans clavecin, ce précepte
n’eft pas de rigueur on peut chanter auffi jufte
avec tout autre infiniment & même fans inftrument,
pourvu qu’on ait la voix ferme & qu’on ne la fatigue
pas. On pourroit même remarquer que le clavecin
n’eft pas pour la voix un guide fort fidèle, puifque
c’eft un inftrument effentiel'ement faux, altéré par le
tempérament ; mais comme nos oreilles fe font accoutumées
à cé fyftême, on peut permettre à'la voix
dé s’y conformer, jufqu’à ce qu’un faéleur habile ait
trouvé le moyen de perfectionner les clavecins fans
en charger le doigter. Peut-être qu’une nouvelle révolution
muficale, en re&ifiant nos oreilles ôt nos voix,
corrigera quelque jour les vices de notre intonation ,
& nous rendra les fons numériques de la nature.
( M. Framery.)
D EU X -Q U ARTS. Mefure qui contient deux
noires, qui le ma/que (V oyez Mefure. )
( M. de Çuflilhon. )
DIABLE. ( Cadence du') Ce mot a été oublié à
l’article cadence , pris dans le fens de trille. C ’eft lUI
trille en effet affez extraordinaire, ôtqui ne fe pratique
guère que fur le violon’. Il fe fait en battant du petit
doigt fur une note tenue par l’annulaire , tandis que les
deux premiers doigts exécutent différentes notes fur
la .corde voifine. Son extrême difficulté (qui l’a fait
nommer cadence du diable) vient de la différence
des mouvemens auxquels elle affujê-ttit tous les doigts
de la même main. Cette difficulté fait d’ailleurs à-peu-
près tout fon mérite.
On en attribue l’invention à Tartini. On prétend
qu’il rêvoit un jour, que le diable lui donnant une
leçon de Violon, lui apprit à faire cette cadence', il
en fit l’effai à fon réveil, ôt en vint à bout. Nous
d nnons ce conte pour ce qu’il vaut, en obfervant
que fi le diable apprit à Tartini à faire une cadence,
les anges, fans doute, lui enfeignèrent à jouer l’adagio.
( M. Framefy.-)
DIACOMMATIQUE. ad]. Nomldonné par M.
Serre, à uneefpèrède quatrième genre, qui confrfte
en certaines tranfitions harmoniques, par lefque les
la même note reliant en apparence fur le même degré,
monte ou defcend d’un comma, en paffant d’un accord
à un autre, avec lequel elle paroît faire liaifon.
, .32 27 ;.
Par exemple, fur ce paffage de baffe fa re dans
B I r a H
le mode majeur d’ut, le la , tierce majeure de la première
note, refte pour devenir quinte de re : or la
'27 * 54 ‘ "8oj' ’’ * ' l - •
quinte jufte de re ou de re n’eft pas h , mais la : ainfi
le muficien qui entonne le la doit naturellement lui
| Wm a -1HI HH H h 8 ' | H ?o 81
donner les deux intonations confécutives la la , lesquelles
diffèrent d’un comma.
De même dans la Folie d’Efpagne., au tro'fîème
temps de la troifième mefure : on peut y concevoir
' •’ . gol
que la tonique re monte d’un comma pour former
81 I
la fécondé re du mode majeur d'ut 3 lequel fe déclaré
dans la mefure fuivante, ôt fe trouve ainfi lubitemeut
amené par ce paralogifme mufical, par ce double
eiriploi du re.
Lors encore que* pour paffer brufqucment du mode
mineur delà en celui dé ut majeur, on change l’accord de
feptième diminuée fol dièfe, f i > re, f a , en accord de
fimple feptième fol,, f i , re , fa , le mouveirent çhr-o-
matique du fàl dièfe au fol naturel eft bien le plus
fenfible, mais il n’eft pas le feu' ; le re monte auffi
8° 81
d’un mouvement diacommatique de re à re.; quoique
la note le fuppofe permanent fur le même degré;
On trouvera quantité d’exemples de ce genre dia*
,copimatique, particulièrement lo^fqi.e la - modulation
paffe-fubitement du majeur au mineur , ou du mineur
au majeur. C ’eft, fur-tout dùhsTàiagioajoute M.
/
Serre, que les granJ maîtres, quoique guidés uniquement
par le fentiment, font ufage de ce genre de
tranfitions-, fi propre à donner à la modulation une
apparence d’indécifion, dont l’oreille & le fentiment
éprouvent fouvent des effets qui ne font point équivoques.
[ J . J. Roujféau. )
D ia c om m a t iq u e . Le plus grand intervalle dia-
commaiïque eft le demi-quart de ton qui fépare le
ioixante-quatrième harmonique du foixante-cinquieme.
Son rapport eft donc de 64 à 65. Le plus p-tit eft
de 127 à 128; car la gamme des tons commence au
huitième harmonique d’un fon fondamental quelconque,
& finit au ffcizième ; celle des demi-tons
commence au feizième, & finit au trente-deuxieme; ■
celle des quarts de ton va du trente-deuxième au
foixânte-quatrième ; celle des, demi-quarts de ton commence
donc au folxante-quatrième ôt finit au cent-
vingt-huitième. (V oy e z Table de la générât, harmon.
col. I. )
Le quart de ton eft un intervalle. fenfible dans le
chant, mais non pas le demi-quart. Il feroit donc
poffible d’exécuter au moins des paffages enharmoniques,
en graduant exactement les violoncelles ôt
les baffes de violes ; car de les exécuter fur le violon ;
par le feul tâtonnement, je ne le crois pas poffible.
Mais-il eft de toute impoffibilité d’exécuter des paffages
diacommatiques , fi ce n’eft en vertu du tempe-
ram ment , comme on vient de le voir dans l’art diacommatique
de Rouffeau.
Il faut auffi remarquer, que fi l’on exécutoit un
fhant avec tous les harmoniques de fa baffe fondamentale;
il y auroit néceffa'rement des parties dans
tous les genres, puifque tous les harmoniques dun
fon fondamental quelconque forment des gammes
diatoniques , chromatiques , enharmoniques , | diacommatiques
, Ôcc.. Mais l’art ne va pas a cet egard
auffi loin que la fcience. Le muficien doit connoître
les bornes des facultés fenfuelles , & les refpefter.
(M . T abbé Feytou. )
DIACOUSTIQUE. f. f . C ’eft la recherche des
propriétés' du fon réfraClé en paffant à travers diffe-
rens milieux ; c’eft-à-dire, d’un plus denfe dans un
plus rare , & au contraire. Comme les rayons vifuels
fe dirigent plus aifément que les fons par des lignes
fur certains points, auffi les expériences de la dïa-
couflique font-elles infiniment plus difficiles que celles
de la dioptrique. (V o y e z fon.)
Ce mot eft formé du grec h u , par, ôt «xouâ»,
f entends. ? 4 ƒ . ^ ' (V- /• Rouffeau.)
DIAGRAMME, f. m. C ’étoit, dans' la mufique
ancienne, la table ou le modèle qui préfentoit à l’oeil
l’étendue générale de tous les fons d’un fyftême, ou
ce que nous appelons aujourd’hui, échelle, gamme,
clavier. (V o y e z ces mots.) ( J. J. Rouffeau.)
D iagramme. * Si cette table préfentoit à l’oeil
l'étendue générale de tous les fo n s d’un fyftême , ce1 n e il
donc pas ce ljue nous appelons aujourd iiui échelle ,
gamme, clav ie r, qui font bien loin de repréfenter tous
les fons.
i° . Le mot échelle ne donne l’idée d’aucune étendue
déterminée , mais feulement de l’ordre des fons d’une
gamme. ( V . Corde. )
2°. Le mot gamme ne fignifie qu’une fuite
circonfcrite de -fons qui dépendent tous d’un meme
générateur. Notre gamme n’a que les fept fons u f, re
mi f a f o l la f i 3 d>L dans la feule étendue de ce diapafon,
la nature & même notre fyftême en offre un bien plus
grand nombre.
0°. clavier eft le mot qui s’approche davantage de
l’étendue générale des fons, mais il ne les donne pas
complets à beaucoup près. Nos claviers vicieux repré-
fentent par la même touche les dièzes & les bernois;
Le véritable diagramme eft celui qui reprefente tous
les fons numériques depuis 1 jufqu’à-64 -y nombre auquel
notre'fyftême paroît borné. Telle eft la table de
la génération harmonique de M. l’abbé Feytou,planches
de mus. fg. 40. Mais elle eft plus étendue que notre
fyftême tempéré qui n’admet point les fons 7 , 1 1 , 1 3 ,
14 , 22, 2 3 , 2 6 ,2 7 , 2.3, 2 9 ,& c . mais qui a pris
un fon intermédiaire entre 13 et 1 4 , entre 226c
zn , & deux autres fons entre' 2 6 , 2 7 ,2.8 & 29 ôte.
^ ( M. Framery. )
Quelques auteurs ont entendu par diagramme ce
qu’on appelle aujourd’hui pat d'ion. V. ce mot.
n - (M . de C a fiilh o n .)
DIALOGUE f m. Compofition à deux voix ou
deux inftrumens qui fe répondent l’un à 1 autre, St
qui fouvent fe réunifient. La plupart des feenes d opera
font , en ce fens , des dialogues, ôt 1 e^ duo
italiens en font toujours ; mais ce mot sapp'ique
plus précifément à l’orgue ; c’eft fur cet inftrument
qu’un organifte joue des dialogues, en fe répondant
avec différens f^ux , ou fur différens claviers.
{ J . T. Rouffeau.')
D ialogue. On s’occupe^moins aujourd’hui des
dialogues de l’orgue qu$ de ceux du théâtre. Nos duos,
trios autres morceaux de mufique à p’ufieu s voix
I font maintenant dialogués comme ceux de; Italiens. Les
choeurs le font même très-fou vent, ôt c’eft alors qu’ils
font le plus d’effet.
Dans tous ces morceaux la route eft tracée au Mu-
ficien par le Poète ; mais le premier a dans fon art un
moyen d’oppofitiorss que le fécond n a pas. Le Poete
modifie félon la pofitiôn Ôt le caraâère de fes perfon-
nages, leurs idées Ôt leurs fentimens , mais il n’a pour
les exprimer que le même langage : ii n’en eft pas ainS
du Muficien qui, au moyen de fon orcheftre pari#