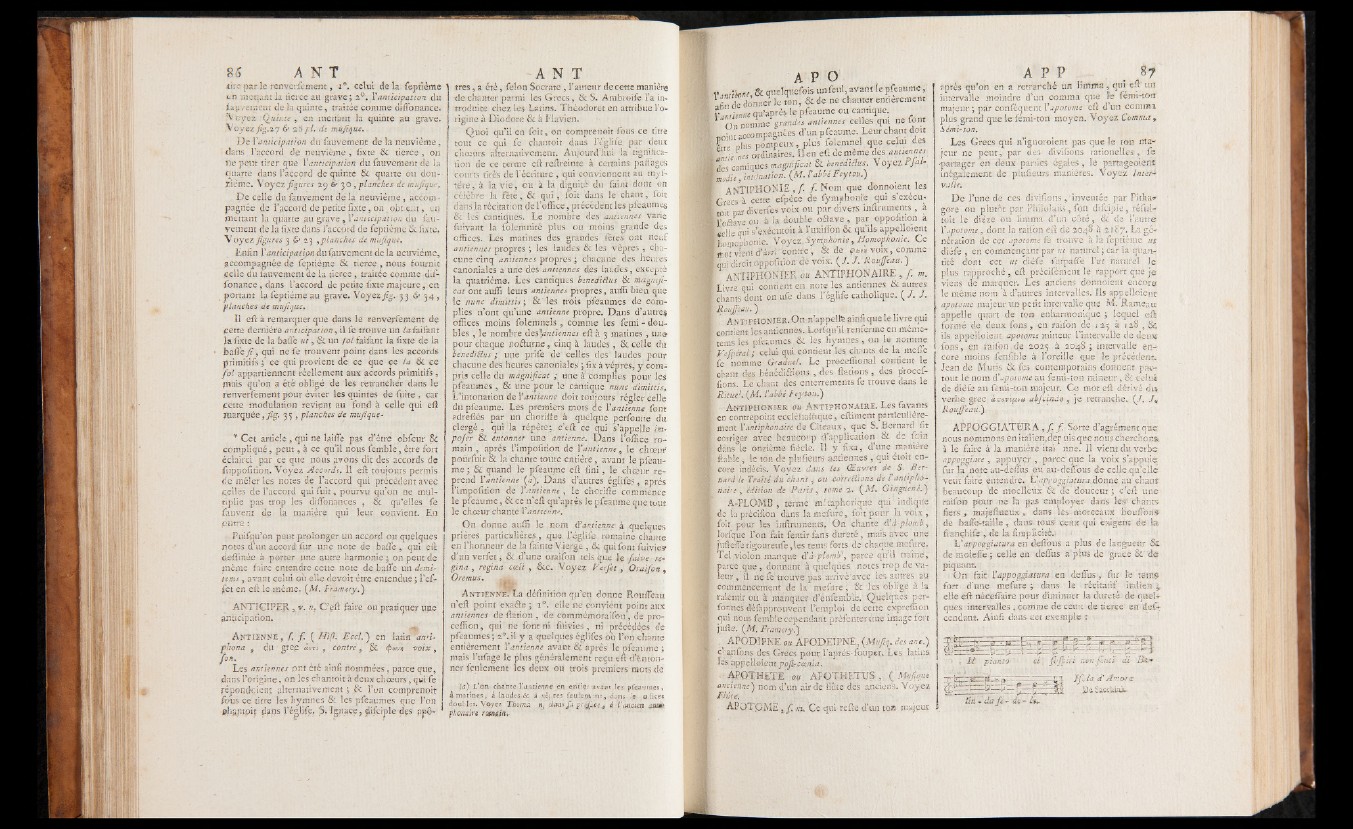
8 6 A N T
cire par le renversement, i° . celui de là. Septième
en mettant la tierce au grave; zQ. Y anticipation du
Sa y veinent de la quinte, traitée comme difîb nance.
'"V oyez Quinte, en mettant la quinte au grave.
.Voyezfig^y & 2.8 f l . de mufique.
De Y anticipation du fauvement de la neuvième,
( dans. l’accord, de neuvième , Sixte 8c tierce , on
ne peut tirer que Y anticipation du fauvement de la
quarte dans l ’accord de quinte £c quarte ou douzième.
Voyez figures 29 è* 30 , planches de mufique,
De celle du fa.uvemçnt dé la neuvième, accompagnée
de l’ accord de petite Sixte, o n . obt lent, en
mettant la quarte au grave, Y anticipation, du fauvement
de la Sixte dans l’accprd de feptième & Sixte.
V o y e z figures 3 & 23 , planches de mufique.
Enfin Y anticipation du fauvement de la neuvième,
accompagnée de feptième 8c tierce , nous fournit
celle du lauvetnent de la tierce , traitée comme dif-
fonance, dans l’accord de petite Sixte majeure, en
portant la feptième au grave. Voyez f i g. 33 6* 34,
planches de mufique.
Il eft à remarquer que dans lé renveyfement dç
cette dernière anticipation, ilfe trouve un /^faifant
Ja fixte de la bafi'e u t , & un fol i àifant la fixte de la
bafle f i , qui ne fe trouvent point dans les accords
primitifs ; ce qui provient de ce que ce la & ce
fo l appartiennent réellement aux accords primitifs ,
mais qu’on a été obligé de les retrancher dans le
renverfement pour éviter les quintes de -fuite , car
cette modulation revient au fond à celle qui eft
marquée , .ƒ%■ . 35 , planches de mufique-
* Cet article, qui ne laifie pas d’être obfcur 8c
compliqué , p eut, à ce qu’il nous femble, être fort
éclairci par ce que nous gvons dit des accords de
fuppofition. Voyez 'Accords, 11 eft toujours permis
de mêler les notes de, l’accord qui précèdent avec
celles de l’accord qui fuit, pourvu qu’on ne multiplie
pas trop les diSTonances , 0ï qu’elles fe
fauvent de la manière qui leur convient. En
joutre :
Puisqu’on peut prolonger un accord ou quelques
notes d’un accord fur une note de baffe , qui eft
deftinée à porter une autre harmonie ; on peut de
même faire entendre cette note de baffe un demi- \
tems, avant celui où elle de voit-être entendue; J’ef- j
fet en eft .le .même. (M. Framery.')
ANTIC IPER, y. n, C ’eft faire ou pratiquer une
anticipation.
A ntienn e, f, f i ( Hiß. Eccl. ) en latih and-
pliona 3 du grec ùvr\ , contre , <5c voix ,
Jon.
Les antiennes ont été ainfi nommées, parce que,
dans l’origine, on les chantoit à-deux choeurs, qui fe
répondeient alternativement; & l’on comprenoit
fous ce titre les hymnes & les pfeaumes que l’on
oh SP tpi f dyps l ’églife, S, Ignace, difciple dçs apô-
A N T
très, a été, félon Socrate , l’auteur de cette manière
de chanter parmi les Grecs., 8c S. Ambroife l’a introduite
chez les Latins. Théodoret en attribue l ’origine
à Dindons & à Flavien.
Quoi qu’il en foit, on comprenoit fous ce titre
tout ce qui fë chantoit dans l’cglife par deux
choeurs alternativement. Aujourd’hui la lignification
de ce terme eft reftreinte à certains pafl'ages
courts tirés de récriture , qui conviennent au myf-
tère, à la v ie , ou à la dignité du faint dont on
céièbfe la fê te , 8c q u i, Soit- dans le chant, foit
dans la récitation de l ’office, précédent les pfeaumes
& lés cantiqués. Le nombre des antiennes varie
fiiivant la folemnité plus ou moins grande des
i offices. Les matines des grandes fêtes ont neuf
1 antiennes propres ; les laudes & les vêpres , chacune
cinq antiennes propres ; chacune des heures
canoniales a une d e santiennes dès laudes, excepté
la quatrième. Les cantiques binedïtlus 8c magnificat
ont auifi leurs antiennes propres, auffi bien que
le nunc dïmittis ; & ' les trois pfeaumes de compiles
n’ont qu’une antienne propre. Dans d’autres
offices moins folemnels , comme les femi - doubles
, le nombre àe$\antiennes eft à 3 matines , un©
pour chaque noéhirne, cinq à laudes , & celle du
benedrpus ; une prife de celles des laudes pour
chacune des heures canoniales ; fix à vêpres, y compris
celle du magnificat ; une a compiles pour les
pfeaumes , 8c une pour le cantique nunc dimittis.
L’intonation de Y antienne doit toujours régler celle
du pfeaume. Les premiers mots de Y antienne, font
adreffés par un chorifte à quelque perfonne du
clergé, qui la répète; c’eft ce.qui s’appelle im-
pofer 8c entonner une antienne. Dans l’office romain
, après l’impofirion de Y antienne 9 le choeur
poùrfuit 8c là chante toute entière, avant le pfeau-
me ; & quand le pfeaume eft fin i, le choeur reprend
Y antienne (a). Dans d’autres églifes, après
l’impofiîion de f antienne , le chorifte commence
le pfeaume, 8c ce n’eft qu’après le pfeaume que tout
le choeur chante Y antienne,'
On donne auffi le nom kantienne■ à quelques
prières particulières , que L’églife, romaine chante
en l’honneur de la fainteV-ierge , 8i qui font fuivies’
d’un verfet ; 8c d’une oraifon tels que iç falve re-
gina , regina cæli , 8ic. Voyez Verfet, Oraifon ,
Oremus.
A ntienne. La définition qu’en donne Rondeau
n’eft point êxàéte ; 1?. elle ne convient point aux
antiennes de ftàtion , de commémoraifon , de pro-
ceffion, qui ne font ni fûmes., ni précédées de
pfeaumes ; 2°ul y a quelques églifes ou l’on chante
entièrement Y antienne avant 8c après le pfeaume ;
mais l’ufage le plus généralement reçu eft d’èntonner
feulement les deux ou trois premiers mots de
fa)" l ’on chante jén entie;-avant les pfeayna.es,
à matines, à l'audes.& à v,ç},res fcu!ecn:nr, dans ’e p.fices
doubles. Voyez Thoma n} dans f i à V ancien M»f
phonaire romain,.
A P O
,, , „ , !W & quelquefois un feul, a v a n fle p feaume,
i t fn d e donner le. ton , & de ne chanter entièrement.
i ç» * ap ' On ^ Ie Pfeaume 011 c“ nï Be: nomme grandes antiennes celles qui ne font
noint accompagnées d’uni pfeaume. Leur chant doit
;ï „lus pomp eu x, plus folemnel que celui des
| * J L ordinaires, l ie n efi demêmedes antiennes,.
■ des cantiques magnificat & bmeaictus V o y e z P fai-.
B mtiiie, intônation. (M. FM I Feytoii.)
I AN T IPHO NIE , f. /• Nom que donnoient les
I Grecs-à cette efpèce de fymphonîe qui s’exécu-
I toit par diverfes vo ix ou par divers inftruments , à
| ro â;ave ou à la double oéfave , par oppofition à
I «elle qui s’èxécutoit à l’umfTon & qu’ils appelloient
^ hoîopiionie. V o y e z , 5 y/7z/?&72ie , Homophonie. C e
I jfcot vient c o u r t e 8 c de v o ix , comme -
B qui diroit oppofition de voix. ( A J. Rouffeau. )
AN T IPH O N ÏE R 'OU AM T IPH O N A IR E , / . m.
Rouffeau. )
A n ti phonier. O n m’appelle ainfi que le livre qui
contient, les antiennes. L orfqù’il renferme en inême-
tems les pfeaumes , 8c les hymnes , on le nomme
Y <:fuirai ; celui qui. contient lés chants de la méfié
fe nomme (rraduel. Le proceffional contient le
chant des bêiîédiéripns , des ftations, des p'rocef-
îfiôns. Le chant des' enterrements fe trouve dans le
Rituel. (M. L'abbé Feytaiu)
Antiphonier oü A n tiphonaire. Les favants
en contrepoint eccléfiaftique, eftiment particulièrement
Yantipkonaire dé C îte a u x, que S. Bernard fit
corriger a vec beaucoup d’application 8c de foin
dans le onzième fié d e . U y fix a , d’une manière
fiab le , le ton de plufieurs antiennes , qui étoit encore
indécis. V o y e z dans les OEuvres de S. Bernard
le Traité du chant ou comblions de Cantiphônai’
t , édition de Paris, tome i . ( M. GingdenéJ)
A-PLÔMB , terme métaphorique qui indiqiié
de îa précifion dans la mefure , foit pour la vo ix ,
foit. pour les inftruments, O n chante d’à-plomb ,
lorfque l’on fait fentir fans du reté, mais avec une
jùfteffe rigoureufe ,le s tems forts de chaque mefure.
T e l .violon manqué d'à-plomb'', parce qu’il traîne,;
parce q u e , donnant à quelques notes trop de v a le
u r , il. ne fe trouve pas arrivé avec les autres an
commencement de la mefure 8c les oblige à la
ralentir ou à manquer d’ènfembie.' Quelques per-
for/nes défapprouvent remp loi de cette expreffion
qui nous femble cependant préfenter Une image fort
jufté. (M. Framery.) ’
, A PO D IPN E ou A P O D E IPN E , {Mufiq.des are.)
chanfons des. Grecs pour l’après-fouper.. Les. latins
les appçiloiçnt pofi-cccnia.
A P O TH E T E A F O T H E T U S , Ç Mufique
ancienne) nom d’un air de Bute des anciens. V o y e z
Flûte'. ... > , : • .. - 1 '
APOTGME xf m* Ce qui refte d’un ton majeur
A P P . 87
après qu’on en a retranché un lim m a , qui eft urt
intervalle moindre d’un comma que h lémi-torr
majeur ; par conféquent l’àpotome eft d’un comma
plus grand que le fémi-ton moyen. V o y e z Comma ,
Sémi-ton.
Le s Grecs qui n’ignoroiem pas que le ton majeur
ne p e u t , par des divinons rationelles , fe
partager en deux parties é g a le s , le partage oient
inégalement de plufieurs manières. V o y e z Inter■»
valle.
D e l ’une de ces divifions , ' inventée par Pitha*
gore ou plutôt par Phiiolaiis , fon d ifc iple,. réful"
toit le dièzé ou limma d’un c ô t é , 8c de i’autrer
Y^potome., dont la raifon eft de 3048 à 2187. La génération
de cet apotome fe trouve à la feptième ut
dièfe , en commençant par ut naturel; car la quantité
dont cet ut dièfe furpafie Yut naturel le
plus rapproché , eft précifément le rapport que j e
viens de marquer. Les anciens donnoient encore
le même nom à d’autres intervalles. Ils appelloiént
apotome majeur un petit intervalle que M. Rameau
appelle quart de ton enharmonique ; lequel eft
formé de deux forts , en raifon de 125 à 1 2 8 , 8c
t p appeiloient apotome mineur l ’intervalle de de lus
To n s , en ra ifo n ■ de 2025 à 2048 ; intervalle encore
moins fenfible à l’oreille que le précédent,
Jean de Mûris & fes contemporains donnent partout
le nom 6.'«pot0me au ferai-ton mineur , 8c ce lu i
de dièfe au fenil-ton majeur. C e mot eft dérivé dis
verbe grec à/yofiep-y® abfcïndo, je retranche, (J. ƒ„
Moujjcnu ) ,
A P P O G G IA T H R A , f , f . Sorte d’agrément que
nous nommons en itàlien,dej' uis que nous cherchons,
à le faire à la manière irai une. Il vient du verbe-
appoggi.are , appuyer , . parce que la vo ix s’appuie
fur la 'note au-deffus ou au-defibus de ce lle qu’elle
veut faire, entendre, Vappaggfitura.'âonnè aü- ehanr
beaucoup de moelleux & de douceur ; c ’eft u n e
raifon pour ne la pas emp loyer dans les-' chants
fiers , majeftu eux, dans lès-fKorceâiïx bôuftbriS
| de bafie^-taille, dans tou s ceux qui exigent- de la
françhife , de la fimpficité..
L ’appoggiatura en défions a plus de langueur &
de m o leffe; ce lle en defiiis a plus de gmee 8c d e
p iq u an t.:
. s G n fait Yappoggiàium en defiiis^ fur le tem&
fort d’une mefure ; dans le récitatif italien
elle eft nécefiaire pour diminuer la dureté, de q u e l ques
intervalles , comme de ceux de tierce en de G
cendant. Ainfi dans cet e x emple : .
irfZgz h—h—brb— — n
Vin - da fe*- de - Ik