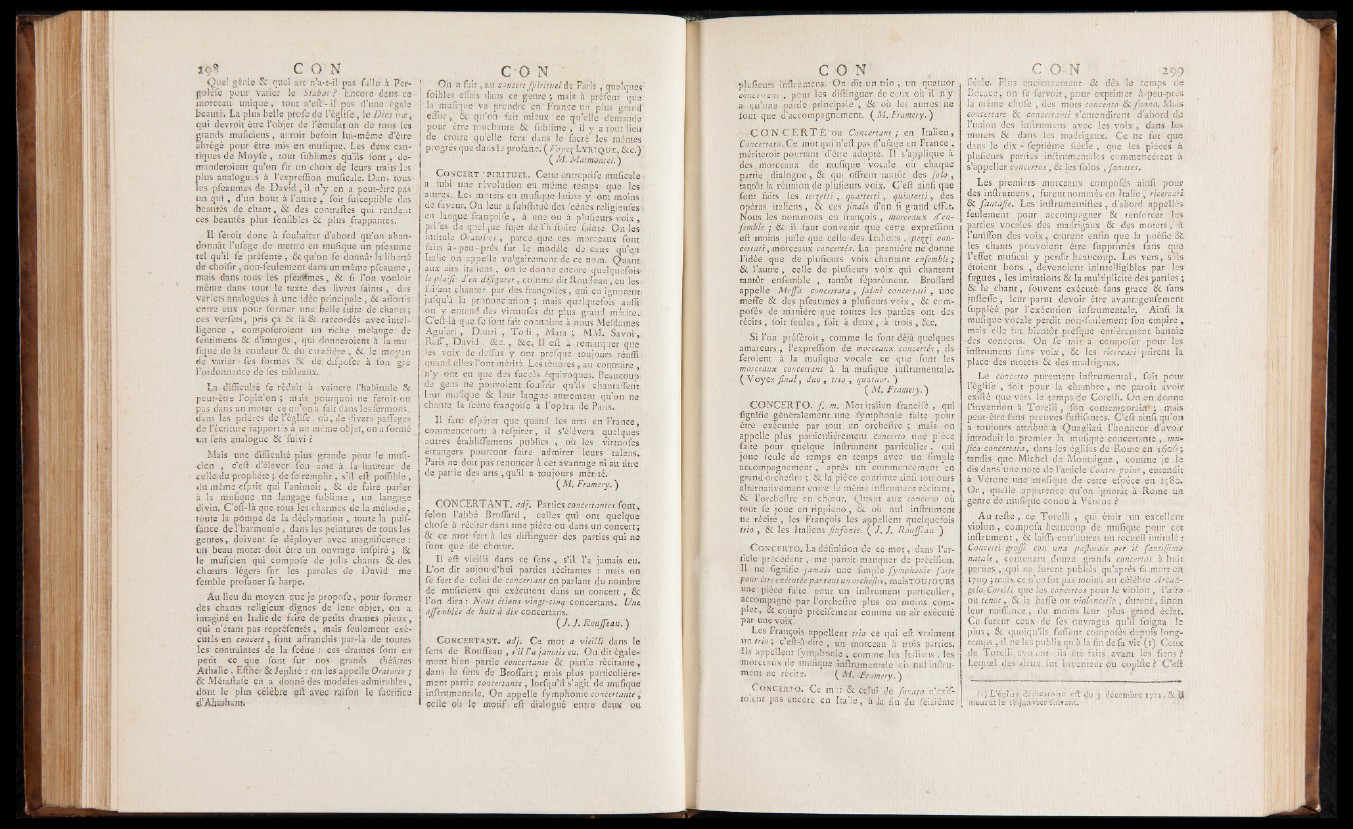
Qu.el génie & quel art nVt-il pas fallu k Per-
golèfe pour varier le S tabac ? Encore dans ce
morceau unique , tout n’eft - if pas d’une égaie
beauté. La plus belle profe de l ’églife, le Vies ira,
qui devroit être l’objet de l’émulation de tous les
grands muficiens , au roi t befoin lui-même d’être
abrégé pour être mis en mufique. Les deux cantiques
de M o y fe , tout fublimes qu’ils fo n t , demanderaient
qu’on fit un choix de leurs traits b s
plus analogues à l’exprellion muftcale. Dans lotis j
les pfeaumes de David * il n’y en a peut-être pas
un q u i, d’un bout à l’autre , foit fufceptible des
beautés de chant, & des contraires qui rendent
ces beautés plus fenfibîes & plus frappantes.
Il feroit donc à fouhaîter d’abord qu’on abandonnât
l ’ufage de mettre en mufique un pfeaume
tel qu’il fe préfente, & qu’on fe donnât la liberté
de choifir , rien-feulement dans un même pfeaume ,
mais dans tous les pfeàHmes, & fi l’on vouloir
même dans tout le texte des livres faints , des
verfets analogues à une idée principale , & affortis
entre eux pour former une belle fuite de chants;
ces verfets, pris çà & là & raccordés avec intelligence
, compoferoient un riche mélange de
fentimens 8c d’images , qui donneraient à la mu
fique de la couleur 8c du caraâère , & le moyen
de varier'-fes formes & de difpofer à fou gré
l ’ordonnance de fes tableaux.
La difficulté fe réduit à vaincre l’habitude &
peut-être l’opirfon ; mais pourquoi ne feroit-on
pas dans un moter ce qu’on a fait dans les fermons,
dans les prières de l’églife , où, de divers paffages
de récriture rapportés à un meme objet, on a formé
un fens analogue 8c fuivi ?
Mais une difficulté plus grande pour le mnfi-
cîen , c'eft d’élever fou ame à- la hauteur de
celle-du prophète ; de fe-remplir, s’il eft poffible ,
du même efprit qui l’animoit, & de faire parler
à la mufique un langage fublime , un langage
divin, C ’eft-là que tous les charmes de la mélodie,
toute la pompe de la déclamation , toute la puif-
fance de l’harmonie, dans les peintures de tous les
genres, doivent fe déployer avec magnificence :
un beau motet doit être un ouvrage infpirè ; &
le muficien qui compofe de jolis chants 8c des
choeurs . légers fur les paroles de David me
femble profaner fa harpe.
Au lieu du moyen que je propofe, pour former
des chants religieux dignes de leur objet, on a
imaginé en Italie de faire de petits drames pieux,
qui n’étant pas repréfentés , mais feulement exécutés
en concert, font affranchis par-là de toutes
les contraintes de la fcène : -ces drames font en
petit ce que font fur nos grands théâtres
Athalie , Efther & Jephté : on les appelle Oratorio ;
& Métafiafe en a donné des modèles admirables,
dont le plus célèbre eft avec raifon le facrifiçe
^’Ajwahan*.
C O N '
[ On a fa it, au concert fpirituel de Paris , quelques'
; faibles efiais dans ce genre; mais à préfent que"
la mufique va prendre en France un plus grand
i éffor, 6c qu’on fait mieux ce qu’elle demande
pour être touchante 6c fublime , il y a tout lieu-
de croire qu’elle fera dans le facré les mêmes
progrès que dans b profane. ( Voye^ Ly r iq u e , 6cc.)
( M. MarmomeL)
C o n c e r t " p ir it u e l . Cette entreprife muficale :
a fubi une révolution en même temps que les
autres. Les motets en mufique latine y ont moins
de faveur. On leur a fubftituédes fcènes religieufes •
en langue françoife , à uns ou à plufieurs voix ,
prises de quelque fujet de l’hiftoire fointe. On les
intitule Oratoires, parce .que ces morceaux font
faits à-peu-près fur le modèle de ceux, qü’^n
Italie on appelle vulgairement de ce nom. Quant
aux airs italiens , on fe donne encore quelquefois'
le plaïfir d'en défigurer , comme dit Roufieau, en les
f.iifant chanter par des françoifes., qui en ignorent’
jufqu’à la prônonc:ation ; mais quelquefois auffi-
on y entend des vimiofes du plus grand mérite.:
C ’eft-là que fe font fait connaître à nous Mefdames
Agurari , Danzi , Todi , Mara ; MM. Savoi ,
R a ff, David ; & c . , &c._ Il eft à remarquer que
ies voix de de (Tu s y ont prefqiie toujours réufli
quand eüesTont-mérité. Les ténores , au contraire ,
én’y ont eu que des fuccès équivoques. Beaucoup
de gens ne penvoient fouffrir qu’ils chantaffent
’leur mufique Sc leur langue autrement qu’on ne
chante la fcène françoife à l ’opéra de Paris.
Il faut efpérer que quand les arts en France,
commenceront à refpirer, il s’élèvera quelques
autres établiffemens publics , où les .virtuofès
étrangers pourront faire admirer ’ leurs talens.
Paris ne doit pas renoncer à cet avantage ni aü titre
de patrie des arts , qu’il a toujours mérité.'
( M. Framery. )
CONCERTANT, ad). Parties concertantes font,
félon l’abbé Broffard , celles qui ont quelque
chofe à réciter dans une pièce, ou dans un concert;
& ce mot fert à les diftinguer des parties qui ne
font que de choeur.
Il eft vieilli dans ce fens , s’il l’a jamais eu.
L’on dit aujourd’hui parties récitantes : mais on
fe fert de celui de concertant en parlant du nombre
de muficiens qui exécutent dans un concert, 8ç
i l’on dira : Nous étions vingt-cinq concertans. Une
a (fie m b Lé e de huit à dix concertans.
( J. J. Roujfieau. )
C o n c e r t a n t , ad]. Ce mot a vieilli dans le
fens de Rouffeau , s'il Va jamais eu. On dit également
bien partie concertante Si partie récitante ,
dans le fens de Broffart ; mais plus particulièrement
partie concertante , lorfqufil s’agit de mufique
inftrqmentale. On appelle fymphonie concertante ,
çelie pu le motif, e$ • dialogué ençre deiïjç ç y
C O N
[plufieurs iriftrumens. On dit.un trio , un ^quatuor
concertans , pour les difiinguer de ceux où il n’y
a qu’une partie principale , 8c- où les autres ne
font que d’accompagnement. {M . Framery.')
C O N C E R T É ou Concertant ; en Italien ,
Concertato. Çjs mot qui n’eft pas d’ufage en France ,
mériterait pourtant d’être adopté. Il s’applique à
des „morceaux de mufique vocale où chaque
partie dialogue , & qui offrent tantôt des fiolo,,
tantôt la réunion de plufieurs voix. C ’eft ainfi que
font faits les ter\ett\ , quartetti , quintetti, des
opéras italiens, ■ Si ces finals d’ un fi grand effet.
Nous les nommons en françois , morceaux d’en-
femble ; Si il faut convenir que cetre expreffion
eft moins jufie que celle des Italiens , pe^yï concertant
morceaux concertés. La première ne donne
l ’idée que de plufieurs voix chantant enfemble ;
Si l’autre, celle de plufieurs voix qui chantent
tantôt enfemble , tantôt féparément. Broffard
appelle Me (fia. concertata , falmi concertati , une
méfié 6c des pfeaumes à plufieurs voix , 6c ccm-
pofés de manière que toutes les parties ont des
récits , foit feules, foit à deux, à trois , &c.
Si l’on préféroit, comme le font déjà quelques
amateurs, l’expreffiori de morceaux concertés | ils
feroient à la mufique vocale ce que font les
morceaux concertans à la mufique inffrumentale.
( Voyez final, duo , trio , quatuor. )
( M. Framery. )
CONCERTO, fi. m. Mot italien francifé , qui
fignifiê généralement une fymphonie faite pour
être1 exécutée par tout, un orcheftre ; mais on
appelle plus particulièrement concerto une pièce
faite pour quelque infiniment particulier, qui
joue feule de temps en temps avec un fimple
accompagnement , après un commencement en
grand orchefire ; Si la pièce- continue ainfi toujours
■ alternativement entre le même infiniment récitant,
Si l’orcheffre en choeur. Quant aux concerto où
tout fe joue en rippieno, 8c où nul infiniment
rie récite , les François les appellent quelquefois
trio , 6c les Italiens finfonie. ( J. J. Roujficau )
Concerto. La définition de ce mot, dans l’article
précèdent, me paroît manquer de précifion.
Il ne fignifiê jamais une fimple fiymphonie■ faite
pour être exécutée partout un orchefire, maisTOUJOURS
une pièce faite pour un infiniment particulier,
accompagné par î’orcheffre plus ou moins complet,
oc coupé précifément comme un air exécuté
par une voix.
Les François appellent trio ce qui eff vraiment
un tno ; c’eft-à-dire , un morceau à trois parties.
•Ils appellent fyrirphonie , comme les Italiens > les
morceaux de mufique infirumentale eù nul infiniment
ne récite. ( M. ’Fr.imery.)
C o n c e r t o . "Ce m:t-& celui'de firaran'ex if-
toiçjit pas encore en Ita'.ie, à la fin fin felziêoee
fiècle. Fins anciennement & dès le temps cîe
Bocace, on fe fervoit, pour" exprimer à-peu-près
la même chofe , des mots concento Si fiuono, Mais
concertare Si concertanti s’entendirent d’abord de
l’union des inffrumens avec les voix , dans les
motets & dans les madrigaux. Ce ne fut que
dans le dix - feptième fiècle , que les pièces à
plufieurs parties inftrumentàles commencèrent à
s’appeller concertos, 6c les folos , fonates.
Les premiers morceaux ccmpofés ainfi pour
des inftrumens , furent nommés en Italie , ricercari
Si fantafie. Les inftrumemiffes , d’abord appelles
feulement pour accompagner Si renforcer les
parties vocales des madrigaux & des motets, -à
l’uniffon des v o ix , crurent enfin que la poéfie St
les chants pouvoient être fupprimés fans que
l’effet mufical y perdît beaucoup. Les vers, s’ils
étoient bons , devenoient inintelligibles par les
fugues , les imitations Si la multiplicité des parties ;
& le chant, fouvent exécuté fans grâce & fans
jufiéfie, leur parut devoir être avantageufement
fuppîéé par l’exécution inffrumentale. Ainfi la
mufique vocale perdit non-feulement fon empire ,
mais elle fut bientôt préfqùe entièrement bannie
des concerts. On fe mit à compofér pour les
inftrumens fans voix , & les ricercari prirent la
i placé des motets des madrigaux.
Le concerto purement inftrumental, foit pour
l’églife , foit pour la chambre, ne paroît avoir
exiffé que vers le temps de Corelli. On en deune
l’invention à T o r e lli, - fon contemporain* ; mais
peut-être fans preuvesTuffifantes. C ’eff ainfi qu’on
a toujours attribué à Quagliati l’honneur d’avoir
introduit le premier la mufique concertante , mu-
fica concertata, dans les églifes de Rome en 1606 ;
tandis que Michel de Montaigne, comme je le
dis dans une noté de l'article Contre point, entendit
à Vérone une m «fique de cette efpèce en 15 80.
O r , quelle apparence qu’on ignorât à Rome un
genre de mufique connu à Vérone ?
Au refte , ce Torelli , qui étoit un excellent
violon , compofa beaucoup de mufique pour cet
inftrument, Si laiffa entr’autres un recueil intitulé r
Concerti grofifi con un a pafiorale per il fiant [(fimo
natale , contenant douze grands, concertos à huit
parties qui ne furent publiés qu’après fa mort en
I709 ; mais, ce n’esffut pas moins au célèbre Arcaâ-
gelo-CoreUi que les concertos pour Je violon , T alto
ou t é n o r & la baffè ou violoncello , durent, finon
leur naiffance , du moins leur plus grand éclat.
Ce furent ceux dé fes. ouvrages qu’il foigna Te
plus; Si quoiqu’ils fuffent cojnpofés depuis longtemps
, il ne les publia qu’à la fin de fa vie (1). Ceux
M,e Toreili, avoient - ils été faits avant les liens i
Lequel des Meux, fut inventeur ou eopîffe ? C ’eft
'■ ,. (0 L’épîire;Hécl}caroii:e éft‘ du 3 décembre 1722, &. $
[ mourtn: le’- rS*jaavier fuivant. -