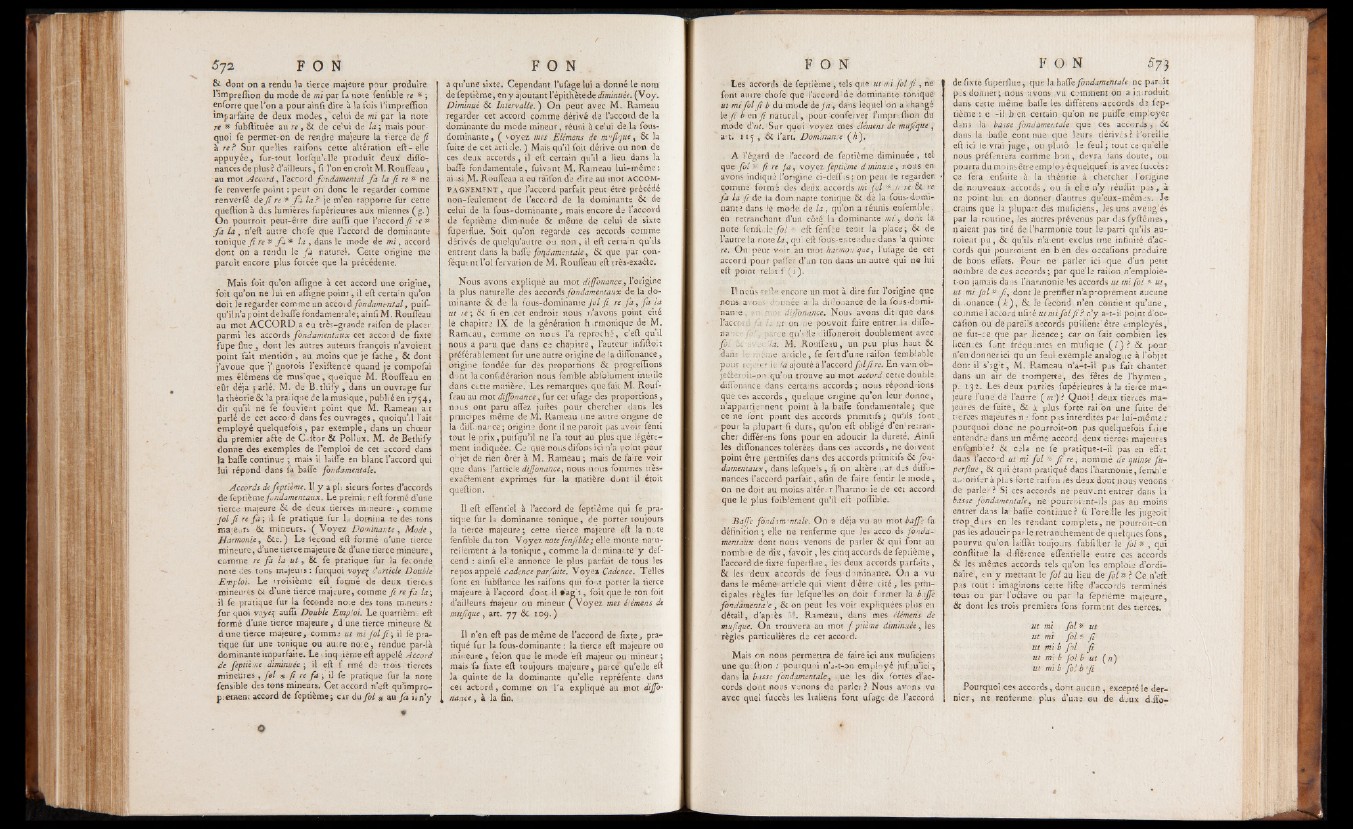
& dont on a rendu la tierce majeure pour produire
l’impreflion du mode de mi par fa note fenfible re * ;
enforte que Ton a pour ainfl dire à la fois l’impreffion
imparfaite de deux modes, celui de mi par la note
re * fubftituée au re, & de ce-ui de la ; mais pourquoi
fe permet-on de rendre majeure la tierce de fi
à re? Sur quelles raifons cette altération eft-elle
appuyée, fur-tout lorfqu’clle produit deux' diffbr
nances de plus ? d’ailleurs, fi l’on en croit M. Rouffeau ,
au mot Accord, l’accord fondamental fa la f i re * ne
fe renverfe point : peut on donc le regarder comme
renverfé de f i re * fa la? je m’en rapporte fur cette
queftion à des lumières fupérieures aux miennes (g .)
On pourroit peut-être dire aufli que l’accord f i re *
fa la , n’eft autre chcfe que l’accord de dominante
tonique f i re* f a * la , dans le mode de mi, accord
dont on a rendu le fa naturel. Cette origine me
paroît encore plus fotcée que la précédente.
Mais foit qu’on afligne à cet accord une origine,
foit qu’on ne lui en afligne point, il eft certa'n qu’on
doit le regarder comme un actoi d fondamental, puif-
qu’iln’a point de baffe fondamentale; ainfl M. Rouffeau
au mot A C CO R D a eu très-grande raifon de placer
parmi les accords fondamentaux cet accord de fixte
îupe fluej dont les autres auteurs françois n’avoient
point fait mentidn , au moins que je fâche, & dont
j’avoue que j’ignorois l’exiftence quand je compofai
mes élémens de musique, quoique M. Rouffeau en
eût déjà parlé. M. de B .th ify , dans un ouvrage fur
la théorie & la praûqoe de la musique, publié en 1754,
dit qu’il ne fe fouvient point que M. Rameau a.t
parlé de cet accord dans fes ouvrages , quoiqu’il l’ait
employé quelquefois, par exemple, dans un choeur
du premier aéle de Caftor & Pollux. M. de Bethîfy
donne des exemples de l’emploi de cet accord dans
la baffe continue ; mais il laiffe en blanc l’accord qui
lui répond dans fa baffe fondamentale.
Accords de feptième. Il y a pl : sieurs fortes d’accords
de feptième fondamentaux. Le premier eft formé d’une
tierce majeure & de deux tierces mineure;, comme
fo l f i re fa', A fe pratique fur la domina te des tons
majeurs & mineurs. ( Voyez Dominante, Mode ,
Harmonie, &c. ) Le fécond eft formé ü’une tierce
mineure, d’une tierce majeure & d’une tierce mineure,
comme re fa la u t , & fe pratique fur la fécondé
note des tons majeurs: furquoi voye% l’article Double
Emploi. Le iroisième eft foçmé de deux tierces
mineures 61 d’unë tierce majeure, comme f i re fa la ;
il fe pratique fur la fécondé no.e des tons mineurs :
fur quoi voye\ aufli Double Emploi. Le quatrième eft
formé d’une tierce majeure, d'une tierce mineure &
d une tierce majeure, comme ut mi fo l fi\ il fe pratique
fur une tonique ou aucre noie, rendue par-là
dominante imparfaite. Le • inqiième eft appelé Accord
de feptième diminuée ; il eft f rmé de trois tierces
mineures, fol # fi re fa ; il fe pratique fur la note
fensible des tons mineurs. Cet accord n’eft qu’impro-
p.etnem accord de feptième; car du fo l * au fa ii n’y
a qu’une sixte. Cependant l’ufage lut a donné le nom
de feptième, en y ajoutant l’épithète de diminuée, (Voy.
Diminué & Intervalle. ) On peut avec M. Rameau
regarder cet accord comme dérivé de l’accord de la
dominante du mode mineur, réuni à celui de.la fous-
dominante, ( voyez mes Elémens de mufique, & la
fuite de cet article. ) Mais qu’il foit dérivé ou non de
ces deux accords, il eft certain qu’il a lieu dans la
baffe fondamentale, fuivant M. Rameau lui-même:
ainsi M. Rouffeau a eu railon de dire au mot ACCOM-
PAGNEMFNT, que l’accord parfait peut être précédé
non-feulement de l’accord de la dominante & de
celui de la fous-dominante , mais encore de l’accord
de feptième diminuée & même de celui de sixte
fuperflue. Soit qu’on regarde ces accords comme
dérivés de quelqu’autre ou non, il eft certam qu’ils
entrent dans la baffe fondamentale, & que par çon-
féqutnt loifetvation de M. Rouffeau eft très-exa&e.
Nous avons expliqué au mot diffonance, l’origine
la plus naturelle des accords fondamentaux de la dominante
& de la fous-dominante Jol f i re f a , fa la
ut te ; & fl en .cet endroit nous n’avons point cité
le chapitre IX de la génération h.rmonique de M.
Rameau, comme on nous l’a reproché, c’eft qu’il
nous a paru que dans ce chapitre, l’auteur infiftoit
préférablement fur une autre origine de !a diffonance,
origine fondée fur des proportions & progreffions
dont la confidération nous femble abfolument inutile
dans cette matière. Les remarques que fait M. Rouffeau
au mot diffonance, fur cet ufage des proportions,
nous ont paru affez juffes pour chercher dans les
principes même de M. Rameau une autre origine de
la uiffonarce ; origine dont il ne paroît pas avoir fenti
tout le prix, puifqu’il ne l’a tout au plus que légèrement
indiquée. Ce que nous difons ici n’a point pour
objet de rien ôrér à M. Rameau ; mais de faire voir
que dans l’artîcie diffonance, nous nous fommes très-
exa&emënt exprimés fur la matière dont il étoit
queftion.
Il eft effentiel à l’accord de feptième qui fe pratique
fur la dominante tonique, de porter toujours
la tierce majeure ; cette tierce majeure eft la note
fenfible du ton Voyez note fenfible; elle monte naturellement
à la tonique, comme la dnminaote y def-
cend : ainfi elle annonce le plus parfait de tous les
repos appelé cadence parfaite. Voyez Cadence. Telles
font en fubftance les raifons qui fo*.t porter la tierce
majeure à l’accord dont il ttag't, foit que le ton foit
d’ailleurs majeur ou mineur (V o y e z mes élémens de
mufique, art. 77 &. 109*)
11 n’en eft pas de même de l’accord de fixte, pratiqué
fur la fous-dominante : la tierce eft majeure ou
mineure, félon que le mode 'eft majeur ou mineur;
mais fa fixte eft toujours majeure, pat cèf qu’elle eft
la quinte de la dominante qu’elle repréfente dans
cet accord, comme on Ta expliqué au mot dijfo-
riance, à la fin.
O
Les accords de feptième , tels que utrïiifil f i , ne
font autre chofe que l’accord'de dominante tonique:
ut mi fol f i b du mode de dans leqiiel on a changé
1 e f i b en f i naturel, pour conferver l’imprcftion du’
mode d'ut. Sur quoi voyez meé‘ élemens de mufiqUe ,
ait. 115 , & l’art. Dominante (h f .'
A l’égard de l’accord de feptième diminuée, tel
que f o l * f i re fa , voyez feptième d minute, nous en
avons indiqué l’origine ci-deff.;s; on peut le regarder,
comme formé des deux accords mi fai *,.Ji rè & re-,
fa la f i de la dominante tonique & dè la fous-domk
liante dans le mode de la, qu’on a réunis enfemble,
en retranchant d’un côté h dominante mi, dont la
note fehfeAe.fol * eft fenfée tenir la place; & de
l’autre la note la, qui. eft fous-entendue dans 'a quinte
re. On peut voir au mot harmonique, l ulage de cet
accord pour paffer d’an ton dans un autre qui ne lui
e f t point relatif ( i) . I
Il nous refte encore un mot à dire fur l’origine que
nous, avons donnée à la diffonance de la fous-dominante
, ?.n mot diffonance. Nous avons dit que dans
l’accord f i lu ut on ne pouvoit faire entrer .la diffo-
na icc fol, parce qu’elle diffoneroit doublement avec
foi ék avec'la. M. Rouffeau, un peu plus haut &
dans le rnéme article, fe fertd’une raifon femblable
pour rejeter k la ajouté à l’accord folfirc. En vain ob-
je&eroit-on qu?on trouve au mot accord cette double
diffonance dans certains accords ; nous répondrions
que ces accords , quelque origine qu’on leur donne,
n’appartiennent point à la baffe fondamentale ; que
ce ne font point des accords primitifs ; qu’ils font
pour la plupart fx durs, qu’on eft obligé d’en’ re:tanche
r différens fons pour en adoucir la dureté. Ainfl
les diffonances tolérées dans ces accords, ne doivent
point être permifes dans des accords primitifs & fondamentaux,
dans lefque'.s, fl on altère j.ar des diflb-
nances l’accord parfait, afin de faire fentir le mode,
on ne doit au moins altér. r l’harmor ie de cet accord
que le plus foiblement qu’il eft poflible.
Baffe fondamentale. On a déjà vu au mot bajfe fa
définition; elle ne renferme que les acco.ds fondamentaux
dont nous venons de parler & qui font au
nombi e de dix, favoir, les cinq accords de feptième,
l’accord de fixte fuperflue, les deux accords parfaits,
& les d-eux accords de fous-dominante. On a vu
dans le même article qui vient d'être cité, les principales
règles fur lefque'les on doit former la baffe
fondamental , & on peut les voir expliquées plus en
détail, d après M. Rameau, dans mes démens de
mufique. On trouvera au mot ƒ ptième diminuée, les
règles particulières de cet accord.
Mais on nous permettra de faire ici aux mufiçiens
une queftion ; pourquoi n’a-t-on employé jujfau’ici,
dan* la b isse fondamentale, vue les dix fortes d’accords
dont nous venons de parler ? Nous avons vu
avec quel fuccès les Italiens font ufage de l’accord
de fixte fuperflue, que la batte fondamentale ne paraît
p.s donner; nous avons vu comment on a introduit
dans cette même baffe les différens accords d? feptième
: e -if bien certain qu’on ne puifle employer
dans la basse fondamentale que ces accords, &
dans la bafle cont nue que leurs dérivés? loreille
eft ici le vrai juge, ou plutô. le feul; tout ce quelle
nous préfentera comme bon, devra fans doute, ou
pourra du moins être emploi é quelquefois avec fuccès :
ce fera enfuite à la théorie à chercher l'origine
de nouveaux accords, ou ft è-ie n’y .léuflit pas, à
ne point-lui tn donner d’autres .qu’eux-mêmes. Je
crains que la plupart des mufiçiens, les uns aveug’és
par la routine, les autres prévenus par des fyfleures,
p aient pas tiré de l’harmonie tout le. parti qu’ils au-
roient pu, & qu’ils n’a.ent exclus une infinité d’accords
qui pourroient en b en des occafions produire
de bons effets. Pour ne parler ici que d’un petit
nombre de ces accords; par que’le raifon n’emploie-
t-on jamais dans l’harmonie les accords ut mi fol *■ ut,
ut mi fol * fi, dont le prenfler n’ap'Oprement aucune
di..onance ( k'), & le fécond n’en confie it qu’une,
comme l’accord ufité ut mi fo l fi?fi. y a-t-il point d’oc-
cafion ou de pareils accords puifient être employés,
ne fut-ce que par licence; car on fait combien les
licences fl.nt fréquentes en mufique ( / ) ? & pour
n’en donner ici qu un feul exemple analogue à l’objet
dont il s’sg 't, M. Rameau n’a-t-il pus fait chanter
dans un air de trompette, des fêtes de l’hymen,
p. 1.32. Les deux parties fupérieures à la tieice majeure
l’une de l’autre (tf*')- Quoi! deux tierces majeures
de fuite, & à plus forte raifon une fuite de
tierces majeures n r font pas interdites par lui-même :
pourquoi donc ne pourroit-on pas quelquefois faite
entendre dans un même accord deux tierces majeures
enfemble? & cela ne fe pratique-t-il pas en effet
dans l’acco“d ut mi fol * f i re, nommé de quinte fit-
pcrfiue, & qui étant pratiqué dans l’harmonie, femib’e
â^iorifer à plus forte raifon i.es deux dont nous venons
de parler? Si ces accords ne peuvent entrer dans la
basse fondamentale, ne pourroknt-ils pas au moins
entrer dans la baffe continue? fl l’oreille les jugeoit
trop^d.irs en les rendant complets, ne pourroit-cn
pas les adoucir parle retranchement de quelques fons,
pourvu qu’on laiffât toujours fubflfter le f i l * , qui
conftitue la différence effentielle entre ces accords
& les mêmes accords tels qu’on les emploie d’ordinaire',
tn y mettant le fo l au lieu de f i l * } Ce n’eft
pas tout : imaginons ce:te lifte d’accords terminés
tous ou parTottave ou par la feptième majeure,
& dont.les trois premiers fons forment des tierces.
ut mi fol * ut
ut mi fol * f i
ut mi b fo l f i
ut mi b fol b ut ( n )
ut mi b fo l b f i
Pourquoi ces accords, dont aucun , excepté le dernier,
ne renferme plus d’une ou de deux d.flb