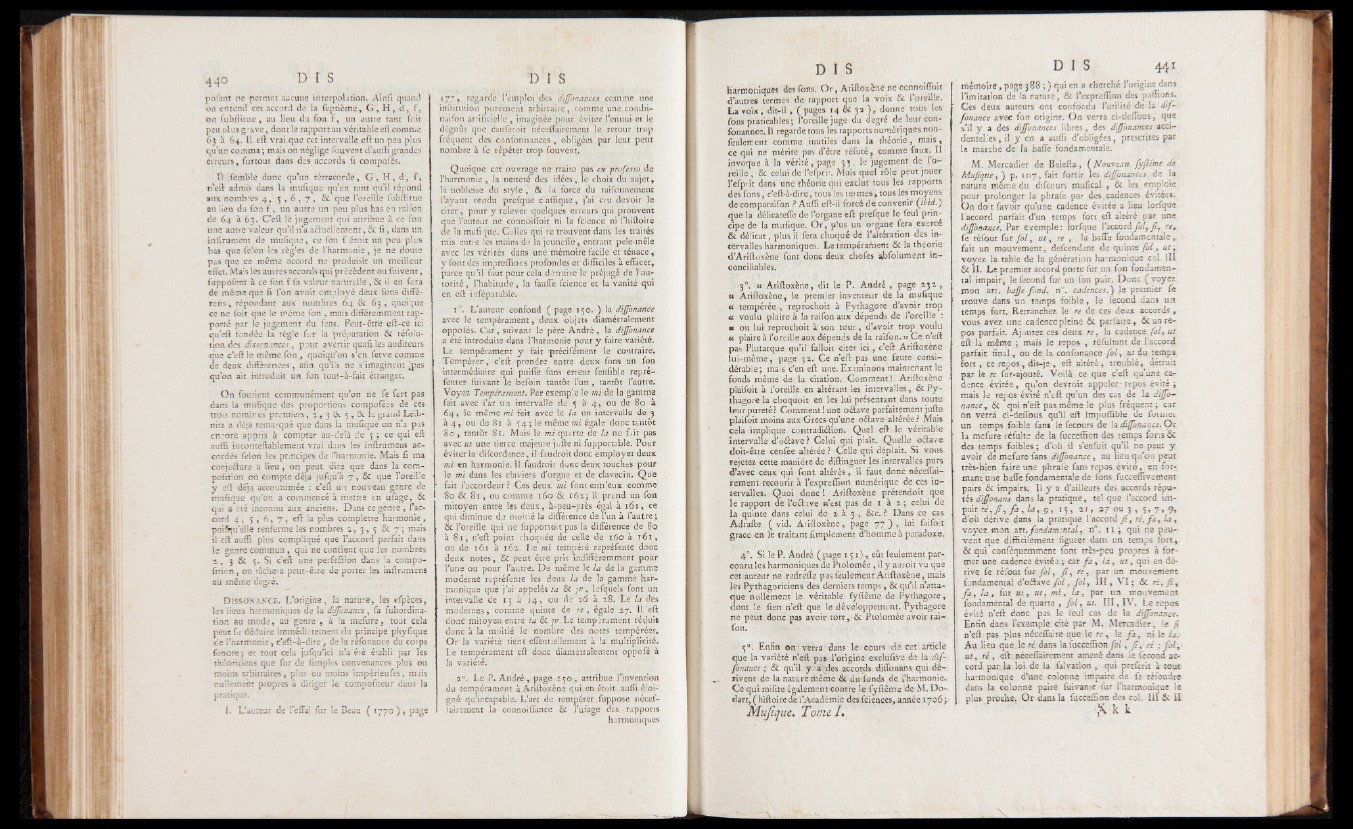
440 rD I S
pofant ne permet aucune interpolation. Ainfi quand
on entend cet accord de la feptième, G , H , d , f,
on fubftitue, au lieu du fon f , un autre tant foit
peu plus g-ave, dont le rapport au véritable eft comme
63 à 64. Il eft vrai que cet intervalle eft un peu plus
qu’un eomma ; mais on néglige fouvent d’auffi grandes
erreurs, furtout dans des accords fi compofés.
Il ffembie donc qu’un tétracorde, G , H , d , f ,
11’eft admis dans la mufique qu’en tant qu’il répond
aux nombres 4 , 3 , 6 , 7 , & que l’oreille fubftitue
au lieu du Ion f , un autre un peu plus bas en rai fon
de 64 à 63. C’eft le jugement qui attribue à ce fon
une autre valeur qu’il n’a aéhiellement, & f i , dans un
inilrument de mufique, ce fon f étoit un peu plus
bas que félon les règ'es de l’harmonie, je ne doute
pas que ce même accord ne produisît un meilleur
effet. Mais les autres accords qui précèdent ou.fuivent,
fuppofent à ce fon f fa valeur naturelle, & il en fera
de même que fi l’on avoit employé deux fons diffère
ns , répondant aux nombres 64 & 63 , quoique
ce ne foit que le même fon , mais différemment rapporté
par le jugement du fens. Peut-être eft-ce ici
qu’eft fondée la règle fur la préparation & réfolu-
tion des dissonances, pour avertir quafiles auditeurs
que c’eft le même fon , quoiqu’on s’en ferve comme
de deux différences , afin qu’ils ne s’imaginent jpas
qu’on ait introduit un fon tout-à-fait étranger.
On foutïent communément qu’on ne fe fert pas
dans la mufique des proportions compofées de ces
trois nombres premiers, 2 , 3 & 3 , & l e grand Leibnitz
a déjà remarqué que dans la mufique on n’a pas
encore appris à compter au-delà de 5 ; ce qui eft
suffi inconteftablement vrai dans les inftrumens accordés
félon les principes de l’harmonie. Mais fi ma
conjeâure a lieu , on peut dire que dans la com-
pofitron on compte déjà jufqu’à 7 , & que l’oreille
y eft déjà accoutumée : c’eft un nouveau genre de
mufique qu’on a commencé à mettre en ufage, &
qui a été inconnu aux anciens. Dans ce genre , l’accord
4 , 5 , 6 , 7 , eft la plus complette harmonie
puiftju’elle renferme les nombres 2 , 3 , 5 & 7 ; mais
il eft auffi plus compliqué que l’accord parfait dans
le genre commun, qui ne contient que les nombres
a , 3 & 5. Si c’eft une perfection dans la compo-
fition, on tâchera peut-erre de porter les inftrumens
au même degré.
D is so n an c e . L’origine, la nature, les efpèces,
les lieux harmoniques de la dïffcnance, fa fubordina-
tion au mode, au genre , à la mefure, tout cela
peut fe déduire immédiatement du principe phyfique
ce l’harmonie, c’eft-à-dire , de la réfonance du corps
fonore; et tout cela jufqu’ici n’a été établi par les
théoriciens que fur de fimples convenances plus ou
moins arbitraires, plus ou moins impérieufes, mais
nullement propres à diriger le compofiteur dans la
pratique.
I. L’auteur de Teffai fur le Beau ( 1770 ) , page
D I S
177, regarde l’emploi des dijfonances comme une
inftitution purement arbitraire, comme une combinai
fon artificielle, imaginée pour éviter l’ennui et le
dégoût que cauferoit néceffai rement le retour trop
fréquent des confonhances, obligées par leur petit
nombre à fe répéter trop fouvent.
Quoique cet ouvrage ne traite pas ex professo de
l’harmonie, la netteté des idées, le choix du sujet,
la noblesse du sty le, & la force du raifonnement
l’ayant rendu prefque c'affique, j’ai cru devoir le
citer, pour y relever quelques erreurs qui prouvent
que l’auteur ne connoilfoit ni la fcience ni l’hiftoire
de la mufi.jue. Cèles qui te trouvent dans les traités
mis entre les mains de la jeuneffe, entrant pele-mêle
avec les vérités dans une mémoire facile et ténace ,
y font des impreffions profondes et difficiles à effacer,
parce qu’il faut pour cela détruire le préjugé de l ’autorité
, l’habitude, la fauffe fcience et la vanité qui
en eft inféparable.
i°. L’auteur confond ( page 150. ) la dijfonance
avec le tempérament, deux objets diamétralement
oppofés. Car, suivant le père André, la dijfonance
a été introduite dans l’harmonie pour y faire variété.
Le tempérament y fait précifément le contraire.
Tempérer, c’eft prendre entre deux fons un fon
intermédiaire qui puiffe fans erreur fenfible repré-
fenter fuivant le befoin tantôt l’un , tantôt l’autre.
Voyez Tempérament. Par exemple le mi de la gamme
fait avec l'ut un intervalle de 5 à 4, ou de 80 à
6 4 , le même mi fait avec le la un intervalle de 3
à 4 , ou de 81 à 5 4 ; le même mi égale donc tantôt
00 , tantôt 81. Mais le mi quarte de la ne fait pas
avec ut une tierce majeure jufte ni Supportable. Pour
éviter la difcordance, il faudroitdonc employer deux
mi en harmonie. Il faudroit donc deux touches pour
le mi dans les claviers d’orgue et de clavecin. Que
fait l’accordeur ? Ces deux mi font entr’eux comme
80 & 8 1 , ou comme 160 & 162 ; il prend un fon
mitoyen entre les deux, à-peu-près égal à 16 1 , ce
qui diminue de moitié la différence de l’un à l’autre;
& l’oreille qui ne fupportoit pas la différence de 80
à 8 1 , n’eft point choquée de celle de 160 à 161,
ou de 161 à 162. Le mi tempéré repréfente donc
deux notes, & peut être pris indifféremment pour
l’une ou pour l’autre. De même le la de la gamme
moderne repréfente les deux la de la gamme harmonique
que j’ai appelés ta & jv , lefquels font un
intervalle de 13 à 14 , ou de 26 à 28. Le là dès
modernes, comme quinte de re. , égale 27. Il eft
donc mitoyen entre ta & jv. Le tempérament réduit
donc à la moitié le nombre des notes tempérées.
Or la variété tient effentiellement à la multiplicité.
Le tempérament eft donc diamétralement oppofé à
la variété.
20. Le P. André, page 130, attribue l’invention
du tempérament à Ariftoxène qui en étoit auffi éloigné
qu’incapable. L’art de tempérer fuppose nécef-
fairement la connoiffance & l’ufage des rapports
harmoniques
D 1 S
harmoniques des fons. O r , Ariftoxcne ne ccnnoiffoit
d’autres termes de rapport que la voix & l’oreille.
La voix, dit-il , ( pages 14 & 32 )„ donne tous les
fons praticables ; l’oreille juge du degré de leur con-
fonannee. 11 regarde tous les rapports numériques non-
feulement comme .inutiles dans la théorie, mais,
ce qui ne mérite pas d’être réfuté, comme faux. Il
invoque à la vérité, page 3 3 > le jugement de 1 o-
reille , & celui de l’efprir. Mais quel rôle peut jouer
l’efprit dans une théorie qui exclut tous les rapports
des fons, c’eft-à-dire, tous les termes, tous les moyens
de comparaifon ? Auffi eft-il forcé de convenir (ibid.)
que la délicateffe de l’organe eft prefque le feul principe
de la mufique. O r , plus un oreane fera exercé
& délicat, plus il fera choqué de l’altération des intervalles
harmoniques. Le tempérament & la théorie
d’Ariftoxène font donc deux chofes abfolument inconciliables.
30. « Ariftoxène, dit le P. André , page 232.,
« Ariftoxène, le premier inventeur de la mufique
ti tempérée , reprochoit à Pythagore d’avoir trop
« voulu plaire à la raifon aux dépends de l’oreille :
« on lui reprochoit à son tour, d’avoir trop voulu
« plaire à l’oreille aux dépends de la raifon. » Ce n’eft
pas Plutarque qu’il falloir citer ic i, c’eft Ariftoxène
lui-même, page'32. Ce n’eft pas une faute considérable;
mais c’en eft une. Examinons maintenant le
fonds même de la citation. Gomment! Ariftoxène
plaifoit à l’oreille en altérant les intervalles, & P y thagore
la choquoit en les lui présentant dans toute
leur pureté? Comment! une oéiave parfaitement jufte
plaifoit moins aux Grecs qu’une oélave altérée ? Mais
cela implique contradiélion. Quel eft le véritable
intervalle d’oâave? Celui qui plaît. Quelle o&ave
doit-être cenfée altérée ? Celle qui déplaît. Si vous
rejetez cette manière de diftinguer les intervalles purs
d’avec ceux qui font altérés, il faut donc néceffai-
rement recourir à l’expreffien numérique de ces intervalles.
Quoi donc ! Ariftoxène prétendoit que
le rapport de l’oâave n’est pas de 1 à 2 ; celui de
la quinte dans celui de %■ à 3 , &c. ? Dans ce cas
Adrafte ( vid. Ariftoxène, page 7 7 ) , lui faifolt
grâce en le traitant fimplement d’homme à paradoxe.
40. Si le P. André ( page 151.), eût feulement parcouru
les harmoniques de Ptolomée, il y auroit vu que
cet auteur ne redrefle pas feulement Ariftoxène, mais
les Pythagoriciens des derniers temps, & qu’il n’attaque
nullement le véritable fyftême de Pythagore,
dont le fien n’eft que le développement. Pythagore
ne peut donc pas avoir tort, & Ptolomée avoir raifon.
«j°. Enfin on verra dans le cours de cet article
que la variété n’eft pas l’origine exclufive de la dif-
fbndnce ; & qu’il y avdes accords diffo.nâns qui dérivent
de la nattire-même & du fonds dé i’hat monie.
Ce qui milite également contre le fyftême de M. Do-
darr, ( hiftoire de l’Académie des fciences, année 1706;
Mufique, Tome /.
D I S 4 4 1
mémoire, page 388;) qui en a cherché l’origine dans
l’imitation de la nature, & l’expreffion des pâmons.
Ces deux auteurs ont confondu futilité de la dif-
fonance avec fon origine. On verra ci-deffous, que
s’il y a des dijfonances libres, des dijfonances accidentelles
, il y en a auffi d’obligées, prescrites par
la marche de la baffe fondamentale.
M. Mercadier de Belefta, ( Nouveau fyftême de
Mufique, ) p. 107, fait fortir les dijfonances de la
nature meme du difeours mufical , & les emploie
pour prolonger la phrafe par des cadences évitées.
On doit favoir qu’une cadence évitée a lieu lorfque
l'accord parfait d’un temps fort eft altéré par une
dijfonance. Par exemple : lorfque l’accord fol, fi, re,
fe réfout fur fo l, u t, re , la baffe fondamentale,
fait un mouvement, defeendant de quinte fo l, ut ;
voyez la table de la génération harmonique col. IIL
& II. Le premier accord porte fur un fon fondamental
impair, le fécond fur un fon pair. Donc ( voyez
mon art. baße fond. n". cadences.) le premier fe
trouve dans un temps foible, le fécond dans un
temps fort. Retranchez le re de ces deux accords,
vous avez une cadence pleine & parfaite, & un repos
parfait. Ajoutez ces deux re, la cadence fol, ut
eft la même ; mais le repos , réfultant de l’accord
parfait final, ou de la confonance fo l, ut du temps
fort , ce repos , dis-je , eft altéré, troublé, détruit
par le re fur-ajouté. Voilà ce que c’eft qu’une cadence
évitée, qu’on devroit appeler-repos évité ;
mais le repos évité n’eft qu’un des cas de la dijfonance,
& qui n’eft pas même le plus fréquent; car
on verra ci-deffous qu’il eft impoffible de former
un temps foible fans le fecours de la dijfonance. Or
la mefure réfulte de la fucceffion des temps forts &
des temps foibles ; d’où il s’enfuit qu’il ne peut y
avoir de mefure fans dijfonance, au lieu qu’on peut
très-bien faire une phrafe fans repos é v ité , en formant
une baffe fondamentale de fons fucceffivement
pairs & impairs. Il y a d’ailleurs des accords réputés
diffonans dans la pratique, tel que i’accord impair
r é ,f i, f a , la, 9 , 15 , a i , 27 ou 3 , 5, 7 , 9,
d’où dérive dans la pratique l’accord f i , ré, fa , la ,
voyez mon art. fondamental, n°. 11 ; qui ne peuvent
que difficilement figurer dans un temps fort,
& qui conféquemment font très-peu propres à former
une cadence évitée ; car f a , la , ut, qui en dérive
fe réfout fur fo l , f i , ré, par un mouvement
fondamental d’o&ave f o l , fo l, I I I , V I ; & ri, f i ,
fa , la , fur ut, ut, mi, la, par un mouvement
fondamental de quarte , fo l, ut. I I I , IV. Le repos
évité n’eft donc pas le feul cas de la dijfonance.
Enfin dans l’exemple cité par M. Mercadier , le fi
n’eft pas plus néceffaire que le re, le fa , ni le la.
Au lieu que le ré dans la fucceffion f o l , f i , ré ; fo l,
ut, ré , eft néceffairement amené dans le fécond accord
par la loi de la falvation , qui preferit à tout
harmonique d’une colonne impaire de fe réfoudre
dans la colonne paire fuivante (ur l’harmonique le
plus proche. O r dans la fucceffion des col. III & II