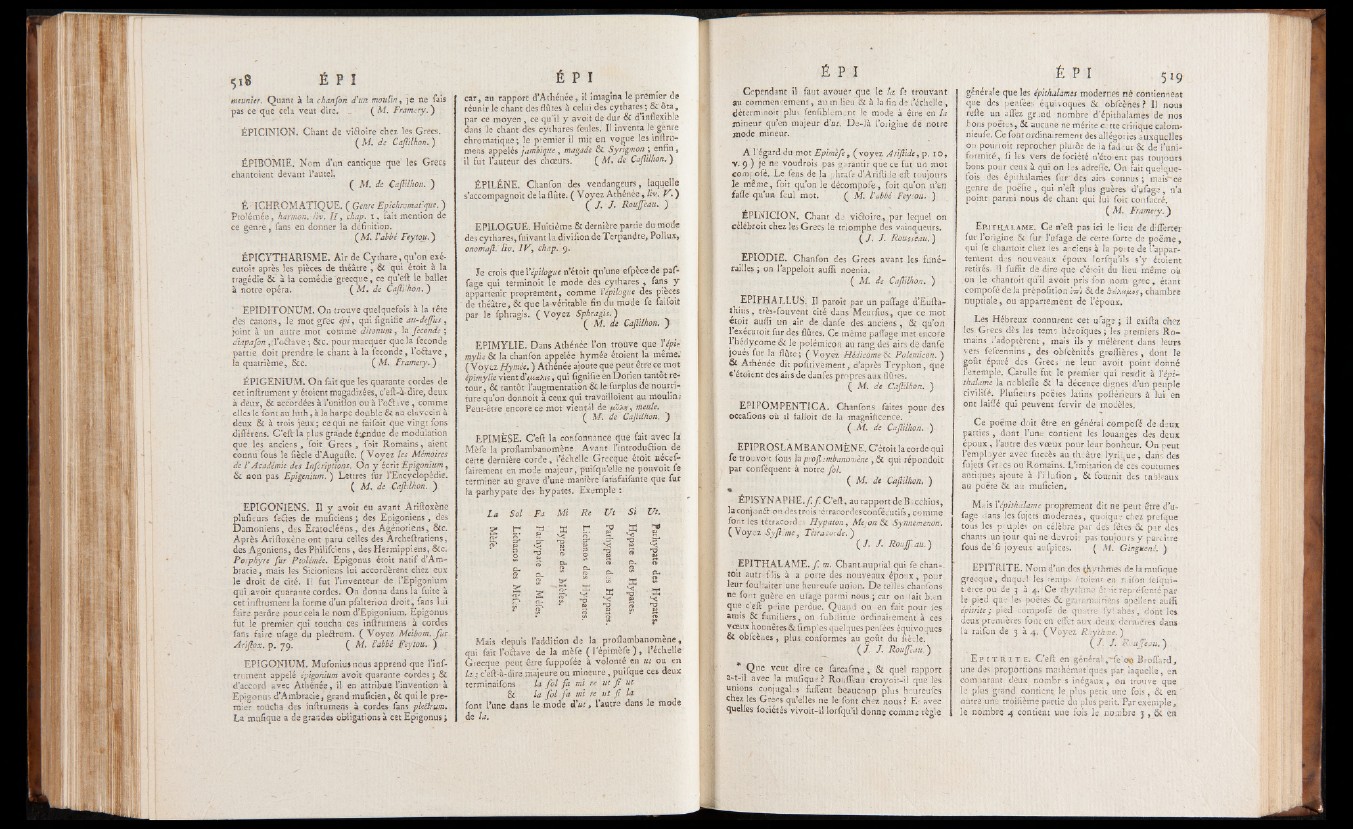
meunier. Quant à la chanfon d'un moulin, je ne fais
pas ce que cela veut dire.. _ ( M. Framery. )
É P IC 1N IO N . Chant de v iâ o ire chez les Grecs.
( M. de Caftilhon. )
ÉP IBOM IE . Nom d’un cantique que' les Grecs
chantoient devant l’autel.
( M. de Caftilhon. )
É ICH R OM A T IQ U E . ( Genre Epichromatupie. )
Ptoîémée, karman, liv. l ï \ chap. i , fait mention de
ce g en re, fans en donner la définition.
(À f. Vabbè Feytou. )
É P IC Y TH A R ISM E . A ir de C y th a re , qu’on exé-
eutoit après les pièces de théâtre , & qui étoit à la
tragédie & à la comédie grecque, ce qu’eft le ballet
à notre opéra. ( M. de Caftilhon. .)
" E P ID IT O N U M . O n trouve quelquefois à la tête
des canons, le mot grec épi, qui fignifie au-deffus,
joint à un autre mot comme ditonum, la fécondé ;
diapafon ,: Poêla ve -, & c . pour marquer que la fécondé
partie doit prendre le chant à la fécondé, l’o& a v e ,
la quatrième, & c . ( M. Framery. )
É P IG EN iUM . O n fait que les quarante cordes de
cet infiniment y étoient magadizées, c’eft-à- dire, deux
à deux, & accordées à i’uniÜon ou à i’oéta v e , comme
elles le font au lu th , à la harpe double & au clavecin à
deux & à trois jeux; ce qui ne faifoit que vingt fons
différens. C ’efr la plus grande étendue de modulation
que les anciens , foit Grecs , foit Romains, aient
connu fous le fiècle d’Augufte. ( V o y e z les Mémoires
de r Académie des Infcripfions. On y écrit Epigonium,
& non pas Epigenium. ) Lettres fur l’Encyclopédie.
( M. de Caftilhon. )
E P IG ON IEN S. Il y avoit eu avant Ariftoxène
plufieurs feéies de muficiens ; des Epigoniens, des
Damoniens, des Eratocléens, des Agénoriens, &c.
Après Ariftoxène ont paru celles des Archeftratiens,
des Agoniens, des Philifciens , des Hermippiens, &c.
Porphyre fur Ptoîémée. Epigonus étoit natif d’Am-
bracie, mais les Sicioniens lui accordèrent chez eux
le droit de cité. Il fut l’inventeur de l’Epigonium
qui avoir quarante cordes. On donna dans la fuite à
cet inftrument la forme d’un pfalterion droit, fans lui
faire perdre pour cela le nom d’Epigonium. Epigonus
fut le premier qui toucha ces inftrumens à cordes
fans faire ufage du ple&rum. ( V o y e z Meibom. fur
Ariftpx. p. 79. ( M, Vabbè Feytou. )
E P IG O N 1UM . Mufoniusnous apprend que l’inf-
trument appelé épigonium avoit quarante cordes ; &
d’accord avec Athéné e, il en attribue l’invention à
Epigonus d’Ambracie, grand muficien, & qui le premier
toucha des inftrumens à cordes fans pleélrum.
L a mufique a de grandes obligations à cet Epigonus ;
ca r , au rapport d’A théné e, il imagina le premier d«a
réunir le chant des flûtes à celui des cythares; &C o ta ,
par ce moyen , ce qu’il y avoit de dur & d inflexible
dans le chant dès cythares feules. Il inventa le genre
chromatique; le premier il mit en vogue les inftru-
mens appelés jambicpie, magade & Syrigmon ; enfin,
il fut l’auteur des choeurs. {M . de Caftilhon. )
ÉPILÉNE. Chanfon des vendangeurs , laquelle
s’accompagnoit de la flûte. ( V o y e z A thénee, liv. V . )
C ( J. J. Rouffeau. )
E P ILO G U E . Huitième & dernière partie du mode
des cythares, fuivant la divifion de Terpandre, Pollux,
onomafl. liv. IV , chap. .9.
Je crois que Y épilogue n’étoit qu’une efpèce de paf-
fage qui terminoit le mode des cythares , fans y
appartenir proprement, comme l'épilogue des pièces
de théâtre, & que la-véritable fin du mode fe faifoit
par le fphragis. ( V o y e z Sphragis. )
( M. de Caftilhon. )
E P IM Y L ÏE . Dans Athénée l’on trouve que Ÿépi*
mylie & la chanfon appelée hymée étoient la même:
(V o y e z Hymée. ) Athénée ajoute que peut être ce^mot
épimylie vient d't/taXts, qui fignifie en Dorien tantôt retou
r, & tantôt l’augmentation & le furplus de nourriture
qu’on donnoit à ceux qui travailloient au moulin}
Peut-être encore ce mot vient-il de fiuto, meule.
( M:. de Caftilhon. )
EPIMÈSE. C ’eft la confonnance que fait avec la
Mèfe la proflambanomène. A van t l’introduâion de
cette dernière co rd e, l’échelle Grecque étôit oecef-
fai rement en mode majeur, puifqu’elle ne pouvoit fe
terminer- au grave d’une manière fatisfaifante que fur
la parhypate des hypâtes. Exemple :
La Sol Fa Mi Re Ut Si Ut.
Mais depuis l’addition de la proflambanomène,
qui fait l’oétave de la mèfe ( 1 épimefe ) , l’echelle
Grecque peut être fuppofée à volonté en ut ou en
la;, c’eft>à-dire majeure ou mineure, puifque ces deux
terminaifons la fo l fa mi re ut f i ut
& la fol fa mi re ut J i la
font l’une dans le mode d'ut, l’autre dans le mode
de la.
Cependant il faut avouer que le la fe trouvant
au commencement, au m.lieu & à la fin de i’échelle,
déterminait. plus fenfiblement le mode à être en la
mineur qu’en majeur d'ut. D e - là l’origine de notre
mode mineur.
A l ’égard du mot Epimefe 9 ( v o y e z Arïftide, p. 10 ,
V. 9 ) je ne voudrois pas garantir que ce fut un mot
compofé. Le fens de la phrafe d’Arifti Je eft toujours
le même, foit qu’on le décompofe, foit qu’on n’en
faite qu’un feul mot. ( M. l'abbé Feytou. )
É P IN IC IO N . Chant de viéloire., par lequel on
célébroit chez les Grecs le triomphe des vainqueurs.
( J. J. Rousseau. )
E P IO D IE . Chanfon des Grecs avant les funérailles
; on l’appeloit aufîi noenia.
( M. de Caftilhon. , )
E P IPH A L LU S . II paraît par un paflage d’Euftà-
th iu s , très-fou vent cité dans Meurfius., que ce mot
étoit auffi un air de danfe des .anciens , & qu’on
1 executoit fur des flûtes. C e même paflage met encore
l’hedycome & le polémicon au rang des airs de danfe
joues fur la flûte ; ( V o y e z Hédicôme & Polémicon. )
& Athénée dit pofitivement, d’après T ryp h o n , que
« étoient des airs de danfes propres aux flûtes.
( M. de Caftilhon. )
E P IP O M P E N T IC A . Chanfons faites pour des
occafionç ou il falloir de la magnificence.
. ( M. de Caftilhon. )
E P IPR O S LAM B AN OM È N E . C ’étoit la corde qui
fe trou vo*t fous là profl imbanomène, & qui répondoit
par conféquent à notre fol.
( M. de Caftilhon. )
•
ÉPÏSYN A PH E . ƒ ƒ C ’eft , au rapportdeBscchius,
la conjonéf on des trois 'étracordes'confécutifs, comme
font les tétracord:- Hypaton, Me;on & Synnemenon.
(V o y e z Syfilme, Tétracorde.f
( 7 . J. Rouffau.)
E P ITH A L AM E . f . m. C h an t nuptial qui fe chan-.
toit au tr - f'is à ,a porte des nouveaux épou x, pour
leur fouhaiter uneheureufe union. D e telles chanfons
ne font guère en ulàge parmi nous ; car on fait bien
que c’eft peine perdue. Quand on en fait pour fes
amis & familiers, on fubliitue ordinairement à ces
voeux honnêtes &fimp'es quelques penfées équivoques
& obfcèiies, plus conformes au goût du fiècle.
( / , J. Rouffeau. ) -
’ Q u e veut dire ce farcafme , & quel rapport
a-t-il avec la mufique ? Rouffeau croyoit-il que les
unions conjugales fufTent beaucoup plus heureufes
chez les Grecs qu’elles ne le font chez nous? Er avec
quelles focietés vivoit-il lorfqu’il donne commî règle
générale que les épithalames modernes nê contiennent
que des penfées équivoques & obfcèhes ? Il nous
refte un a fiez grand nombre d ’épithalames de nos
bons poètes, & aucune ne mérite cette critique calom-
nieufe. Ce font ordinairement des allégories 2 uxquelles
on pounoit reprocher plutôt de ia fadeur & de l’uniformité,
fi les vers de fociété netoiènt pas toujours
bons pour ceux à qui on les adreffe. On fait quelquefois
des épithalames fu r 'd e s airs connus ; mais*"ce
genre de p o ë fie , qui n’eft plus guères d’u fage, n’a
point parmi nous de chant qui lui foit confacré.
( M. Framery. )
E p.ith _a i .ame. C e n’eft pas ici le lieu de difîèrter
fur l’origine & fur l’ufage. de cette forte de poème ,
qui fe chantoit chez les anciens à la porte de l’appartement
dr*s nouveaux époux lorfqu’ils s’y étoient
retirés. 11 fuffit de dire que c’étoit du lieu même où
.on le chantoit qu'il avoit pris fon nom g r e c , étant
compofé de la prépofition *em & d e .9-«actftos, chambre
nuptiale, ou appartement de l’époux.
Les Hébreux connurent cet ufage ; il exifta chez
les Grecs dès les tenr, héroïques ; les premiers R o mains
i’adoptèrent, mais ils y mêlèrent dans leurs
yers fefeennins , des obfcènités greflières , dont le
goût épuré des G re ci ne leur avoit point donné
l’exemple. Catulle fut le premier qui resclit à Yèpi-
thalame la ncblelïe & la décence dignes d’un peuple
civilifé. Plufieurs poètes latins poftérieurs à lui en
ont laifle qui peuvent fervir de modèles.
C e poème doit être en générai compofé de deux
partie s, dont Tune contient les louanges des deux
époux , l’autre des voeux pour leur bonheur. On peut
l’employer avec fuccès au th-àtre ly r iq u e , dans des
fujetS Grecs ou Romains. L ’imitation de cês coutumes
antiques ajoute à l’illafion , & fournit des tableaux
au poète & au muficien.
Mais l'épithalame proprement dit ne peut être d’ufage
'dans les fujets modernes, quoique chez prefque
tous les peuples on célèbre par des.fêtes & par des
chants un jour qui ne dovrôic pas toujours y parcître
fous de‘ fi joyeux aufpices. ( M. Ginguené. )
EPITR 1T E . Nom d'un des çhythmés de la mufique
grecque, duquel les :emps étoient en raifon fefqui-
t erce ou de 3 à 4. Gé Thythme étoit repréfenté par
le pied que les poètes & grammairiens apellent aufti
épitrite; pied compofé de quatre fyi abes, dont les
deux premières font en effet aux deux dernières dans
la raifon de 3 à 4. (V o y e z Rhythme.)
( / . J. Rouffeau. )
E p i t r i t e . C ’eft en .général ," fe 00 Broffard,
une des proportions mathémarques par laquelle, en
comparant deux nombres inégaux , on trouve que
le plus grand contient, le plus petic une fo is , & en '
outre une troifième partie du plus petit. P^r exemple,
le nombre 4 contient une fois le nombre 3 , & en