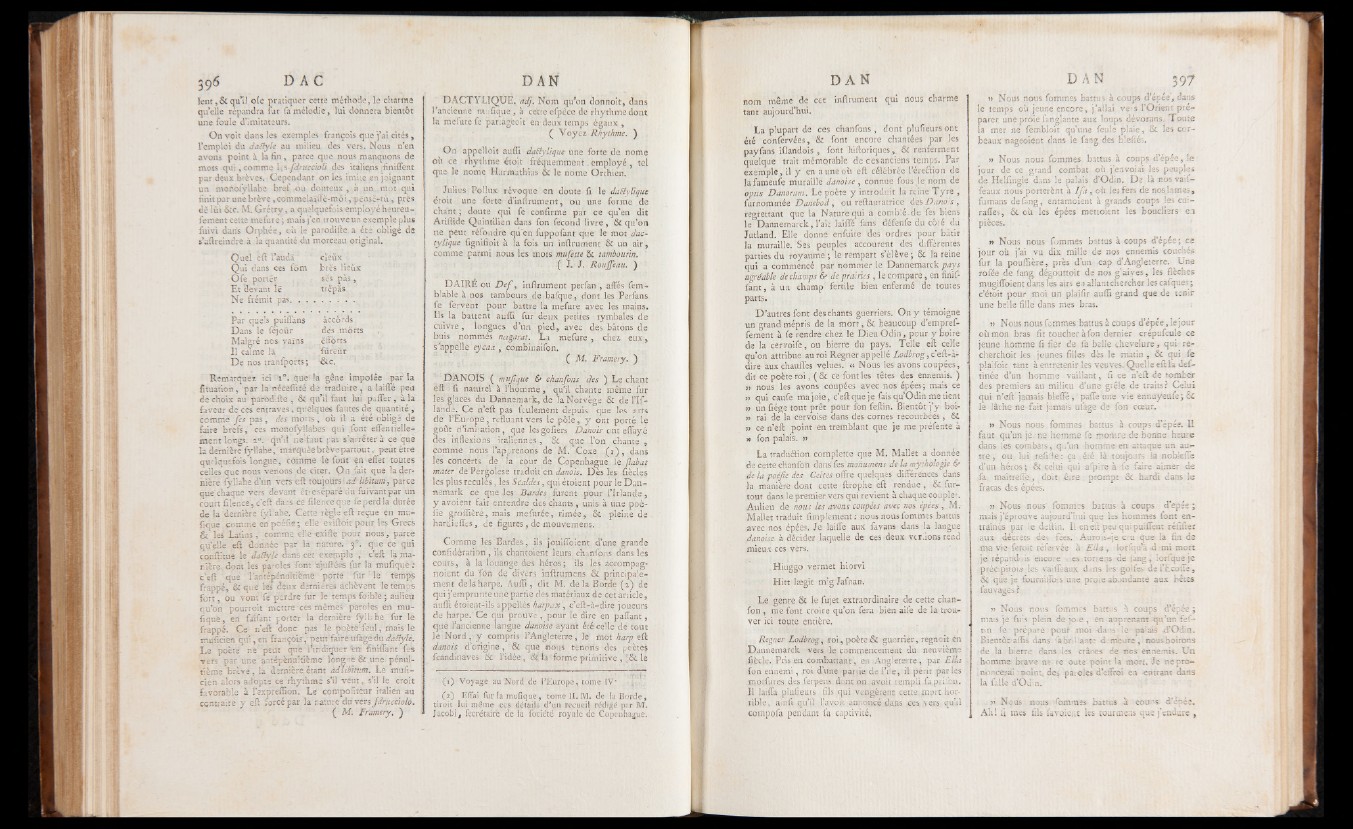
396 D A C
lent, & qu’il oie pratiquer cette méthode,le charme
quelle répandra lur fa mélodie, lui donnera bientôt
une foule d'imitateurs.
On voit dans les exemples françois que fai cités,
l’emploi du datfyle au milieu des vers. Nous n’en
avons point à la fin, parce que nous manquons de
mots q u i, comme l;s fdruccioü des italiens ( fini fient
par deux brèves. Cependant on les imite en joignant
un monosyllabe bref ou douteux, à un, mot qui
finit par une brève, commelalil è-môi, pënsèrtu, prés
de lui Sic. M. G rétry, a quelquefois employé heureusement
cette mefure; mais j’en trouve un exemple plus
fuivi dans Orphée, où le parodifte. a été obligé de
s’aftreindre à la quantité du morceau original.
Quel eft l’audâ ' * cïeüx
Qui dans ces fôm brës lieux
Ofe porter ses pas,
Et 'devant le trépas
Ne frémit pas. . . . . . . . .
Par quels puiflans accords
Dans le féjoür ’ dés morts ,
Malgré nos? valus efforts
11 calme la . \ ‘fureur
De nos tranfpofts ; &c.
Remarquez ici i° . que< !a gêne impolêe parla
Situation, par la néceflité de traduire , a laiflé peu
de choix au parodifte , & qu’il faut lui paffer, à la
faveur de ces entraves, quelques fautes de quantité ,
comme fes pas, des morts, où il a été oblige de
faire brefs, ces monofyllabes qui font effentielle-
ment longs. 2.0. qnhl ne-faut pas s’arrêter à ce que
la dernière fyllabe, marquée brève partout, peut être
quelquefois longue, comme le font en effet toutes
celles que nous venons de citer. On fait que la dernière
fyllabe d un vers eft toujours ad libitum, parce
que chaque vers devant être séparé du fuivantpar un
court filence, c’eft dans ce filenceque fe perd la durée
de la dernière fyllabe. Cette règle eft reçue en mu-
fique comme en poéfie; elle exiftoit pour les Grecs
& les Latins, comme elle -exifte pour nous , parce
quelle eft donnée par la nature. 30. que ce qui
conftitue le da&yle dans ce: exemple , c’eft la manière,
dont les paroles font ajuftéés fur la mufique':
c’eft que l'antépénultième porte ' fur ‘ le temps
frappé, & que1 2 lé$ deux dernières achèvent le temps
fort, ou vont fé perdre fur le temps foible ; aulieu
cu’on pourroit mettre ces mêmes paroles en mufique
, en foifont porter la dernière fylb.be fur le
frappé. Ce n’eft donc pas le poèteTeül, mais le
muficien qui,en françoisypeutfaireufogeduda&yle.
Le poète ne peut qnb î indiquer èrc finiffant fes
vers par une antépénultième longue & une. pénultième
brève, la dernière étant àdlibïtum. Le muficien
alors adopte ce rhythme s’il veut, s’il le croit
favorable à l’expreflion. Le compofiteur italien au
contraire y eft forcé par la nature du vers jdrucciolo.
( M. Framery. j)
DAN
DACTYLIQUE. ad). Nom qu’on donnoit, dans
l'ancienne m Tique, à cette efpèce de rhythme dont
la mefurefe panageoit en deux temps égaux ,
( Voyez Rhythme. )
On appelloit aufli daStylique une forte de nome
où ce rhythme étoit fréquemment, employé , tel
que le nome Harmathias & le nome Orthien.
Julius Pollux révoque en doute fi le daSlylique
étoit une forte d’inflrument, ou une forme de
chant ; doute qui fe confirme par ce qu’en dit
Ariftide Quintilien dans fon fécond livre, & qu’on
ne peut réfondre qu'en fuppofant que le mot dac-
tylique fignifioit à la fois un inftrument & un air,
comme parmi nous les mots mufette & tambourin.
• ■ (' J. J. RouJJeau. )
DAIRÉ ou D e f , inftrument perfan , affés fem-
blable à.pos tambours de-bafque, dont les Perfans
fe fervent pour battre la mefure avec les mains.
Ils la battent aufli fur deux petites tymbales de
cuivre, longues d’un pied, avec des bâtons de
buis nommés nagaraî. La mefure, chez eux,
s’appelle eycaa , combiriàifon.
( M. Framery. )
DANOIS ( mufique & chanfons des ) Le chant
eft - fi naturel à l’homme, qu’il chante même fur
les glaces du Dannemark, de la Norvège & de l’If-
lande. Ce n’eft pas feulement depuis que les arts
de l’Europe, refluant vers le pôle, y ont porté, le
goût d’imitation, que les gofiers Danois ont effayé
des inflexions italiennes , 8c que J on chante ,
Comme nous l’apprenons de M. Coxe ( 1 ) , dans
les concerts de la cour de Copenhague Xe. jlabat
mater de Pèrgolese traduit en danois. Dès les fiècles
les plus reculés, les Scaldes, qui étoient pour le Dannemark
ce que -les Bardes furent pour l’Irlande,
y avoient fait entendre des chants, unis à une poé-
fie groflière, mais mefurée, rimée, & pleine de
-hardieffes, de figures, de mouvemens.
Comme les Bardes, ils jouiffoient d’une grande
confidération , ils chantoient leurs chanfons dans les
cours, à la louange des héros3 ils les accompag-
noient du fon de divers inffrumens 8c principalement
delà harpe. Aufli, dit M. de la Borde (a) de
qui j’emprunte une partie des matériaux de cet article,
aufli étoient-ils appelles harpax, c’eft-à-dire joueurs
de harpe. Ce qui prouve, pour le dire en paffant,
que l’ancienne langue danoise ayant été celle de tout
le Nord, y compris l’Angleterre, le mot harp eft
danois d’origine , ' & que nous tenons des, poètes
feandinaves 8c l’idée , 8t' là forme primitive , ■ '& le
(1) Voyage au Nord de 1-Europe, tome IV*
(2) Effai fur la mufique, tome II. M. de la Borde,
tiroir lui même ces détails d’un recueil rédigé par M.
Jacobi, fecrétaire de la fociété royale cîe Copenhague.
DAN
nom même de cet inftrument qui nous charme
tant aujourd’hui.
La plupart de ces chanfons, dont plufieurs ont
été confervées, & font encore chantées par les
payfans iflandois , font hiftoriques, & renferment
quelque trait mémorable de ces anciens temps. Par
exemple, il y en a une où eft célébrée l’éreélion de
lafameufe muraille danoise , connue fous .le nom de
opus Danorum. Le poète y introduit la reine Tyre ,
furnommée Danebod, ou reftauratrice des Danois,
regrettant que la Nature qui a comblé-de fes biens
le Dannemarek, l’ait laiffé fans défenfe du côté du
Jutland. Elle donné enfuite des ordres pour bâtir
la muraille. Ses peuples accourent des différentes
parties du royaume ; le rempart s’élève ; & la reine
qui a commencé par nommer le Dannemarek pays
agréable de champs & de prairies , le compare, en finif-
fant, à un champ fertile bien enfermé de toutes
parts.
D ’autres font des chants guerriers. On y témoigne
un grand mépris de la mort, & beaucoup d’empref-
fement à fe rendre chez le Dieu Odin, pour y boire
de la cervoife, ou bierre du pays. Telle eft celle
qu’on attribue au roi Regner appellé Lodbrog, c’eft-à-
dire aux chauffes velues. « Nous les avons coupées,
dit ce poète roi, (& ce font les têtes des ennemis. )
3, nous les avons coupées avec nos épées; mais ce
» qui caufe ma joie, c’eft que je fais qu’Odin me tient
» un fiége tout prêt pour fon feftin. Bientôt j’y boi-
» rai de la cervoise dans des cornes recourbées, &
s) ce n’eft point en tremblant que je me préfente à
m fon palais, v
La traduéfion complette que M. Mallet a donnée
de cette chanfon dans fes monümens de la mythologie 6»
de la poéfie des Celtes offre quelques différences dans
la manière dont cette ftrophe eft rendue, & fur-
tout dans le premier vers qui revient à chaque couplet.
Aulieu de nous les avons coupées avec nos épées, M.
Mallet traduit Amplement : nous nous fommes battus
.avec nos épées. Je laiffe aux favans dans la langue
danoise à décider laquelle de ces deux ver fions rend
mieux ces vers.
Hiuggo vermet hiorvi
Hitt lægit m'g Jafnan.
Le genre & le fujet extraordinaire de cette chanfon
, me font croire qu’on fera bien aile de la trouver
ici toute entière.
Regner Lodbrog, roi,, poète & guerrier, règneit en
Dannemarek vers le commencement du neuvième
fiècle. Pris en combattant, en Angleterre, par Ella
fon ennemi, roi d’une partie de file , il périt parles
morfures. des ferperis dont on a voit rempli fopribn.
Il laiffa plufieurs fils qui vengèrent cette mort horrible,
a.infii qu’il l’a voit annoncé dans ces vers qu’il
compofa pendant fa captivité.
D A N 397
» Nous nous fommes battus à coups d’épée, dans
le temps où jeune encore, j’allai ve-s l’Orient préparer,
une proie fanglante aux loups dévorans. Toute
la mer ne fembloit qu’une feule plaie, & les corbeaux
nageoient dans le fan g des biefiéi.
» Nous nous fommes battus à coups d’épée, le
jour de ce grand combat où j envoi ai les peuple«
de Helfingie dans le palais d’Odin. De là nos vaif-
feaux nous porterènt à Ifa 9 où les fers de nos lames,
fumans defong, entamoient à grands coups les cut-
rafles, & où les épées mettoknt les boucliers en
pièces.
» Nous nous fommes battus à coups d’épée; ce
jour où j’ai vu dix mille de nos ennemis couché»
fur la poulhère, près d’un cap d’Angleterre. Une
rofée de fang dégouttoit de nos g’aives, les flèches
mugiffoient dans les airs e.i allant chercher les cafques ;
c’étoit pour moi un plaifir aufli grand que de tenir
une belle fille dans mes bras.
n Nous nous fommes battus à coups d’épée, le jour
où mon bras fit toucher à fon dernier crépufcule ce
jeune homme fi fier de fa belle chevelure, qui re-
cherchoit les jeunes filles dès le matin , & qui fe
plaifoit tant à entretenir les veuves. Quelle eft la def-
tinée d’un homme vaillant, fi ce n’eft de tomber
des premiers au milieu d’une grêle de traits? Celui
qui n’eft jamais bleffé, paffeune vie ennuyeufe;&
le lâche ne fait jamais ufage de fon coeur.
» Nous nous fommes battus à coups d’épée. Il
faut qu’un je. ne homme fe montre de bonne heure
dans les combats, qu’un homme en attaque un autre
, ou lui refiîle : ça été là toujours la nobieffe
d’un héros ; & celui qui afpire à le faire aimer de
fa maîtreffe, doit ê.-re prompt & hardi dans le
fracas des épées.
» Nous nous fommes battus à coups d’epée ;
mais j’éprouve aujourd’hui que les hommes font entraînés
par le deftin. Il en eft peu qui puiffent réfifter
aux décrets des fées. Aurois-je. cru que la fin de
ma vie feroit réfervée à Ella , lorsqu’à -d mi mort
je répandois encore . es torrens de iang, îorfque je
préc;pitoi5 les vaiffeaux dans les golfes de i’LcoiTe,
& que je fourniffois uae proie abondante aux bêtes
fauvagesi
n Nous nous fommes battus à coups d’épée ;
mais je fuis plein de joie , en aaprenant qu’un feftin
fe prépare pour moi -dais le pa-ais ■ d’Odin.
Bientôt'affis dans faEr-î ante d.meure, nousboirons
'de la bierre dans les crânes- de nés ennemis. Un
homme brave n t r e ouïe point la mort. Je nepre-
! noncerar point, des paroles d’effroi en entrant dans
la folle d’Odin.
v Nous nous fommes battus à" cou ’-s. d'épée.
Ah 1 fi mes fils fovoient les tourmens que j’endure ,