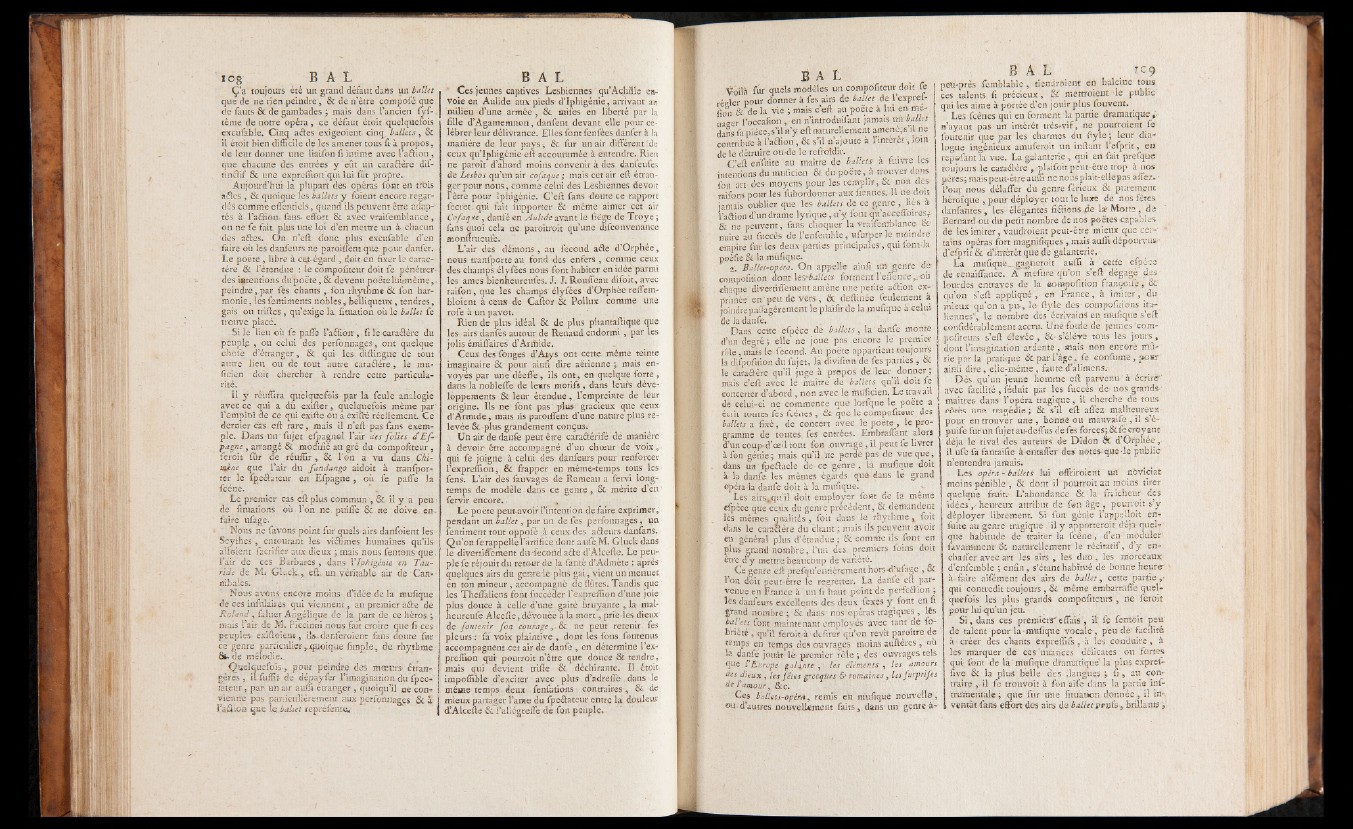
iog B A L
Ç ’a toujours été un grand défaut dans un Vallet
que de ne rien peindre, 8c de n’êtrè çompofé que
de fauts & de gambades ; mais dans l’ancien f y f - .
tême de notre opéra, ce défaut étoit quelquefois
excufable. Cinq aéles exigeoient- cinq, ballets, &
il étoit bien difficile de les amener tous fi à propos,
de leur donner une lialfon fi intime avec l ’aélion,
que chacune des entrées y eût un caraélère dif-
tinélif & une expreffion'.qui lui fût propre..
Aujourd’hui la plupart des opéras font en trois
aéles , 8c quoique les ballets y foient eacore.regar-
dés comme effentiels, quand ils peuvent être adap- j
tés à- l’aéliom fans* effort & avec vraifemblance,
on ne fe fait, plus une loi d’en mettre un à- chacun
des aéles. On n’eft. donc plus excufable d’en
faire où les danfe urs. ne paroifiênt que pour danfer.
Le poète, libre à cet-égard doit en fixer le caractère
& l’étendue : le compofiteur doit fe pénétrer-
des intentions du poète, & devenu po ëte lui-même,-
peindre,,par fës chants ,,fon rhythme & fon harmonie
, les fentiments nobles, belliqueux, tendres,
gais ou trilles , qu’exige la. fituation où le ballet fe
trouve placé.
Si le lieu où fe pafTe l’aétiôm, fi lè caraélère du
peuplé , ou celui des perfonnages, ont quelque
ohcfè d’étranger, 8c qui les- diftingue de tout
autre lien ou de tout autre caraélère, le mu-
ficien doit chercher à rendre cette particularité.
Il y réuffira quelquefois par là feule analogie
avec ce qui a dû exifler, quelquefois même par
l’emploi de ce qui exifte ouaexifté réellement. Ce
dernier càs efl rare, mais il n’eft pas fans exemple.
Dans un fujet efpagnol l’air des folies £Ef~
■ pagne , arrangé & modifié au gré du compofiteur ,
feroit fûr de réuffir , 8c l ’on a vu dans Chi-
uifine que l’air du fandango aidoit à tranfpor-.
ter le fpeélateur en, Efpagne , où fe paffe la
fcène.. . ' *
Le premier cas efl plus commun-, &, il y a peu
de fttuations où l’on, ne. puifle & ne doive, enta
ire ufage.
Nous ne fàvons point fur quels airs danfoient les-
Scythes, entourant les viélimés humaines qu’ils )
aîloiënt facrifier aux dieux ; mais nous fentons que.
l ’air de ces Barbares , dans VIphigénie en Tau-
ride de Mi Glucki, efl, un,véritable air de Cannibales.
Nous avons encore moins d’idée de là mufique
de ces infnlaires qui viennent., au premier aéle de
Roland, falüer Angélique de la part de ce héros ;
mais l’air, de M. Piccinni nous fait croire que fi ces
peuples exifteient, ils-danferoient fans doute fur
ce genre ^ particulier ,, .quoique firople, de rhythme
8fc de mélodie,, >
Quelquefois-, pour peindre, des moeurs éttair-
gères , ilfuffiè de dépayfer l’imagination du fpec-
îat.eur , p'ah un air aufii étranger , quoiqu’il ne con^ I
vienne pas paniciiîièrement aux perfonnages 8c a
l ’aéUon que 1Q..bahct repréfente, j
B A L
•* Ces jeunes captives Lesbiennes qu’Achille envoie
en Aulide aux pieds d’Iphigénie, arrivant an
milieu d’une armée, 8c miles en liberté par la
fille d’Agamemnon, danfent devant elle pour célébrer
leur délivrance. Elles font fenfées danfer à la
manière de leur pays ^ & fur un air différent Lde
ceux qu’Iphigénieeft accoutumée à entendre. Rien
ne paroît d’abord moins convenir à des danfeufes
de Lesbos qu’un air çofaque ; mais cet air eft étranger
pour nous, commè celui des Lesbiennes devoit
l’être pour Iphigénie. C ’efl fans doute ce rapport
fecret: qui fait fupporter 8c même aimer cet air
Cofaq te , danfé en Aulide avant le fiège de Troye ;
fans quoi cela ne. paroîtroit qu’une «inconvenance
aïonftrueufe.
L ’air des démons , au fécond aéle d’Orphée,
nous tranfporte au fond des enfers , connue ceux
des champs élyfées nous font habiter en idécsparmi
les âmes bienheureufes. J. J. Rouffeau difoit, avec
raifon, que les champs élyfées d’Orphée reffem-
bloient à ceux-de Caftbr ik Pollux comme une
rofe à;un pavot.-
Rien de plus idéal 8c de plus phantaftique que
lesv airs danfés autour de Renaud endormi, par les
jolis émiffaires d’Anhlde.
Ceux des fonges d’A tys ont cette, même teinte
imaginaire & pour ainfi dire aérienne ; mais envoyés
par une déeffe, ils ont, en quelque forte,
dans la nobleffe de leurs motifs , dans leurs développements
8t leur étendue, l’empreinte de leur
origine. Us ne font pas' plus-'gracieux que ceux
d’Armide, mais ils paroiffent d’une nature plus relevée
8c plus grandement conçus*
Un air de dànfe peut être caraétérifé dé mànière
à devoir'être accompagné d’un choeur de voix ,
qui fe joigne à celui des danfeurs pour renforcer
l’expreffion, & frapper en même-temps tous les
fens. L’air des fauvages de Rameau a fervi longtemps
de modèle dans ce genre, 8c mérite d’en ;
fervir encore.- ,
Le poète peutavoir l’intention défaire exprimer,
pendant un ballet, par un de fes perfonnages -, un
fentimenttout oppofé -à ceux des aéleurs danfans.
Q u ’on fe rappelle l’artifice dont a ufé M. Gluck dans
le diverfifiement du fecond aéle d’Alcefte. Le peuple
fe réjouit du retour de la fanté d’Admète : après
quelques airs du genre-lé plus gai, vient un menuet
en ton mineur, accompagné de flûtes. Tandis que
les Theffaliens font fuccéder l’expreffion d’une joie
plus douce à celle d’une gaité bruyante , la mal-
heureufé Alcefte, dévouée à la mort. , prîë les dieux
de foutenir- fon courage,8 c ne peut retenir fes
pleurs-:- fa voix plaintive , dont les fons foutenus
accompagnent-cet air de dànfe, en détermine l’ex-
preffion- qui pourroit n’être que douce & tendre,
mais qui devient trifte & déchirante. II.étoit
impoffible d’exciter avec plus d’adrefie dans le
même temps deux1 fenfations contraires , & de
mieux partager l’ame du fpeélateur entre la. douiez
d-’Alcefte 5c l’ailcgrefte dé fon peuple,.
B A L
Voilà fur quels modèles un compofiteur doit ic
régler pour donner à fes airs de ballet de 1 expref-
fîon & de la vie ; mais oeft au poète à lui en ménager
l’occafion j.-en n’introduifant jamais \m ballct
dans fa pièce, s’il n’y eft naturellement amené^s’ilne
contribùe à l’aélion, & s’il n’ajoute à l’ intérêtloin
de le détruire ou-de le refroidir. ^
C ’eft enfùite au maître de ballets- à fuivre les
intentions du inufieien & du-poete, à trouver dans
fon art des moyens pour les remplir, & non des1
raifon3 pour les fubordonner aux fiennes.. Il ne doit
jamais oublier que ÏQs ballcts de ee genre, liés à
l’a&ion d’un drame lyrique, n’y font qu’acceffoiresf
& ne peuvent, fans choquer la vraifenffilance- &■
nuire au fuccès de l’enfemble, ufurper le moindre"
empire fur les deux parties principales-, qui-font-la
poèfie & la mufique.
à. Ballet-opéra. On appelle ainfi un genre dp
compofition dont les'balletx formentTeficnce ,; où
chaque divertifiement amène une petite aétion ex- '
priinéè en'peu de vèrs , & deftinée feulement à-
joindre paûàgèrement le plaifir de la mufique a celui
de la danfe.
Dans cette efpèce de ballets , 1a danfe monte
d’un degré; elle ne joue pas encore le premier
rôle, mais le fécond. Au poète appartient toujours
la difpofition du fujet, la divifion de fes parties , &
le caraélère, qu’il juge à propos de leur donner ;
mais c?eft avec le maître de ballets qu’il doit fe
concerter d’abord , non avec le muficien. Le travail
dé celui-ci ne commence que lorfque le poète a
écrit toutes fes fcènes , & que le compofiteur des
ballets a fixé, de concert avec le poète, le programmé
dé toutes fes entrées. Embraflant alors
d’un coup-d’oeil tout fon .ouvrage, il peut fe livrer
à fon génie ; mais qu’il fie perde pas de vue que ,
dans un fpeélacle de ce genre , là mufique doit
à- la danfe les mêmes égards quê dans le grand
opéra-la danfe doit à la mufique.
Les airs^qu il doit employer font de la même
efpèce qiie ceux du genre précédent, & demandent
lès mêmes qualités , foit dans le rhythme, foit
dans le caraSère du chant ; mais ils.peuvent avoir
en général plus d’étendue ; & comme ils font en
plus grand nombre, l’un des . premiers foins doit
être d’y mettre, beaucoup de variété.
. Ce gente eft prefqu’entiérement hors-d’ufage , &
f'on doit peut-être le regretter. La danfe eft parvenue
en France à un fi haut point de perfeéhon ;
lés danfeurs excellents des deux féxés y font en fi
grand nombre-; & dans' nos opéras tragiques, lês
bal’ets font maintenant employés avec tant dé fo-
brièté , qu’il feroit à ■ defirer qu’on revît paroître de
temps en temps des ouvrages moins aufteres, ou
la danfe jouât lé premier rôle ; des ouvrages tels
qué lEurope galante1, : les éléments , les amours
des dieux , les fêtes grecques & romaines, les furprifes
de Iamour, &ci
Ces ballets-opéra, remis en mufique nouvelle,
B A L r e £
pétt-près femfilable, tiendroient en haleine tous
ces talents fi précieux, & mettroient le public
qui les aime à portée d’en jouir plus fouvent. ^
Les fcènes qui en forment la partie dramatique y
n’ayant pas un intérêt trèsrvif, ne pourroien£ fe
foutenir que par les charmes du ftyle ; leur dialogue
ingénieux amuferpit un inftant l’efprit, en
repofant la vue. La galanterie., qui en fait prefque
toujours le caraélère , plaifoit peut-être trop à nos
pères; maispeut-ètré-auffi ne nous plaît-ellepas afiez» ’
Four nous délafler du genre férieux & purement
héroïque , pour déployer tout le luxe de nos fêtes
danfantes; les-élégantes fiélions fie-là Motte , de '
Bernard ou du petit nombre de nos poètes capables
de les imiter, vaudroient peut-être mieux que cer- *
tains opéras fort magnifiques , mais aufii dépourvus
d’efprir & d’fiTférêtqüe de galanterie, *
La mufiquè^. eag:fîeroit auffi à cette efpèce
de renaifiance. À mefui'e qu’on s’eft dégagé des •
lourdes entraves de la sompofition francoife, 6c-
qu’on s’eft appliqué, en France, a imiter, -du
mieux'qu’on a ptv-, le-ftyle des- cômpofidons italiennes
", le nombre dés écrivains en mufique s’eft
confidérablement accru. Une foule de jeunes~com-
pofiteurs s’eft élevée , 8c- s’élève tous les joure,
dont l’imaginafion ardente, mais non encore mûrie
par la pratique 8c par l ’â g e , fe confirme, posr
ainfi dire , elle-même , faute d’âlimensv
Dès qu’un jeune homme eft parvenu 'à écrire'
avec facilité , féduit par les fuccès de'* nos grands ■
maîtres dans l’opéra tragique, il cherche de tous
côtés une tragédie ; 8c s’il eft aftez malheureux;
pour en trouver une, bonne ou màuvaife , il s é-
puife fur un fujet au-deftus de fes forces; 8c fe croyant
déjà le rival dès auteurs' de DMon 8c dOrphée,
il ufe fa fantaifie à entaffer des notes* que-le public
n’entendra jamais*
Les opéra - ballets lui oftriroient un' nôviciat
moins pénible , 8c dont il'pourroit au moins tirer
quelque fr-ùit.' L’abondance 8c la fn îchetir des
idée* heureux attribut de fën â g e , pourroit s’y
déployer librement. Si’ fon génie l’appelloit en-
friite au genre tragique , il y apporteroir déjà qùelr'
que habitude de traiter la fcène, d’en moduler'
favamment-8c naturellemenfle récitatif, d’y en-
cliaiîèr avec art les airs , les dut» , les morceaux
d?ènfemble ; enfin , s’étant habitué de bonne heure*
à faire aifément des airs de ballet , cette partie
qui contredit toujours , 8c même embarrafie quelquefois
les plus grands compofiteurs , ne leroit
pour lui qu’un jeu.
S i, dans ces premiers*1 efiais , il fe fentô m m
de talent pour la - màfique vocale , peu de facilité
à créer des citants expreffifs, à les conduire, à
lés marquer de ces'nuances délicates ou fortes
qui font de là 'nïufiqtie dramatique' la plus exprel-
five 8c la plus belle des ilangués ;. u , au contraire
,ril fe trouvoit à fon aife dans la partie inf-
trumentale ; que fur une fituation donnée, il in-
, ventât fans effort des airs de ballet pfufs , brillants >