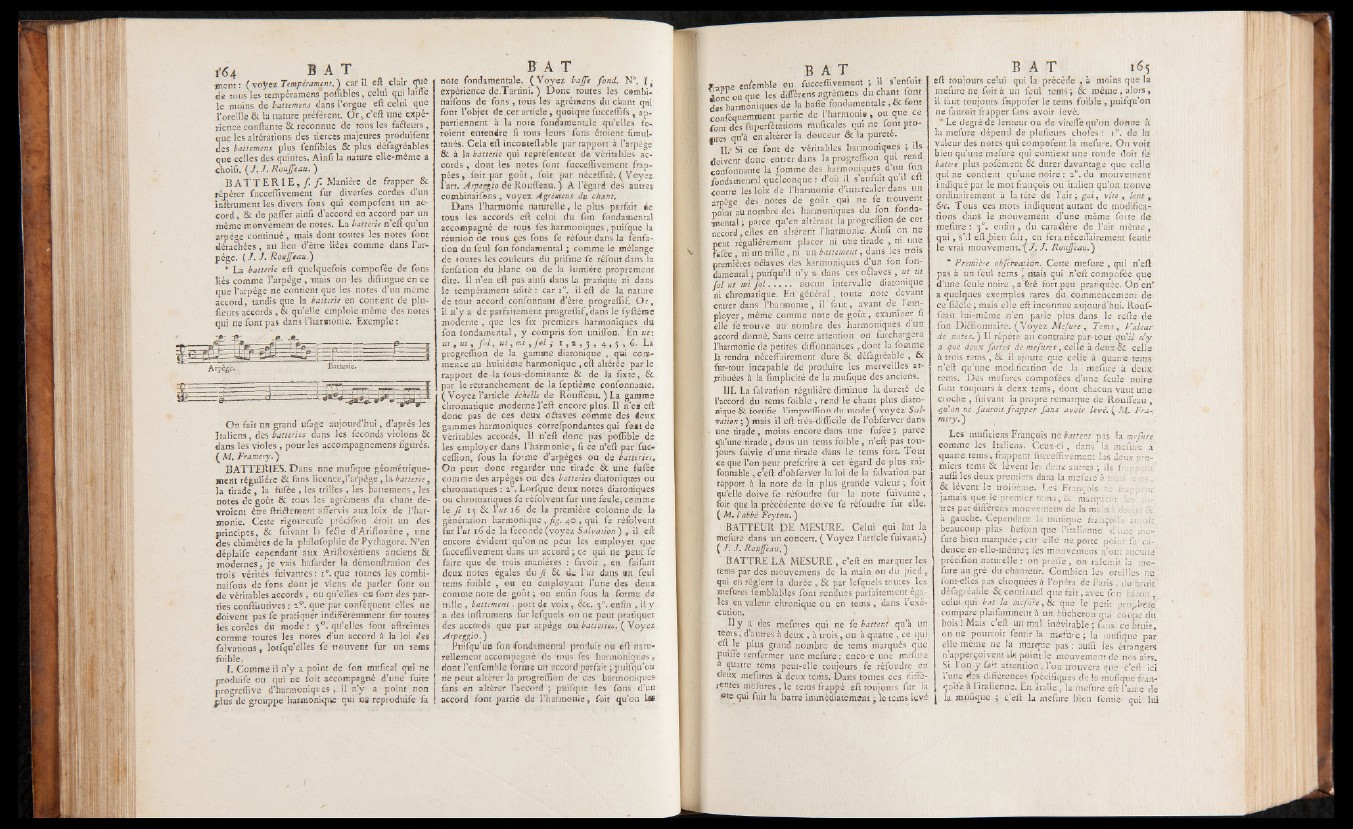
1 6 a B A T
jnent : (voyez Tempérament.} caf ïl eft^clair <Jüô
de tous les tempérament pombles , celui qui laiffe
le moins de battemens dans l’orgue eft celui que
l’oreille & la nature préfèrent. Or > c’eft une expérience
confiante & reconnue de tous les fa'éteurs,
que les altérations des tierces majeures produifent
des battemens plus fenfibles & plus défagréables
que celles des quintes. Ainfi la nature elle-même a
clioifi. ( / . J. Rouffeau. )
B A T T E R I E , f. f . Manière de frapper &
répéter fucceflivement fur diverfes cordes d’un
înftrument les divers fons qui compofent un accord
, & de paffer ainfi d’accord en accord par un
même mouvement de notes. La batterie n’eft qu’un
arpège continué, mais dont toutes les notes font
détachées, au lieuNd’être liées comme dans l’arpège.
(/ . /. Rouffeau.)
* La batterie eft quelquefois compofée de fons
liés comme l’arpège , mais on les diftingue en ce
que l’arpège ne contient que les notes d’un même
accord, tandis que la batterie en contient de plu-
fieurs accords , & qu’elle emploie même des notes
qui ne font pas dans l’haraionie. Exemple :
Arpège.
On fait un grand ufage aujourd’h ui, d’après les
Italiens, des batteries dans les féconds violons &
dans les violes , pour les accompagnemens figurés.
£ M. Framery.}
BATTERIES. Dans une mufique géométriquement
régulière & fans licence,l’afpège , la batterie,
la tirade , la fufée , les trilles , les battemens, les
notes de goût & tous les agrémens du chant de-
vroient être ftriéiement affervis aux loîx de l’harmonie.
Cette rigoureufe précifion étoit un des
principes, & fuivant la fëéfe d’Àriftoxène, une
des chimères de la philofophie de Pythagore. N’en
déplaife cependant aux Ariftoxértiens anciens 8c
modernes, je vais hafarder la démonftration des
trois vérités firivanfés : i°. que toutes les combi-
naifons de fons dont je viens de parler font ou
de véritables accords , ou qu’elles en font des parties
conftuutives : a°. que par conféquent elles ne
doivent pas fe pratiquer indifféremment fur toutes
les cordes du mode : 3 qu’elles font a freintes
comme toutes les notes d’un accord à la loi des
falvations, lorfqu’elles fe nouvent fur un tems
foible.
I. Comme il n’y a point de fon mufical qui ne
produife ou qui ne foit accompagné d’une fuite
progrefîive d’harmoniques , il n’y a point non
plus de grouppe harmonique qui as reproduife fa
note fondamentale. ( Vo yez baffe fond. N°. ï ^
expérience de.Tartini. ) Donc toutes les combi-
naifons de fons , tous les agrémens du chant qui
font l’objet de cet article, quoique fucceffifs , appartiennent
à la note fondamentale qu’elles te-,
roient entendre fi tous leurs fons étoient fimul-
tanés. Cela eft inconteftable par rapport à l’arpège
& à la batterie qui repréfentent de véritables accords
, dont les notes font fucceflivement frappées
, foit par goû t, foit par néceffité. ( Voyez
l ’art. Arpeggio de Rouffeau. ) A l’égard des autres
cooibinaifons , voyez Agrémens du chant.
Dans l’harmonie naturelle, le plus parfait de
tous les accords efl celui du fon fondamental
accompagné de tous fes harmoniques , puifque la
réunion de tous çes fons fe réfout dans la fenfa-
tioa du feul fon fondamental ; comme le mélange
de toutes les couleurs du prifme fc réfout dans la
fenfation du blanc ou de la lumière proprement
dite. Il n’en efl: pas ainfi dans la pratique ni dans
le tempérament ufité :• car i°. il efl de la nature
de tout accord conformant d’être progreffif. O r ,
il n’y a de parfaitement progreffif, dans le fyflême
moderne , que les fix premiers harmoniques du
fon fondamental, ÿ compris fon uni fl on. En ut:
ut ^ ut 9 fu i , ut, mi 9 fo l ; 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , é. La
progreflion de la gamme diatonique , qui commence
au huitième harmonique , efl altérée par le
rapport de la f ous-dominante & de la fix te, 8c
par le retranchement de la feptième confonnaute.
( V oyez l’article échelle de Rouffeau, ) La gamme
chromatique moderne l’eft encore plus. Il n’ea efl
donc pas de ces deux oélaves comme des leux
gammes harmoniques correfpondantes qui fo it de
véritables accords. Il n’efi doue pas poflible de
les employer dans Fhârmonie', fi ce n’eft par fuc-
ceflion, fous la forme d’arpèges ou de batteries,
On peut donc regarder une tirade & une fufée
comme des arpèges ou des batteries diatoniques ou’
chromatiques : zu. Lorfque deux notes diatoniques
ou chromatiques fe réfolvent fur une feule, comme
lé f i 15 8c l'ut 16 de la première colonne de 1&
génération harmonique , fig. 40 , qui fe réfolvent
lur fut 16 de la fécondé (voyez Salyation) , il efl
encore évident'qu’on ne peut les employer que
fucceflivement dans un accord ; ce qui ne peut fe
faire que de trois manières : favoir,, en faifant
deux notes égales du y? & de l'ut dans un feul
tems foible , ou en employant l’une des deux
comme note de goût ; on enfin fous la forme de
trille , battement. port de v o ix , &c. 30. enfin „ il y
a des inftrumeus lur lefquels on ne peut pratiquer
des accords que par arpège ou batteries. ( Voyez
Arpeggio.)
Puifqu’un fon fondamental produir ou efl naturellement
accompagné de tous fes harmoniques,
dont l’enfemble forme un accord parfait ; puifqu’on
ne peut altérer la progreflion de ces harmoniques
fans en altérer l’accord ; puifque les fons d’un
accord font partie dé l'harmonie, foit qu’on b»
B A T
frappe ensemble ou fucceflivement ; il s’enfuit
ionc ou que les différens agremens du chant font
d.s harmoniques de la baffe fondamentale , & font
conféquemment partie de l’harmonie, ou que ce
font dés fuperfétations muficales qui ne font propres
qu’à en altérer la douceur & la purete.
II. * Si ce font de véritables harmoniques ; ils
doivent donc entrer dans la progreflion qui rend
confonnante la fonime des harmoniques d’un fon
fondamental quelconque ï d’où il s’enfuit qu’il eft
Contre les loix de l’harmonie d’intercaler dans un
arpège des notes de goût qui ne fe trouvent
point aü nombre des harmoniques du fon fondamental
; parce qu’en altérant la progreflion de cet
accord,elles en altèrent l’harmonie. Ainfi on ne
peut régulièrement placer ni une tirade , ni une
; fufée, ni un trille , ni u n battement, dans les trois
premières oâaves des harmoniques d’un fon fondamental
* puifqu’il n’y a- dans ces oâaves , ut ut
fol ut mi J'ol. . . . . aucun intervalle diatonique
ni chromatique. En général , toute note devant
entrer dans l’harmonie, il faut, avant de 1 employer,
même comme note de goût, examiner fi
elle fe trouve au- nombre des harmoniques d'un
s accord donné. Sans cette attention on furchargera
l’harmonie de petites diflonnances , dont la fournie
la rendra néceffairement dure 8c défagréable , &
| fur-tout incapable de produire les merveilles attribuées
à la fimplicité dé la mufique des anciens.
III. La falvation régulière diminue la dureté de
l’accord du tems foible , rend le chant plus diatonique
& fortifie l’impreflîon du mode ( voyez Sal-
| ration ; ) mais il efl très-difficile de l’obferver dans
| ■ une tirade, moins encore dans une fufée; parce
| qu’une tirade, dans un tems foible , n’eft pas tou-
| jpurs fuivie d’une tirade dans le tems fort. Tout
! ce que l’on peur preferire à cet égard de plus râi-
[ fonnable , c’eft d’obferver la loi de la falvation par
I rapport à la note de la plus grande valeur ; foit
I qu’elle doive fe réfoudre-fur la note fuivante , S foit que la précédente doive fe réfoudre fur elle.
! ( M. l'abbé Feytou. )
BATTEUR DE MESURE. Celui qui bat la
mefure dans un concert. ( Voyez l’article fuivant.)
ï! ( J. J. Rouffeau. )
BATTRE LA MESURE , c’eft en marquer les
i tems par des mouvemens de la main ou du pied,
qui en règlent la durée , & par lefquels toutes les
mefures femblables font rendues parfaitement égalés
en valeur chronique ou en tems, dans l’exé-
> cution.
Il y a des mefures qui ne fe battent' qu’à un
tems. d’autres à deux , à trois, ou à quatre , ce qui
éft le plus grand nombre de tems marqués que
puifle renfermer une mefure : encore une mefure
a quatre tems peut-elle toujours fe réfoudre eii
deux mefures à deux tems. Dans toutes ces différentes
inèfures , le tems frappé eft toujours fur la
«te qui fuit la barre immédiatement • lé tems levé
B A T 165
eft toujours celui qui la précède , à moins que la
mefure ne foit à un feul tems; & même, alors,
il faut toujours fuppofer le tems foible , puifqu’on
ne fauroit frapper fans avoir levé.
* Le degré de lenteur ou de vîteffe qu’on donne à
la mefure dépend de plufieurs choies : i°. de la
valeur des notes qui compofent la mefure. On voit
bien qu’une me Cure qui contient une ronde doit fe
battre plus pofément & durer davantage que celle
qui ne contient qu’une noire : z°. du mouvement
indiqué par le mot françois ou italien qu’on trouve
ordinairement à la tête de l’air ; gai, vite , lent,
&c. Tous ces mots indiquent autant de modifications
dans le mouvement d’une même forte de
mefure : 30. enfin , cîu caraâère de l’air même,
qui , s’ il eft.bien fait, en feranéceffairement fentir
le vrai mouvement* ( J ; /. Rouffeau.)
* Première. obfùvrulon. Cette mefure , qui n’eft:
pas à un feul tems \ niais' qui n’eft compofée que
dune feule noire , a'été fort peu pratiquée. On en*”
a quelques exemples rares du. commencement de
ce fiècle ; mais elle eft inconnue aujourd’hui. Rouffeau
lui-même n’en parle plus dans le refte de
fon Diâionnaire. (V oy e z Mefure , Tems, Falcur
de notes.) Il répète au Contraire par-tout qu'il n'y
a que deux fortes de mefures, celle à deux ce celle
à trois tems, & il ajoute que celle à quatre tems
n’eft qu’une modification de la mefure à deux
tems. Des mefures compofées d’une foule noire
font toujours à deux tems, dont chacun vaut une
croche , fuivant la propre remarque de Rouffeau ,
qu'on ne fauroit frapper fans avoir levé. ( AL F va-
merÿ.)
Les muficiens François ne battent pas la mefure
| comme les Italiens i Ceux-ci , dans la mefure à
quatre tems » frappent fucceflivement les deux premiers
tems & lèvent les deux autres ; ils fratr
aulfi les deux premiers dans la mefure à trois
& lèvent lé troifième. Les François ne frao
jamais que le premier tems, 8c marquent les a
Très par différens mouvemens de la main à droite &
à gauche. Cependant la mufique françoife auroit
beaucoup plus befoin que l’italienne d’tine Tnc-
fure bien marquée ; car elle apporte point-fa cadence
en elle-même; fes mouvemens ifonr aucune’
précifion naturelle : on preffe, on ralentit la mefure
au gré du chanteur. Combien les oreilles ne
lont-elles pas choquées à l’opéra de Paris , du bruit
défagréable 8c continuel que fait, avec fon bâton ,
celui qui bat la mefure., 8c que le petit prophète
compare plaifammenr à un bûcheron qui coupe du
bois ! Mais c’eft un mal inévitable ; fans- ce bruit,
on ne pourroit fentir la mefure ; la mufique par
elle-même ne la marque pas : aüfli les étrangers
n’apperçoivent ils point le mouvement de nos airs.
Si 1 on y fait. attention, l’on trouvera que c’eft ici
l’une.<k-s différences fpécifiqjies de la mufique fran-
çoifeà l’italienne. En Italie,fta mefure eft lame de
J la mufique ; c’eft la mefure bien fentië qui lui