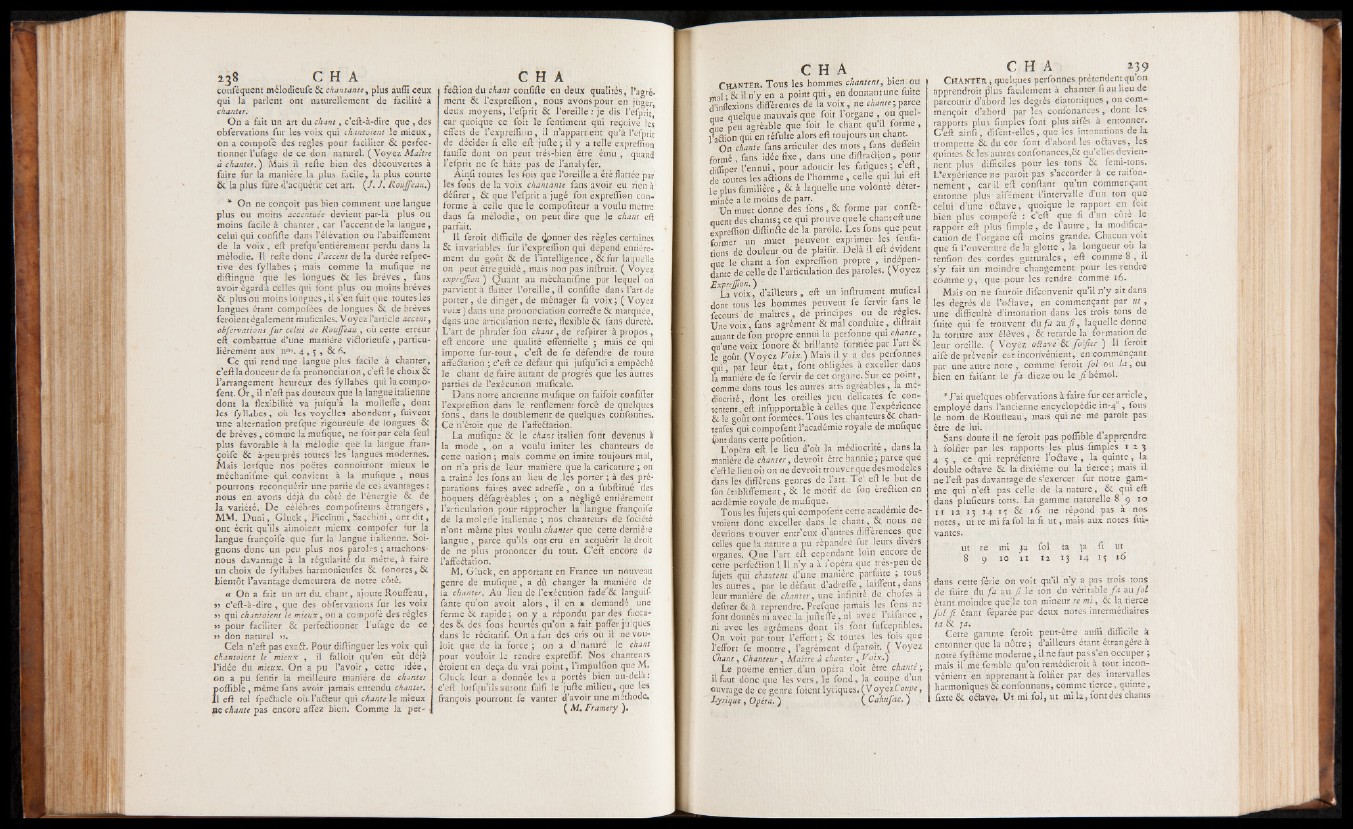
î38 C H A
conféquent mélodieufc & chantante, plus auflî ceux
qui la parlent ont naturellement de facilité à
chanter.
On a fait un art du chant, c’eft-à-dire que , des
obfervations fur les voix qui chantoient le mieux,
on a compofé des réglés pour faciliter & perfectionner
l’ufage de ce don naturel. (V o y e z Maître
à chanter.') Mais .il refte bien des découvertes à
faire fur la manière la plus facile, la plus courte
& la plus fûre d’acquérir cet art. (7. 7. Roujfeau.)
* On ne conçoit pas bien comment une langue
plus ou moins accentuée devient par-là plus ou
moins facile à chanter, car l’accent de la langue,
celui qui confifte dans l’élévation ou l’abaiffement
de la voix , eft prefqu’entièrement perdu dans la
mélodie. Il refie donc Caccent de la durée refpactive
des fyllabes ; mais comme la mufique ne
diftingue que les longues & les brèves , fans
avoir égardà celles qui font plus ou moins brèves
& plus ou moins longues, il s’en fuit que toutes les
langues étant compofées de longues & de brèves
feroient également muficales. Voyez l’article accent,
obfervations fur celui de Roujfeau , où cette erreur
eft combattue d’une manière yiélorieufeparticulièrement
aux nos. 4 , 5 , & 6.
Ce qui rend une langue plus facile à chanter ,
c’eft la douceur de fa prononciation, c’eft le choix &
l ’arrangement heureux des fyllabes qui la composent.
O r , il n’eft pas douteux que la langue italienne
dont la flexibilité va jufqu’à la mollefle, dont
les fyllabes, où les voyelles abondent, Suivent
une alternation prefque rigoureufe de longues &
de brèves, comme la mufique, ne foit par cela feul
plus favorable à la mélodie que la langue fran- j
çoife & à-peu près toutes les langues modernes.
Mais lorfque nos poètes connoîtront mieux le
méchanifme- qui. convient à la mufique , nous
pourrons reconquérir une partie de ces avantages :
nous en avons déjà du côté de l’énergie & de
la variété. De célèbres compofiteurs étrangers ,
MM. Du n i, Gluck , Picciiïni, Sacchini, ont d it,
ont écrit qu’ils aimoient mieux compofer fur la
langue françoife que fur la langue italienne. Soignons
donc un peu plus nos paroles ; attachons-
nous davantage à la régularité du mètre, à faire
un choix de fyllabes harmonieufes & fenores, &
bientôt l’avantage demeurera de notre côté.
« On a fait un art du. chant, ajoute Rouffeau,
jj c’eft-à-dire, que des obfervations fur les voix
jj qui chantoient le mieux, on a compofé des règles
jj pour faciliter & perfectionner l’ufage de ce
jj don naturel jj.
Cela n’eft pas exaét. Pour diftinguer les voix qui
chantoient le mieux , il falloit qu’on eût déjà
l ’idée du mieux. On a pu l’avoir , cette idée,
on a pu fentir la meilleure manière de chanter
poflible, même fans avoir jamais entendu chanter.
Il eft tel fpeélacle où-Fadeur qui chante Je mieux I
s e chante pas encore allez bien. Comme la per- J
G H A
fe&ion du chant confifte en deux qualités, l’agrément
& l ’expreflion, nous avons pour en jiiger,
deux moyens, Fefprit & l’oreille : je dis Fefprit
car quoique ce foit le fentiment qui reçoive les
effets de i’expreffion, il n’appartient qu’à l’efprit
de décider fi elle eft jufte ; il y a telle expreflion
fauffe dont on peut très-bien être ému , quand
l’efprit ne fe hâte pas de Fanalyfer.
Ainfi toutes les fois que l’oreille a été flattée par
les fons de la voix chantante fans avoir eu rien à
défirer, & que Fefprit a jugé fon expreflion conforme
à celle que le compofiteur a voulu mettre
dans fa mélodie, on peut dire que le chant eft
parfait.
Il feroit difficile de (Jpnner des règles certaines
& invariables fur Fexpreffion qui dépend entièrement
du goût & de l’in telligence& fur laquelle
on peut être guidé , mais non pas inftruit. ( Voyez
exprejjion ) Quant au méchanifme par lequel on
parvient à flatter l’oreille, il conflfte dans l’art de
porter, de diriger, de ménager fa voix; (V oyez
voix ) dans une prononciation correéle & marquée,
dans une articulation ne» te, flexible-& fans dureté.
L ’art de phrafer fon chant, de refpirer à propos,
eft encore une qualité efîentielle ; mais ce qui
importe fur-tout, c’eft de fe défendre de toute
affeClation ; c’eft ce défaut qui jufqu’ici a empêché
le chant de faire autant de progrès que les autres
parties de l’exécution muficale.
Dans notre ancienne mufique on faifoit confifter
F expreflion dans le. renflement forcé de quelques
fons , dans le doublement de quelques confonnes.
Ce n’étoit que de FaffeCtation.
La mufique & le chant italien font devenus à
la mode , on a voulu imiter les chanteurs de
cette nation; mais comme on imite toujours mal,
on n’a pris de leur maniéré que la caricature ; on
a traîné les fons au lieu de les porter ; à des préparations
faites avec adreffe , on a fubftitué des
hoquets défagréables ; on a négligé entièrement
l ’articulation pour rapprocher la langue françoife
de la mole fie italienne ; nos chanteurs de fociété
n’ont même plus voulu chanter que cette dernière
langue, parce qu’ils ont cru en acquérir le. droit
de ne plus prononcer du tout. C ’eft encore de
l’affeélation.
M. Gluck, en apportant en France un nouveau
genre de mufique, a dû changer la manière de
la chanter. Au lieu de l’exécution fade & languif-
fante qu’on avoit alors , il en a demandé une
ferme & rapide ; on y a répondu par des facca-
des & des fons heurtés qu’on a fait pafler juiques
dans le récitatif. On a fait des cris où il ne vou-
loit que de la force; on a d'naturé le chant
pour vouloir le rendre expreffif. Nos chanteurs
étoient en deçà du vrai point., l’impulfion que M.
Gluck leur a donnée lésa portés bien au-delà:
c’eft lorfqu’ilsauront faifi le jufte milieu, que les
françois pourront fe vanter d’avoir une méthode,
( M. Framery ),
C H A
C hanter. Tous les hommes chantent, bien;ou
1R 8 il n’y en a point qui, en donnant une fuite
d’inflexions différentes de la v o ix , ne chante-, parce
mie quelque mauvais que foit l’organe , ou quelque
peu agréable que foit le chant qu’il forme,
Faâion qui en réfulte alors eft toujours un chant.
On chante fans articuler des mots , fans deflein
formé, fans idée fixe, dans une diftraélion , pour
diffiper Fennui, pour adoucir les fatigues; c’eft,
de toutes les aélions de l’homme , celle qui lui elt
le plus familière , & à laquelle une volonté déterminée
a le moins de part. . ■ , ,
Un inuet donne des fons, & forme par conle-
quent des chants; ce qui prouve que le chant eft une
expreflion diftinéle de la parole. Les fons que peut
former un muet peuvent exprimer les fenfa-
tions de douleur ou de plaifir. Delà il eft évident
que le chant a fon expreflion propre , indépendante
de celle de l’articulation des paroles. (Voyez
Êxprejffion.)
La voix, d’ailleurs , eft un infiniment mulical
dont tous les hommes peuvent fe fervir fans, le
fecours de maîtres, de principes ou de règles.
Une voix , fans agrément & mal conduite, diftrait
autant de fon propre ennui la perfonne qui chante,
qu’une voix fonore & brillante formée par Fart &
le goût (Voyez Voix.) Mais il y a des perfonnes
qui ■ par leur état, font obligées à exceller dans
la manière de fe fervir de cet organe. Sur ce point,
comme dans tous les autres arts agréables, la médiocrité,
dont les oreilles peu délicates fe contentent,
eft infupportable à celles que l’expérience
& le goût ont formées. Tous les chanteurs & chan-
teufes qui compofent l’académie royale de mufique
font dans cette pofition.
L’opéra eft le lieu d’où la médiocrité, dans la
manière de chanter, devroit être bannie ; parce que
ç’eft le lieu où on ne devroit trouver que des modèles
dans les différens genres de l’art. Tel eft le but de
fon établiflemènt, & le motif de fon éreaion en
académie royale de mufique. ;
Tous les lu jets qui compofent cette académie de-
vroient donc exceller dans le c h a n t& nous ne
devrions trouver entr’eux d’autres différences que
celles que la nature a pu répandre fur leurs divers
organes. Que l’art eft cependant loin encore de
cette perfeélion 1. Il n’y a à l’opéra que tres-peu de
fujets qui chantent d’une maniéré parfaite ; tous
les autres, par le défaut d’adrefle , laiflent, dans
leur manière de chanter, une infinité de chofes a
defirer & à reprendre. Prefque jamais les^ fons ne
font donnés ni avec la juftefle , ni avec l’aifance ,
ni avec les agrémens dont ils font fufceptibles.
On voit par-tout l’effort; & toutes les fois que
l’effort fe montre, l’agrément d.fpareit. ( Voyez
Chant, Chanteur , Maître à chanter , Voix.)
Le poème entier, d’un opéra doit être chante ;
il faut donc que les vers, le fond, la coupe d un
ouvrage de ce genre foient lyriques, (V oy e zCoupe,
Lyrique , Opéra. ) ( Cahtifac, )
C H A 239
C hànter , quelques perfonnes prétendentqu’on
apprendroit plus facilement à chanter fi au lieu de
parcourir d?abord les degrés diatoniques -, on com-
mençoit d’abord par les confonances, dont les
rapports plus Amples font plus aifés à entonner.
C e ft ainfi , chient-elles, que les intonations d elà
trompette & du cor font d’abord les oélaves, les.
quintes & les autres confonances,& qu’elles deviennent
plus difficiles pour les^ tons 8c femi-tons.
L’expérience ne paroît pas s’accorder a ce raifon-
nement, car il eft confiant qu un commençant
entonne plus a Hé ment Fintervalle dun ton que
celui d’une oélave, quoique le rapport en foit
bien plus compofé : c’eft que fi d’un côte le
rapport eft plus fimple, de l'autre, la modifica-
cation de l’organe eft moins grande. Chacun voit
que fi l’ouverture de la glotte , la longueur où la
tenfion des cordes gutturales, eft comme 8 , il
s’y fait un moindre changement pour les rendre
comme 9 , que pour les rendre comme 16.
Mais on ne fauroit difconvenir qu’il n’y ait dans
les degrés de l’oélave, en commençant par u t ,
une difficulté d’intonation dans les trois tons de
fuite qui fe trouvent du fa au f i , laquelle donne
la torture aux élèves , & retarde la formation de
leur oreille. ( Voyez oélave'& folfier ) Il feroit
aifé dè prévenir cet inconvénient, en commençant
par une autre note , comme feroit fo l ou la , ou
bien en faifant le fa dieze ou le f i bémol.
* J’ai quelques obfervations à faire fur cet article,
; em p lo y é dans l ’an c ien n e e n c y c lo p é d ie in -4 0 , fo u s
le n om d e R o u f f e a u , mais q u i n e m e pa ro ît p a s
ê tre de lu i.
Sans doute il ne feroit pas poflible d’apprendre
à folfier par les rapports les plus fimples 1 2 3
4 <j , ce qui repréfente l’oélave, la quinte, la
double oélave 8c la dixième ou la tierce; mais il
ne F eft pas davantage de s’exercer fur notre gamme
qui n’eft pas celle de la nature, & qui eft
dans plufieurs tons. La gamme naturelle 8 9 10
11 12 13 14 i f & »6 ne répond pas à nos
; notes, ut re mi fa fol la fi u t , mais aux notes buvantes.
ut re mi ia fol ta ja fi ut
8 9 10 11 12 13 14 M l &
dans cette férié on voit qu’il n’y a pas trois tons
de fuite du fa au f i le ton du véritable fa au fo l
étant moindre que;le ton mineur re mi, & la tierce
fo l f i étant féparée par deux notes intermédiaires
ta & ja. ^ ~
Cette gamme feroit peut-être auflî difficile à
entonner que la nôtre ; d’ailleurs étant étrangère à
notre fyftême moderne, il ne faut pas s’en occuper ;
mais il me {omble qu’on remédieroit à tout inconvénient
en apprenant à folfier par des intervalles
harmoniques & confonnans, comme tierce, quinte,
fixte 8c oélave. Ut mi fol, ut mi la, font des chants