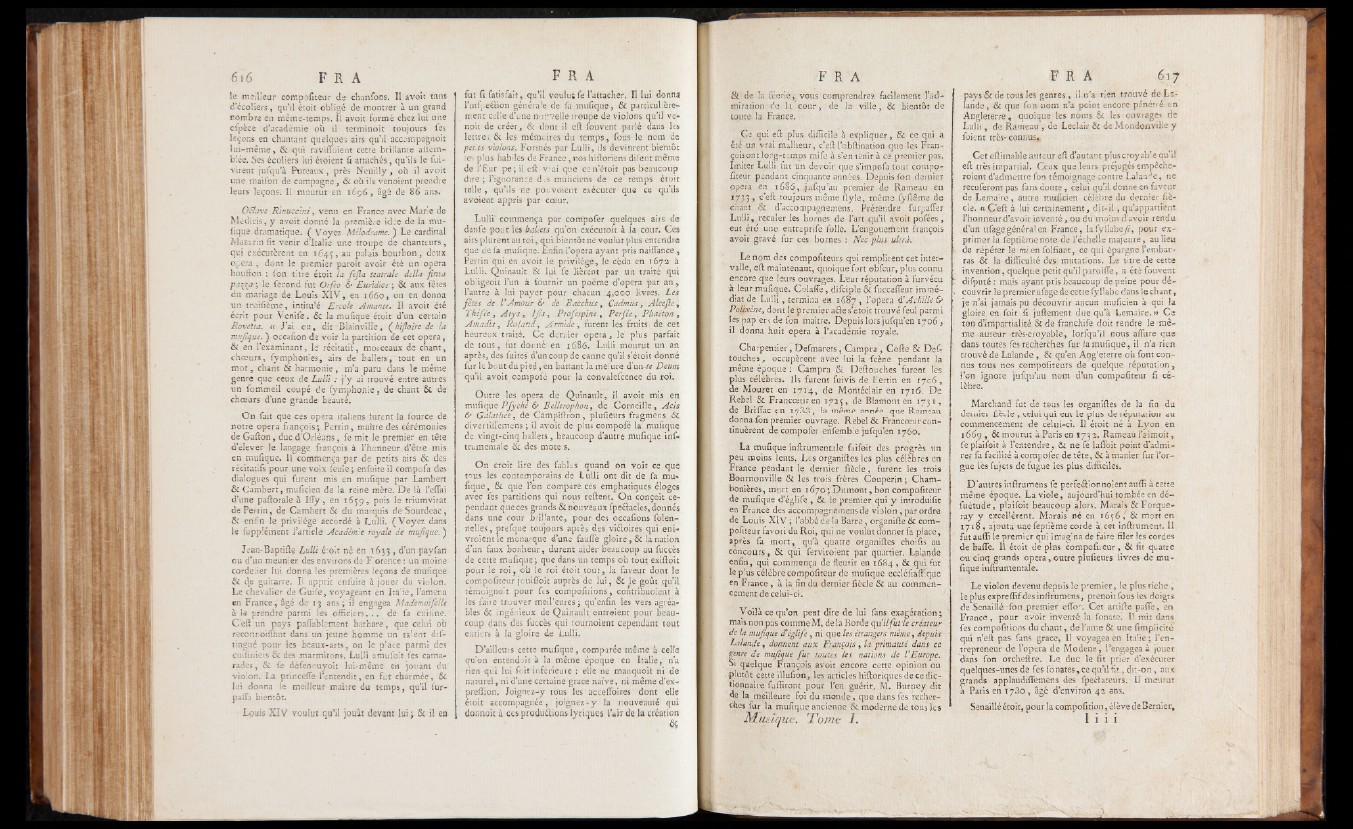
le meilleur compofiteur de chanfons. Il avoit tant
d’écoliers, qu’il étoit obligé de montrer à un grand
nombre en même-temps. Il avoit formé chez lui une
efpèce d’académie oii il terminoit toujours fes
leçons en chantant quelques airs qu’il accompagnoit
lui-même, & qui raviffoient cette brillante aiiem-
b!ée. Ses écoliers lui étoient fi attachés, qu’ils le fui-
virent jufqu’à Puteaux, près Neuilly, oh il avoit
une maifon de campagne, & ou ils venoient prendre
leurs leçons. Il mourut en 1696, âgé de 86 ans.
Oêlave Rinucclni, venu en France avec Marie de
Méd icis, y avoit donné la première idée de la mufique
dramatique. ( Voyez Mélodrame. ) Le cardinal
Mazarin fit venir d’Italie une troupe de chanteurs,
qui exécutèrent en 1645 > au Palais bourbon, deux
opéra , dont le premier paroît avoir été un opéra
bouffon : fon titre étoit la fejla teatrale délia finta
patfa-'y le fécond fut Orfeo & Euridics ; & aux fêtes
du mariage de Louis X IV , en 1660, on en^donna
un troifième, intitulé Ercole Amante. Il avoit été
écrit pour Venife. & la muüque étoit d’un certain
Rovelta. « J’ai eu, dit 'Blainville, ( hifioire de la
mujique. ) occafion de voit la partition de cet opéra ,
& en l’examinant, le récitatif, morceaux de chant,
choeurs, fymphonies, airs de ballets, tout en un
m o t, chant & harmonie, m’a paru dans le même
genre que ceux de Lulli : j’y ai trouvé entre autres
un fommeil coupé de fymphonie, de chant & de
choeurs d une grande beauté.
On fait que ces opéra italiens furent la fource de
notre opéra françois; Perrin, maître des cérémonies
de Gafton, duc d’Orléans, fe mit le premier en tête
d’élever le langage françois à l’honneur d’être mis
en mufique. 11 commença par de petits airs & des
récitatifs pour une voix feule ; enfuite il compofa des
dialogues qui furent mis en mufique par Lambert
& Cambert, mufieien de la reine mère. De là l’effai
d’une paftorale à I ffy , en 1659, puis le triumvirat
de Perrin, de Cambert & du marquis de Sourdeac,
& enfin le privilège accordé à Lulli. (V oy e z dans
le fuppîément l’article Académie royale de mufique. )
Jean-Baptifte Lulli étoit né en 1633 , d’un payfan
ou d’un meunier des environs de Florence : un moine
cordelier lui donna les premières leçons de mufique
& de guitarre. Il apprit enfuite à jouer du violon.
Le chevalier de Guife, voyageant en Ita’ie, l’amena
en France, âgé de 13 ans ; il engagea Mademoifelle
à 1« prendre parmi les officiers... de fa cuifine.
C'eft un pays paffablemenf barbare, que celui oh
reconnoiflànt dans un jeune homme un talent distingué
pour les beaux-arts, on le place parmi des
çuifiniers & des -marmitons. Lulli amufoit fes camar
rades, & fe défennuyeit lui-même en jouant du
violon. La princeffe l’entendit, en fut charmée, &
lui donna le meilleur maître du temps, qu’il fur-
paffa bientôt.
Louis XIV voulut qu’il jouât devant lui ; & il en
fut fi fatisfait, qu’il voulut fe l’attacher. Il lui donna
l’infpeéfion générale de fa mufique, & particulière^
ment celle d’une nouvelle troupe de violons qu’il ve»
noit de créer, & dont il eft fouvent parlé dans les
lettrei & les mémoires du temps, fous le nom de
petits violons. Formés par Lulli, ils devinrent bientôt
les plus habiles de France, nos hiftoriens difent même
de l’Eur pe; il eft vrai que cen’étoit pas beaucoup
dire; l’ignorance d;s muiieiens de ce temps étoit
telle, qu’ils ne penvoient exécuter que ce qu’ils
avoient appris par coeur.
Lulli' commença par compofer quelques airs de
danle pour les ballets qu’on exécutoit à la cour. Ces
airs plurent au roi, qui bientôt ne voulut plus entendre
que de fa mufique. Enfin i’opera ayant pris naiffance ,
Perrin qui en avoit le privilège, le céda en 1672 à
Lulli. Quinault & lui fe lièrent par un traité qui
ob'.igeoit l’un à fournir un poëme d’opera par an ,
l’autre à lui payer pour chacun ,4,000 livr-es. Les
fêtes de V Amour & de Bacchus, Cadrnus , Alcefle t
T hé fé e , A tys, Ifis, Prof erp ine, Per fée y Phaéton,
Arnadis, Roland y Armïde,. furent les fruits de cet
heureux traité. Ce dernier opéra, le plus parfait
de tous, fut donné en 1686. Lulli mourut un an
après, des fuites d’un coup de canne qu’il s’étoit donné
fur le bout du pied, en battant la mesure d’uiw« Deum
qu’il avoit compofé pour la convalefcence du roi.
Outre les opéra de Quinault, il avpit mis en
mufique Pfyché & Bellerophon, de Corneille, Acis
& Galathèe, de Campiftron, plufieurs fragmens ce
divertiffemens ; il avoit de plus compofé la mufique
de vingt-cinq ballets, beaucoup d’autre mufique inf-
t ruinent ale &. des mote s.
On croit lire des fables quand on voit ce que
tous les contemporains de Lulli ont dit de fa mu*
fi que, & que l’on compare ces emphatiques éloges
avec fes partitions qui nous reftent. On conçoit cependant
que ces grands & nouveaux fpeâacles, donnés
dans une cour brillante, pour des occafions folen-
nelles, prefque toujours après des viéloires qui eni-
vroient le monarque d’une faufile gloire, ÔC la nation
d’un faux bonheur, durent aider beaucoup au fucçès
de cette mufique; que dans un temps oh tout exiftôit
pour le roi, oh le roi étoit tout, la faveur dont le
compofiteur jouiffoit auprès de lui, & le goût qu’il
témoignoit pour fes compofitions, contribuoient à
les faire trouver meil'eures; qu’enfin les vers agréables
& ingénieux de Quinault entroient pour beaucoup
dans des fuccès qui tournoient cependant tout
entiers à la gloire de Lulli,
D ’ailleurs cette mufique, comparée même à celle
qu’on entendoit à la même époque en Italie, na
rien qui lui fc.it inférieure : elle ne manquoit ni de
naturel, ni d’une certaine grâce naïve, ni même d’ex-
preffion. Joignez-y tous les acceffoires dont elle
étoit accompagnée, joignez-y la nouveauté qui
donnoit à ces produirions lyriques l’air de la création
& de la féerie, vous comprendrez facilement l’admiration'
de la cour, de la v ille, & bientôt de
toute; la France.
Ce qui eft plus difficile à expliquer, & ce qui a
été un vrai malheur, c’eft l’cbftination que les François
ont long-temps mife à s’en tenir à ce premier pas.
Imiter Lulli fut un devoir que s’impofa tout compofiteur
pendant cinquante années. Depuis fon -dernier
opéra en 1686,,jufqu’au premier de Rameau en
173,3 , c’eft toujours même ftyle, même fyftême de
chant & d’accompagnemens. Prétendre furpaffer
Lulli, reculer les bornes de l’art qu’il avoit pofées,
eut été une entreprife folle. L’engouement français
avoit gravé fur ces bornes : Nec plus ultra.
Le nom des compofiteurs qui remplirent cet intervalle,
eft maintenant, quoique fort ebfcur, plus connu
encore que leurs ouvrages. Leur réputation à furvécu
à leur mufique. C-olaffe, difciple & fucceffeur immédiat
de Lulli, termina en 1687 , l’opéra d'Achille 6*
Polixène, dont le premier aéles’étoit trouvé feui parmi
les pap ers de fon maître. Depuis lors jufqu’en 1706 ,
il donna huit opéra à l’académie royale.
Charpentier, Defmârets', Campra , Cofte & Def-
touches, occupèrent avec lui la fcène pendant la
même époque : Campra &. Deftouches furent les
plus célèbres. Ils furent fuivis de Eertin en 1706,
de Mouret en 17 14 , de Montéclair en 1716'. De
Rebel & Francoeuren 1725, de Blamont en 1731,
de Briffac en 1733, la même année que Rameau
donnafon premier ouvrage. Rebel & Francoeur continuèrent
de compofer enfemble jufqü’en 1760.
La mufique inftrumentale faifoit des progrès lin
peu moins lents. Les organiftes les plus célèbres en
France pendant le dernier fiècle, furent les trois
Bournonville & les trois frères Couperin ; Cham-
bonières, mort en 1670; Dumont, bon compofiteur
de mufique d’églife , & le premier qui y introduifit
en France des âccompagnemensde violon , par ordre
de Louis XIV ; l’abbé de la Barre, organifte & compofiteur
favori du Roi, qui ne voulut donner fa place,
après fa mort, qu’à quatre organiftes choifis au
concours, & qui ferviroient par quartier. Lalande
enfin, qui commença de fleurir en 1684, & qui fut
le plus célébré compofiteur de mufique eccléfiaffique
en France , à la fin du dernier fiècle & au commencement
de celui-ci.
Voilà ce qu’on peut dire de lui fans exagération ;
mais non pas comme M. dé la Borde qu ilfutie créateur
de la mufique d’églife, ni que les étrangers même, depuis
Lalande, donnent aux François ; la primauté dans ce
genre de mufique fur toutes les nations de VEurope.
Si quelque François, avoit encore cette opinion ou
plutôt cette illufion, les articles hiftoriques de ce dictionnaire
fuffiront pour l’en guérir, M. Burney dit
de la meilleure foi du monde, que dans fes recherches
fur la mufique ancienne & moderne de tous les
Musique. Tome 1 .
pays & de tous les genres, il n a rien trouvé de Lalande,
& que fon nom n’a point encore pénétré en
Angleterre, quoique les noms & les ouvrages de
Lulli r de Rameau , de Leclair & de Mon don ville y
foient très-connus*
Cet eftimable auteur eft d’autant plus croyable qu i!
eft très imparrial. Ceux que leurs préjugés empêche-
roient d’admettre fon témoignage contre Lalande, ne
reeuferont pas fans doute , celui qu’il donne en faveur
de Lemaire, autre mufieien célèbre du dernier fiècle.
« C ’eft à lui certainement, dit-il, qu’appartient
l’honneur d’avoir inventé, ou du moins d’avoir rendu
d’un ufage généra! en France, Iafyllabeyf, pour exprimer
la feptièmenote de l’échelle majeure, au lieu
de répéter le mien folfiant, ce qui épargne l’embarras
& la difficulté des mutations. Le titre de cette
invention, quelque petit qu’il paroiffe, a été fouvent
difputé : mais ayant pris beaucoup de peine pour découvrir
le premier ufage de cette fyliabe dans léchant,
je n’ai jamais pu découvrir aucun mufieien à qui la
gloire en foit fi juflement due qu’à Lemaire. » Ce
ton d’impartialité & de franchife doit rendre le même
auteur très-croyable, lorfqu’il nous aflure que
dans toutes fes recherches fur 1 a mufique, il n’a rien
trouvé de Lalande , & qu’en Ang'eterre oh font connus
tous nos compofiteurs de quelque réputation,
l’on ignore jufqu’au nom d’un compofiteur fi célèbre.
Marchand fut de tous les organiftes de la fin du
dernier fiècle , celui qui eut le plus de réputation au
commencement de celui-ci. Il étoit né à Lyon en
1669 , & mourut à Paris en 173 2. Rameau l’ai m oit,
fe plaifoit à l’entendre, & ne fe laffoit point d’admirer
fa facilité à compofer de tête, & à manier fur l’orgue
lès fujets de fugue les plus difficiles.
D ’autres inftrumens fe perfeélionnoîent auffi à cette
même époque. La viole, aujourd’hui tombée en dé-
fuétude, plaifoit beaucoup alors. Marais & Forque-
ray y excellèrent. Marais né en 1656 , & mort en
1718 , ajouta une feptième corde à cet inftrument. Il
fut auffi le premier qui imagina de faire filer les cordes
de baffe. Il étoit de plus compofiteur, & fit quatre
ou cinq grands opéra, outre plufieurs livres de mufique
inftrumentale.
Le violon devenu depuis le p-emier, le plus riche,
le plus expreffif des inftrumens, prenoit fous les doigts
de Senaillé fon premier effo-. Cet artifte paffe, en
France, pour avoir inventé la fonate. Il mit dans
fes compofitions du chant, de l’ame & une fimpiieité
qui n’eft pas fans grâce, Il voyagea en Italie ; l’entrepreneur
de l’opéra de Modene, l ’engagea à jouer
dans fon orcheftre. Le duc le fit prier d’exécuter
quelques-unes de fes lonates, ce qu’il flLr d>t-on , aux
grands applaudiffemens des fpeélateurs. Il mourut
à Paris en Ï730 , âgé d’environ 42 ans.
Senaillé étoit, pour la compofition, élève deBernier,
I i i i