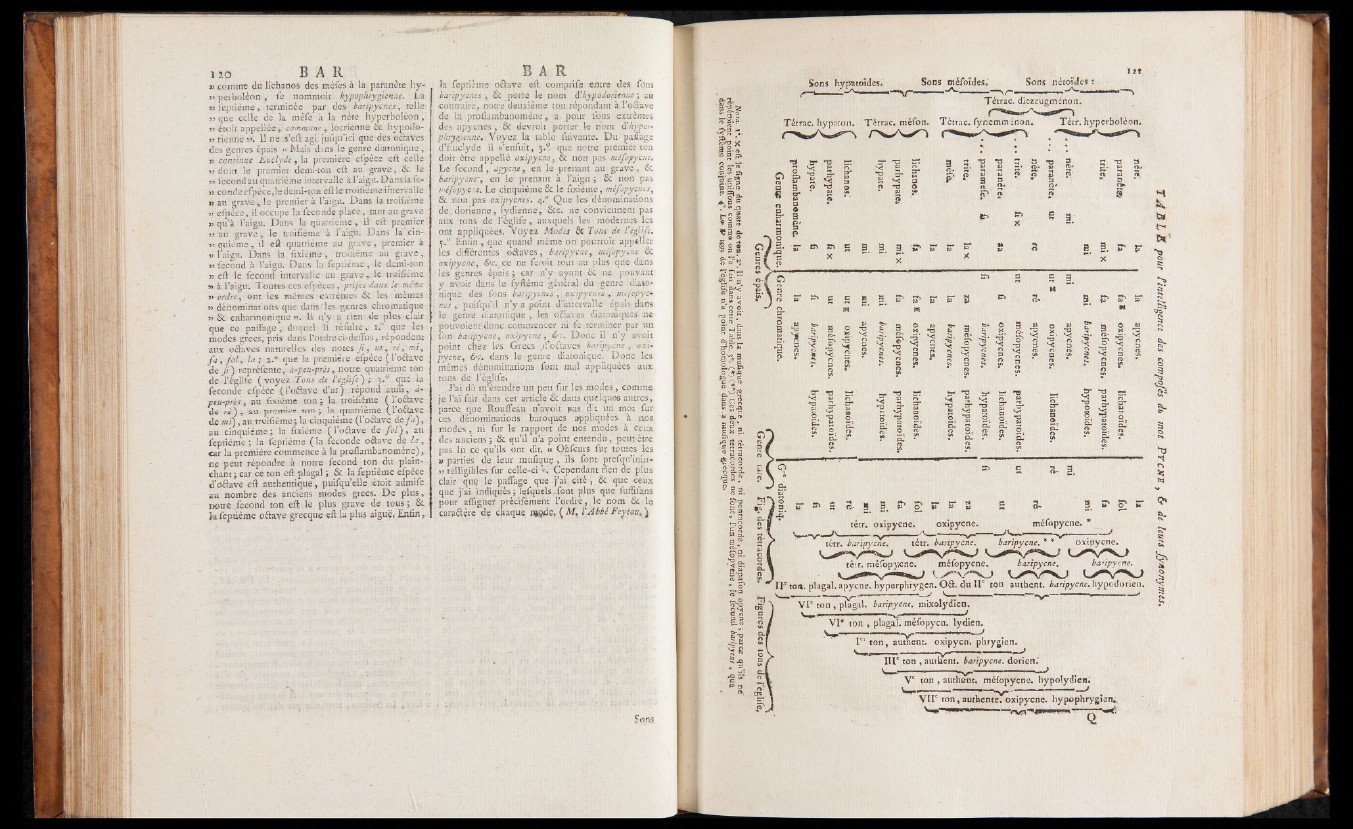
1 2 0 D /I I I
» comme du li'chanos des mèfes à la paranète hy-
33 perboléon , fe nommoit hypophrygienne. La
sa i'eptième, terminée par des baripycnes, telle
33 que celle dé la rnèfe à la nète hyperboléon,
sa étoit. appellée, commune, locrienne 8c hypodé-
33 riennè ïj. 11 ne 's’eft agi' jiifqu ici que des oclaves
des genres épais « Mais 'dans le genre diatonique,
» continue Euclyde, la première efpèce efi celle
33 dont le premier demi-ton efi au grave, & le
33 fecOnd au quatrième intervalle à l ’aigu. Dans la fe-
» conde efpèce,le demi-ton eft le troifième intervalle
« au grave, le premier à l’aigu. Dans la troifième
33 efpèce, il occupe la fécondé place, tant au grave
» qu’à l’aigu. Dans la quatrième , il efi premier
33 au grave, le troifième à l’aigu. Dans la cin-
>3 quièrne, il efi quatrième au gra vep rem ie r à
s; l’aigu. Dans la fixième, troifième au grave,,
>3 fécond à l’aigu. Dans la feptième, le demi-ton
3> efi le fécond intervalle au grave, le troifième
3* à Faigu, Toutes ces efpèces, prijès dans le mcrtîe
ordre., ©nt les mêmes extrêmes & les mêmes •
3> dénominations que dans les. genres chromatique
ï> & enharmonique v. Il n’y a rien de plus clair
que ce paffage, duquel il ré fuite,. i.° que les
modes grecs, pris dans l’ordre ci-deflus, répondent
aux oélaves naturelles des notes y?, nt, réa mi,
f a , fo l, la ; a.® que la première efpèce ( l ’oâave
de fi') repréfente, à-peu-près, notre quatrième ton
de l’églife (v o y e z Tons de Téglife) ; 3.0 que la
fécondé efpèce ( l ’oâave d’ut) .répond auffi, à-
peu-prës, au fixième ton ; la troifième ( l ’oâave
de ré) , au premier ton ; la quatrième ( l ’oélave
de mi), au troifième; la cinquième (l’oâave de fa ) ,
au cinquième; la fixième ( l ’odave de f o l ) , au
feptième; la feptième ( la fécondé oâave dq la ,
car la première commence à la proflambanomène),
îig peut répondre à notre fécond ton du plain-
chant; car ce ton efi plagal ; & la feptième efpèce
d’oâave efi authentique, puifqu’elle étoit admife
au nombre des anciens modes grecs. De plus,
îïôtre .fécond ton efi le plus grave de tous ; &
h feptième o&aye grecque efi la plus aiguë, Enfin,
la feptième oâave efi comprife entre des fions
baripycnes , 8c porte le nom à'hypodorienoe ; au
contraire, notre deuxième tp.11 répondant à j ’o&ave
de la proflambanomène, a pour Ions extrêmes
des apyenés, & devroit porter le nom d’hyper-«
phrygienne. Voyez la table fui vante. Du paffage
d’Euçlyde il -s’enfuit, 3,? mie notre premier ton
doit être appellé oxipyene, oc non pas méfopyene.
Le fécond, apyene, en le prenant au grave, 6c
baripyene’, en le prenant à l’aigu ; 8c non pas
méfopyene. Le cinquième 8c le fixième, méfopycnesi
8c non pas oxipyenes. 4.0 Que les dénominations
de dorienne, lydienne, 8cc. ne conviennent pas
aux tons de l’églife, auxquels les modernes les
ont appliquées, voyez Modes 8e Tons de l’églife.
5,0 Enfin , que quand même on pourroit appeller
les différentes .oâaves, baripyene, méfopyene 8c
oxipyene-, &c. ,ce ne feroit tout au plus que dans
les genres épais ; car n’y ayant 8c ne pouvant
y avoir dans le fyfiême : général du genre diatonique
des fons baripycnes , . oxipyenes , mèfqpy'c-
nés , pui(qu’il n’y a point d’intervalle épais dans
le genre diatonique , les oélaves diatoniques ne
pouvoient donc commencer ni fe terminer par un
ion baripyene, oxipyene , &c. Donc il n’y avoit
point chez les Grecs / i’odaves baripyene „ @xi-
pyene, &c. dans le genre diatonique. Donc les
mêmes dénominations font mal appliquées aux
tons de l ’églife.
J’ai dû m’étendre un peu fur les modes, comme
je l’ai fait dans cet article 8c dans quelques autres,
parce, que Rouffeau n’avoit pas çlit un riiot fur
ces dénominations baroques appliquées à nos
modes , ni fur le rapport de nos modes à Ceux
des anciens ; 8c qu’il n’a point entendu, peut-être
pas. lu ce qu’ils ont dit, « Obfcurs fur toutes les
v parties de leur mufiquç , ils font prefqu’inin-
>3 telligibles fur celle-ci Cependant rien de plus
clair que le paffage que j’a i . c ité , 8c que ceux;
que j’ai indiqués ; lefquels.font plus que fuffifans
pour affigner précifémeht l’ordre, le nom 8c 1©
caraélère dç chaque n&çde, ( M, l’A U é Feytou,)
Sons hypatoïdes. Sons méfoïdes; Sons nétoïdes i
Tétrac. diezeugménon.
Tétrac, hypaton. Tétrac. méfon. Tétrac. fynemménon. Tétr. hyperboléon.
ïr t i ïr
O ra
3
«
O J g-
- f ô
s
O
sr* ► 0
"OPs
- %
para
trite
mèf
"3PP
s »3 3 V *• 3 3fiT.
P
5 P ' ns
ch e> S 3. 3 3 S. 3.
x
H
fer.-
2. o- X
0. "O O
c* Si Ç£-•
*t3 cr.
S î ï 'S 3> tu' o*5- 5TS
tétr. oxipyene. oxipyene,
tétr. baripyene, tétr. baripyene.
léfopycne. *
IF tou. plagal. apyene. hyperphrygen. O ù . du IIe ton authenf. baripycneJ\ypodonen.
■.<* ■ v ’ '— . ' ' ' '—J 11 >0 . —
V I e ton , plagal. baripyene. mixolydien.
V I e ton , plagal. méfopyen. lydien.
Ier ton, auvent, oxipyen. phrygien,
........... — »»y * ........... .. ■ «. t, f
IIIe ton , authent. baripyene. doriem
Vi.» ’ ” ' - * 1 " * ...............
V e ton , authent. méfopyene. hypolydieni
V. y I l'«"11 ■■■(- . »y »-'-1 '« f
V I Ie ton, authente. oxipyene. hypophrygien.,