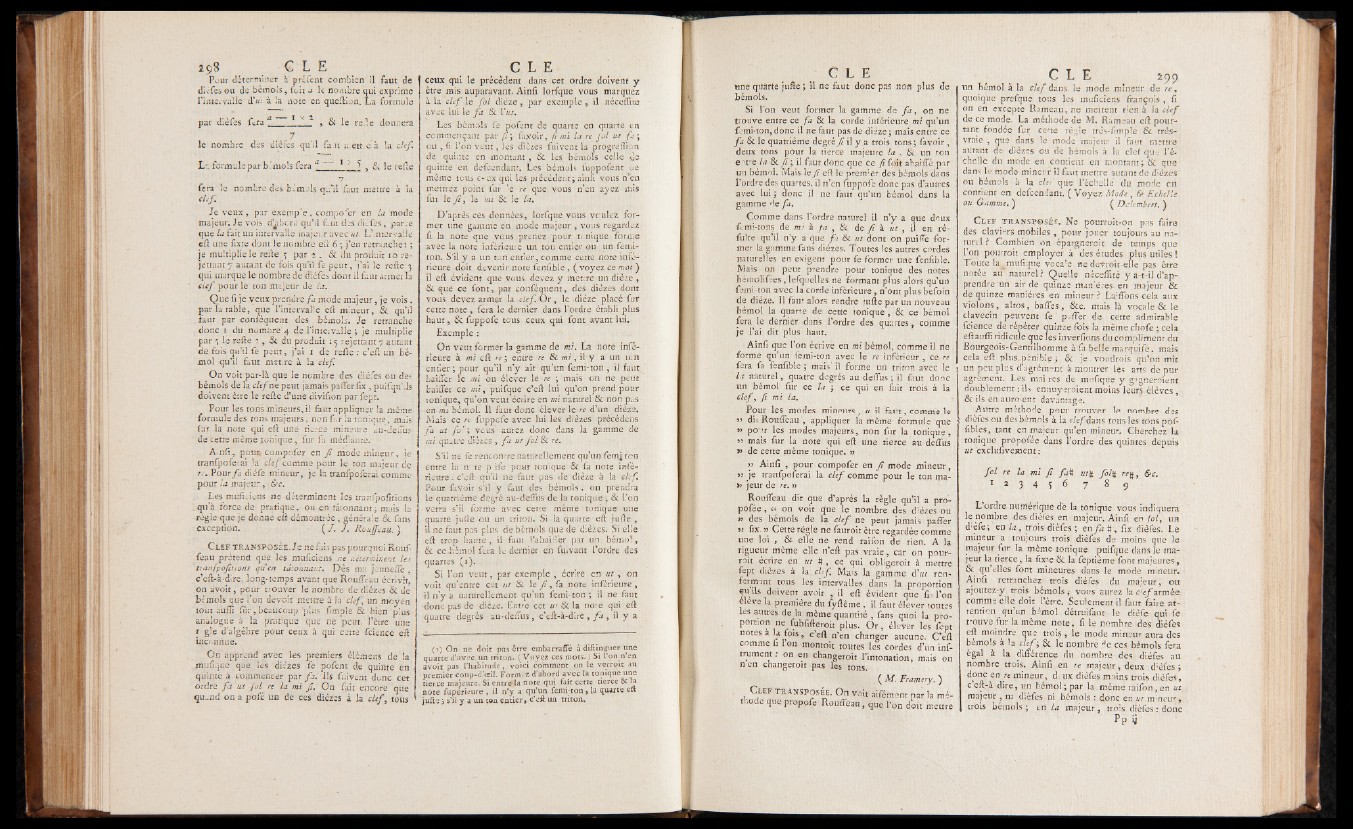
2 9 8 C L E
Pour déterminer à préfent combien il faut de ■
dièfes ou de bémols, foit *2 le nombre qui exprime
l'intervalle' d’iri à la note en queftion. La formule
par dièfes fera a 1 < _ , & le re.le donnera
«
le nombre des dièfes qu'il fa it n.ett.e à la clef.
Lr. formule par b.’mois fera a 1 > 5 } & le refte
7
fera le nombre des bimois qu’il faut mettre à la
Clef.
Je v e u x , par exemple, composer en la mode
majeur. Je vois d’abero qu’ il faut des dièfes , parce
que la fait un intervalle majeur avec ut. L’ intervalle
eft une fixte dont le nombre eft 6 ; j’en retranche 1 ;
je multiplie le refte 5 par 2 . & du produit 10 remettant
7 autant de fois qu’il fe peut, j’ai le relie 3
qui marque le nombre de dièfes dont il faut armerla
c le f pour le ton majeur de la..
Que fi je yeux prendre fa mode majeur, je vois ,
par la table, que l’intervalle elt mineur, & qu’il
faut par conféquent des bémols. Je retranche
, donc 1 du nombre 4 de l’intervalle ; je multiplie
par le relie 3 , & du produit 15 rejetant 7 autant
de fois qu’il fe peut, j’ai 1 de relie ; c’eii un bémol
qu’il faut mettre à la clef
On voit par-là que le nombre des dièfes ou des
bémols de la clef ne peut jamais pafferiîx, puifquMs
doivent être le relie d’une divifion par fept.
Pour les tons mineurs, il faut appliquer la même
formule des tons majeurs, non fur la tonique, mais
fur la note qui eli une tierce mineure au-Jeiius
de cette même ionique, fur fa médianre. -
Aînfi, pour* compofer en f i mode mineur, je
tranfpoferai la c le f comme pour le ton majeur de
rc. Pour fa dièfe mineur, je la tranfpoferai comme
pour la majeur , : &c.
Les mufiriens ns déterminent les tranfpolitions
. qu’à force de pratique, ou en tâtonnant; mais la
règle que je. donne eft démontrée, générale Sc fans
exception. { J . J. Roujfeau. )
C lef transposée. Je ne fais pas pourquoi Rouf-
leau prétend que les mufteiens ne déterminent les
tsanfpofitions quen tâtonnant. Dès ma jeunefte
c’eft-à-dire, long-temps avant que RouftVau écrivît,
on avoir, pour trouver le nombre de dièzes Sc de
bémols que l’on devoir mettre à la clef, un moyen
tout àuffi fur, beaucoup plus fimple & bien plus
analogue à la pratique que ne peut, l’être une
r g!e ‘d’algèbre pour ceux à qui cette fcience eli
inconnue.
Cn apprend avec les premiers élémens de la
jnufique que tes dièzes fe pofent de quinte en
quinte à commencer par fa. Ils faivent donc cet
ordre fa ut fo l re la mi fi. On fait encore que
qu-nd on a pofé un de ces dièzes à la clef, tous ’
C L E
ceux qui le précèdent dans cet ordre doivent y
être mis auparavant. Ainfi lorfque vous marquez
à la clef le fol dièze, par exemple , il néceffite
avec lui le fa Sc 1'«/.
Les bémols le pofent de quarte en quarte en
commençant par [i\ fayoir, fi mi la re J al ut fa ;
ou , fi l'on v e u t, les 'dièzes' fui vent la progrefilon
de quinte en montant, & les bémols celle de
quinte en defeendanr. Les bémols fuppofent oe
même tous cr-ux qui les précèdent; ainfi vous n’en
mettrez point fur *e re que vous n’en ayez mis
fur le f i y le nu 8c le la.
D ’après ces données, lorfque vous veulesf former
une gamme en mode majeur , vous regardez
fi.-la note que vous prenez pour te nique forme
-avec la note inférieure un tou entier ou un fenii-
ton. S'il y a un ton entier, comme cette note inférieure
doit devenir note fenfible , ( voyez ce mot )
il elt évident que vous devez y mettre un dieze ,
8c que ce font, par conféquent, des dièzes dont
vous devez armer la c le f O r , le dièze placé fur
cette note ; fera le dernier dans l’ordre établi plus
haut, 8c fuppofe tous ceux qui font avant lui.
Exemple :
On veut former la gamme de mi. La note inférieure
à mi eft re ; entre re 8c mi, il y a un ten
entier ; pour qu’il n’y ait qu’un femi-ton , il faut
bailler le mi ou élever le re ; mais on ne peut
bailler ce mi, puifque c’eft lui qu’on prend pour
ionique, qu’on veut écrire en mi naturel 8c non pas
en mi bémol. Il faut donc élever le rc d’un dièze.
Mais ce re fuppcfe avec lui les dièzes précédens
fa ut fo l ; vous" aurez donc dans la gamme de
mi quatre dièzes , fa ut fo l 8c re.
S’il ne fe rencontre naturellement qu’un fetni ton .
entre la n te p île pour tonique 8c la note inférieure
. c’eft qu’il ne faut pas de dièze à la clef.
Pour, favoir s’il y faut des bémols , on prendra
le quatrième degré au-delTus de la tonique, 8c l’on
verra s’il forme avec cette même tonique une
quarte jufte ou un triton. Si la quarte eft jufte ,
il ne faut pas plus de bémols que de dièzes. Si elle
eft trop haute , il faut l’abaitler par, un bém o l,
8c ce-bémol fera le dernier en fuivant l’ordre des
quartes (1 ).
Si l’on v eut, par exemple , écrire en ut , on
voit qu’entré cet ut 8c le f i , fa note, inférieure ,
il n’y a naturellement qu’un femi-ton ; il ne faut
donc pas de dièze. Entre cet ut 8c la note qui elt
quatre degrés au-cTeffiis, c’eft-à-dire , fa , il y a
(t) On ne doit pas être embarraffé à diftinguer une
quarte d’avec un triton. (V o y e z ces mots. ) Si Ton n’en
avoit pas l’habitude, voici comment on le verrait au
premier coup-d’oeil. Formez d’abord avec la tonique une
tierce majeure. Si entre la note qui fait cette tierce & la
note fupérieure > il n’y a qu’un femi-ton, la quarte eft
jufte 5 s’il y a un ton entier, c’êffiun triton.
C L E
une quarte jufte ; il ne faut donc pas non plus de
bémols.
Si l ’on veut former la gamme de f a , on ne
trouve entre ce fa 8c la corde inférieure mi qu’un
femi-ton, donc il ne faut pas de dièze ; mais entre ce
fa St. le quatrième degré}? il y a trois tons ; favoir ,
deux tons pour la tierce majeure la , 8c un ton
e iiti-e la 8c /?'; il faut donc que ce f i fefit abaiffé par
un bémol. Mais le f i eft le premier des bémols dans
l’ordre des quartes, il n’en fuppofe donc pas d’autres
avec lui ; donc il ne faut qu’un bémol dans la
gamme de fa.
Comme dans l’ordre naturel il n’y a que deux
IJ mi-tons de mi a fa , Sc de f i à ut , il en ré-
fulte qu’il n’y a que fa 8c ut dont on puiffe former
la gamme fans dièzes. Toutes les autres cordes
naturelles en exigent pour fe former une fenfible.
Mais oji peut prendre pour tonique dés notes
bémol.ifèes, lefquelles ne formant plus alors qu’un
femi-ton avec la corde inférieure, n’ont plus befoin
de dièze. Il faut alors rendre jufte par un nouveau
bémol la quarte de cette tonique , 8c ce bémol
fera le dernier dans l’ordre des quartes, comme
je l’ai dit plus haut.
Ainfi que l’on écrive en mi bémol, comme il ne
forme qu’un femi-ton avec le re inférieur , ce re
fera fa fenfible ; mais il forme un triton avec le
/./''naturel, quatre degrés au deffus ; il faut donc
un bémol fur ce la ; ce qui en fait trois à la
c le f y f i mi la.
Pour les modes mineurs, « il faut, comme le
»5 dit Rouffeau , appliquer la même formule que
»> po"jr les modes majeurs, non fur la tonique,
95 mais fur la note qui eft une tierce au deffus
n de cette même tonique, n
99 Ainfi , pour compofer en f i mode mineur,
93 je tranfpoferai la clef comme pour le ton ma-
» jeur de re. »
Rouffeau dit que d’après la règle qu’il a pro-
p ofée, ce on voit que le nombre des dièzes ou
» des bémols de la clef ne peut jamais paffer
9J fix. 3> Cette règle ne fauroit être regardée comme
une loi , St- elle ne rend raifon de rien. A la
rigueur même elle n’eft pas vraie, car on pourrait
écrire en ut # , ce qui obligeroit à mettre
fept diczes a la clef. Mais la gamme d’ut renfermant
tous les intervalles dans la proportion
qu ils doivent avoir , il eft évident que fi* l ’on
eleve la première du fyftême , il faut élever toutes
les autres de la même quantité , fans quoi la proportion
ne fubfifteroit plus. O r , élever les fept
notes a la fois, c’eft n’en changer aucune. C ’eft
comme 11 ion montoit toutes les cordes d’un inf-
trument ; on en changeroit l’intonation, mais on
n en changeroit pas les tons.
Clef transposée. On voit aifément parla,
tliode quepropofe Roufleau, que l'on doit me
C L E 2 9 9
un bémol à la c le f dans le mode mineur de re,
quoique prefque tous les muficiens françois , fi
on en excepte Rameau, ne mettent rien à la cle f
de ce mode. La méthode de M. Rameau eft pourtant
fondée fur cette règle très-fimple & très-
vraie , que dans le mode majeur il faut mettre
autant de dièzes ou de bémols à la clef que l'échelle
du mode en contient en montant; Sc que
dans le mode mineur il faut mettre autant de dièzes
ou bémols à la clef que l’échelle du mode en
contient en defeendant. ( Voyez Mode , & Echelle
ou Gamme. ) ( Dalembert. )
C lef transposée. Ne pourroit-on pas faire
des claviers mobiles , pour jouer toujours au naturel
? Combien on épargneroit de temps que
l’on pourroit employer à des études plus utiles !
Toute la^mufique vocale ne devroit-eile pas être
notée au naturel? Quelle néceflité y a-t-il d’apprendre
‘Un air de quinze man ëres-en majeur &
de quinze manières en mineur ? Laiffons cela aux
violons, altos, baffes , &c. mais là vocale Sc le
clavecin peuvent fe ' p,ffer de cette admirable
fcience de répéter quinze fois la même chofe ; cela
eftaufli ridicule que les inverfions du compliment du
Bourgeois-Gentilhomme à fa belle marquife. mais
cela eft phis^pénible ; & je voudrais qu’on mît
un peu plus d’agrément 3 montrer les arts de pur
agrément. Les rnaî res de mofique y gagneraient
doublement : ils ennuyeroient moins leurs élèves ,
Sc ils en auro-ent davantage.
Autre méthode pour trouver le nombre des
dîefes ou des bémols à la clef dans tous les tons pof-
fibles, tant en majeur qu’en mineur. Cherchez la
tonique propofée dans l’ordre des quintes depuis
ut exclufivement :
fo l re la mi f i fa § ut% fol§ r*#, &c.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L’ordre numérique de la tonique vous indiquera
le nombre des dièfes en majeur. Ainfi en fol, un
d'èfe; en la , trois dièfes ; en fa # , fix dièfes. Le
mineur a toujours trois dièfes de moins que le
majeur fur la même tonique puifque dans le majeur
la tierce, la fixie & la feptième font majeures,
& qu’elles font mineures dans le mode mineur.
Ainïi retranchez trois dièfes du majeur, ou
ajoutez-y trois bémols vous aurez la c>ef armée
comme elle doit l’être. Seulement il faut faire attention
qu’un bémol détruifant le dièfe qui fe
trouve fur la même note, fi le nombre des dièfes
eft moindre que trois , le mode mineur aura des
bémols à la clef ; & le nombre de ces bémols fera
égal à la différence du nombre des dièfes au
nombre trois. Ainft en re majeur, -deux d'èfes ;
donc en re mineur, d:ux dièfes mains trois dièfes,
c’eft-à-dire, un bémol; par la même raifon, en ut
majeur , ni dîefes ni bernois r.donc en ut nvncur,
trois bémols ; en la majeur, trois dièfes : donc
Pp ij