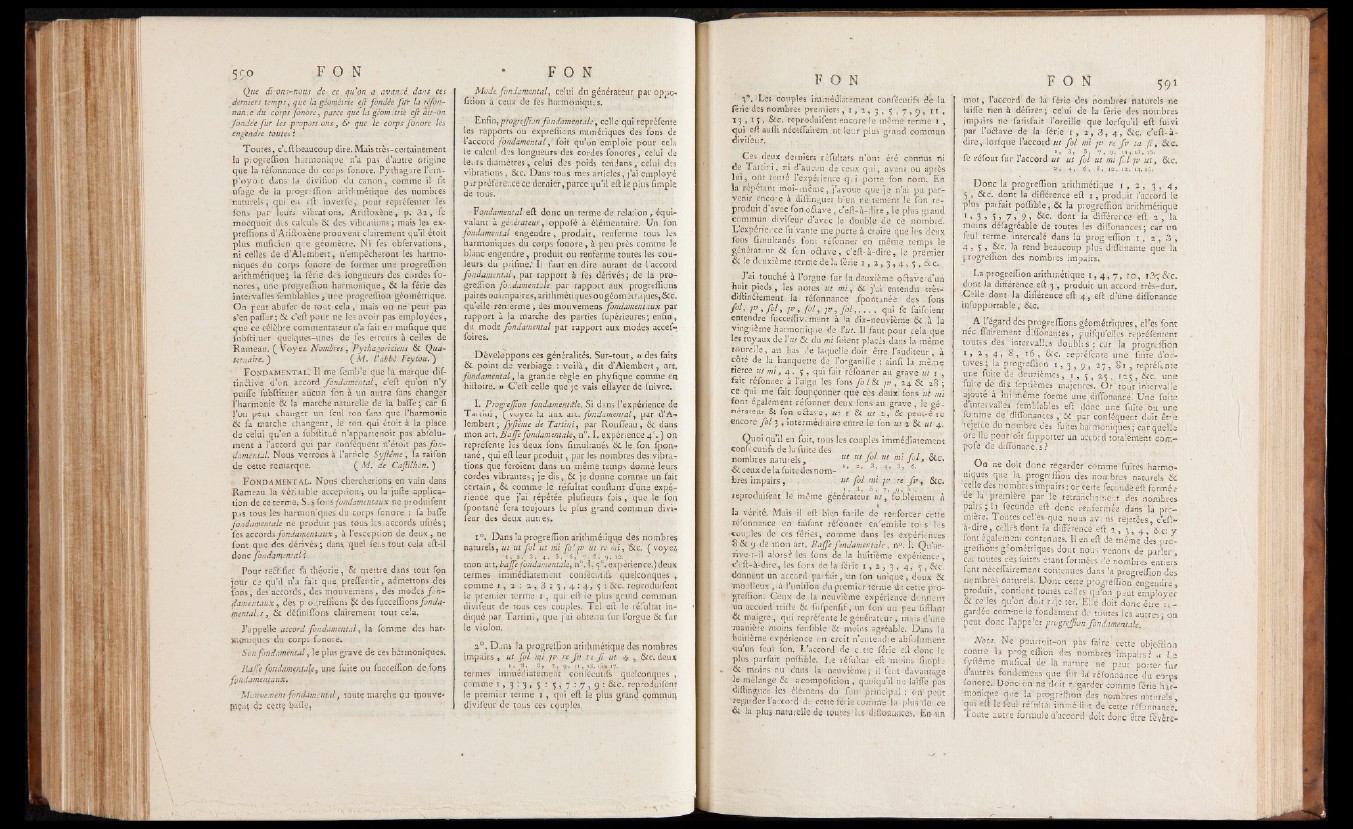
Que dirons-nous de ce qu’on a avancé, dqnsces
derniers temps, que la géométrie ejl fondée fWr la rèfon-
nan.e du corps fonore, parce que la géométrie ejl dit-on
fondée fur les proportions , & que le corps fonore les
èngèndre toutes ?
Toutes, c\.ft beaucoup dire. Mais très-certainement
la progreffion harmonique n’a pas d’autre origine
que la réfonnance du corps fonore. Pythagore l’efri-
p'oyoit dans la divifion du canon, comme il fît
ufage de la progr-rffioB arithmétique des nombres
naturels, qui'en eft inverfe, pour repréfenter lés
fons par leurs vibrât ons. Ariffoxène, p. 32 , fe
mocquoit des calculs & des vibrations; mais les ex-
p reliions d’Ariftoxène prouvent clairement qu’il étoit
plus muficien q/e géomètre. Ni fes obfervations,
ni celles de d’Alcmbert, n’empêcheront les harmoniques
du corps fonore de former une progreffion
arithmétique; la férié des longueurs des cordes fo-
nores, une progreffion harmonique, & la férié des
intervalles femblables s une progreffion géométrique.
On peut àbufer de tout cela , mais on né'peut pas
s’en palfer; & c’eft pour ne les avoir pas employées,
que ce célèbre commentateur n’a fait en mulique que
fubfti.uer quelques-unes de fes erreurs à celles de
Rameau. (V o y e z Nombres, Pythagoriciens & Quaternaire.
) - . (Af. l’dbbéFeytàu. ')
Fondamental.' Il me femble que la marque dif-
tinélive d’un accord fondamental y c’eft qu’on n’y
puiffé fubffituer. aucun fon a un autre fans changer
l’harmonie & la marche naturelle de la baffe ; car fi
l’on peut changer un feul ton fans que l’harmonie
& fa marche changent, le ton qui étoit à la place
de celui qu’on a fubftitué n’appartenoit pas abfolu-
ment à l’accord qui par conféquent n’étoit pas.fondamental.
Nous verrons à l’article Syflême, la raifon
de cette remarque. ( M. de Cajlithon. )
F ondamental. Nous chercherions en vain dans
Rameau la véritable acception.-*, ou la jufte application
de ce terme* S; s fous fondamentaux ne produifent
pas tous les harmon’ques du corps fonore : fa baffe
fondamentale ne produit pas tous les accords ufités ;
fes accords fondamentaux, à l’exception de deux , ne
font que des dérivés ; dans, quel fens tout cela eft-il
donc fondamental »■.
Pour rectifier fa théorie, & mettre dans tout fon
jour ce qu il n a fait que preffentir, admettons des
{bris, des accords, des mauvemens, des modes fondamentaux
, des progreflions & des fucceffions fonda.-
jnentaLs, & défîniffons clairement tout cela.
J’appelle accord fondamental, la fomme des harmoniques
du- corps fonoré,.
Son fondamental, le plus grave de ces harmoniques.
Baffe fondamentale, une fuite pu fucceffipn de/oqs
fondamentaux.
Mouvement fondamental, toute marçhé 0/4 tpouve-
dé cettç baffe*
Mode, fondamental, celui du générateur par oppo-
fîtion à ceux de fes harmoniques.
Enfin, progreffion fondamentale, cell e qui répréfente
les rapports ou exprelîicns numériques des fons de
l’accord fondamental f foit qu’on emploie pour cela
le calcul des longueurs des cordes fonores, celui de
leurs diamètres, celui des poids t en dans, celui des
vibrations, &c. Dans tous mes articles, j’ai employé
par préférence ce dernier, parce qu’il eft le plus fimple
de tous. -
fondamentaleft donc un terme de relation , équivalant
à générateur, oppofé à. élémentaire. Un fon
fondamental engendre, produit, renferme tous les
harmoniques du corps fonore, à peu près comme le
blanc engendre, produit ou renferme toutes les couleurs
du prifmç.'Il faut en dire autant de l'accord
fondamental y par rapport à fes dérivés; de la progreffion
fondamentale, par rapport aux progreffions
„paires ou impaires, arithmétiques ou géométriques, &c.
.qu’elle* renferme ; des mouvemens fondamentaux par
rapport à la marche des parties fupérieures; enfin,
du mode fondamental par rapport aux modes accef-
foires.
Développons ces généralités. Sur-tout, « des faits
& point de verbiage : voilà, dit d’Alçmhert, art.
fondamentalla grande règle en phyfique comriie en
hiftoire. » C ’eft celle que je vais effayer de fuivre.i
I. Progreffon fondamentale. Si dans l’expérience de
Tartini, (voyez la aux art. fondamental, par d’A-»
lembert ; fyflême de Tartini y par Rouffeau , & dans
mon art, Baffe fondamentale, n°. I. expériènce ) on
repréfente les ~deux fons fimulranés &. le fon fppn-*
tané, qui eft leur produit, par les nombres des vibra-,
tions que feraient dans un même temps donné leurs
cordes vibrantes; je dis, & je donne comme un fait
certain, 6c comme le réfultat confiant d’une expérience
quç j’ai répétée pjufieurs fois, que le fon
fpontané fera toujours le pl.us grand commun diyi-
feur des deqx auues.
i° . Dans la progreffion arithmétique des nombre^
naturels, ut ut fol ut mi fo'.qv ùt re mi, &c. (voyez
tl , 2," 3 , 4 , 5 , 6j 1 "7. 8/ '9$? 1 os '
mon art, baffe fondamentale, n°. L 3e. expérience.) deux
termes imriiédiatement confécutifs quelconques ,
comme i , 2 : 2 3 : 3 ,4 : 4 , 5 ; &c. reproduifent
le premier terme 1 , qui eft i]e plus grand commun
divifeur de tous ces couples. Tel. eft le réfultat indiqué
par Tartini, que. j’ai obtenu fur l’orgue & fur
îç violoni
20. Dans la progreffion arithmétique des nombres
impairs , ut fol énfi ,jv re fv ta f i ut & , &c. deux
j , 1,. -f t. 5 j 7 . tf., 1 1 , 13, 17. ,
termes immédiatement corifécutifs quelconques ,
comme 1 , 3 : 3, 3 : 5 ? 7 : y , 9 : &c. reproduifênç
le premier terme 1 , qui eft le plus gran$ ÇQmpniq
djyifçur de |ous ces cquplesç
3®. Lès couples immédiatement confecutifs de la
férié des nombres premiers » 1 » 2 » 3 , , 7 , 9 * 1 1 ,
13 » 15 > & c- reproduifent encore le même terme 1 ,
qui eft aulfi neceffairèm.nt leur plus grand commun
divifeur.
Ces deux derniers réfültats n’ont été connus ni
de Tartini, ni d’aucun de ceux qui, avant ou après
lui , ont tenté l’expérience qi i porte fon nom. En
la répétant moi-même, j’avoue .que je n’ai pu parvenir
encore à diftinguer b’en nettement le fon reproduit
d’avec fon oélave, c’eft-à-dire , le plus grand
commun divifeur d’avec le double de ce nombre.
L ’éxpèrierce fu vante me porte à croire que les deux
fons fimùltanés font réfonner en même temps le
générateur & fen oélave, c’eft-à-dire, le premier
& le deuxième terme de la férié 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , & ç.
J ai touché à l’orgue fur la deuxième oélave d’un
huit pieds, les” notes ut mi, 6c jbi entendu *rès-
diftinélément la réfonnance .fpontanée ' des fons
lv ■> f ° l •> 1V » fol? lv ? fol ■ >.... qui fe fai (oient
entendre fucceffivement à la dix-neuvième 6c à la
vingtième harmonique de fu t . Il faut pour cela que
les tuyaux de 1 ut 6c du mi foient placés dans la même
1 3 au ^as de laquelle doit être l’auditeur , à
côté de la banquette de/ lVganifle : ainfi la même
tierce ut mi, 4 , 5 , qui'fait réformer au grave ut j ,
fait réfonner à l'aigu les fons ÿo/êc )v , 24 8c 28 ;
ce qui me fait foupçonnër que ces deiix fons ut mi
font également réfonner deux fons au.grave , le générateur
& fon oélave, ut 1 6c ut a , 6c peut-ê re
encore fo l 3 , intermédiaire entre le fon ut 2 Sl ut 4,
, Quoi qu’il en foit, tous les couples Immédiatement
confecutifs de la fuite des . ;
nombres naturels, ut ut fo l ut mi fo lt &c.
8c ceux de la fuite des nom- *’ 2’ ’ 4’ v
bres impairs , . ut fo l mi.jv re Jv<$ 6cc.
reproduifent . le même générateur ut, fo.blemerit à
la vérité. Mais il eft bîe;n facile de renforcer cette
réfonnance en fa'ifant réfonner ensemble toi s les
-couples de ces fériés, comme dans les expériences
8 6c 9 de mon art. Baffe fondamentale , n°; k Qu’arrive
t-il alors? les fons de. la huitième expérience ,
c\ft-à-dire, les fors de la férié 1 ,2 , 3 , 4, 3 . 8cc.
donnent un accord parfait, un fbn unique, dôux 8c
moelleux ,*à l’uniffon du premier terme de cette pro-
gTeffion. Ceux de la neuvième expérience donnent
un accord trifte 8c fofpenfif, un fon un peu fi filant
8c maigre, qui repréfente le générateur, mais cTune
manière^ moins (ènfible & moins agréable. Dans la
huitième expérience on croit n’cniend:e abfolument
qu’un feu'l fon. L’accord de c.tt'e férié eft donc le
plus parfait poftible. Le réfultat eft. moins fur.pb
8c moins nu dans la neuvième; il fent -davantage
le mélange 8c acompofition , quoiqu’il^ne làiffe pas
diftir.guep les élémens du fon 'principal : ori' peut
regarder l’accord d- cettè férié comme la plus 'dot cé
& la plus naturelle de toutes les diffonances. En^un
mot, l’accord de laf férié des nombres naturels ne
laiffe rien à défirer ; celui de la férié des nombres
impairs ne Satisfait l’oreille que lorfqu’il eft fuivi
par l’oélàve de la férié 1 , 2 , 3 , 4 , 8cç. c’eft-à-
dire, lorfque l’accord ut fo l mi jv re fv ta f i , 8cc.
. , r ' '*» 3 , 5 , 7 , .9, ; i i , i3 , 15.
fe refout fur 1 accord ut ut fol ut mi f i l iv ut, 8cc.
, 2 , 4, 5 , . 8 , . 10 , 12, 14,16.
Donc la progreffion arithmétique r , 2 , 3 , 4 ,
5 , 8cc. dont la différence eft 1 , produit l’accord le
plus parfait poffible, 8c la progreffion arithmétique
1 ? 3 , 5 » 7 » 9 » dont la diffère h ce> eft 2 , la
moins défagréable de toutes les diffonances; car un
feul terme intercalé dans la prbg-’effion 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 8cc. la rend beaucoup plus diffbnante que la
progreffion des nombres imoairs.
La progreftxon arithmétique 1 , 4 , 7 , 10 » 12r; & c.
dont Ja différence eft 3,, produit un accord très-dur.
•Cèille dont la. différence eft; 4 , eft d’une diffonance
infupportable, 8cçk
, A l’égard des progreffions géométriques, elles font
nec..ffairement d.ffonantes, piiifqu’elles repréfentent
toutes des intervalles double s : car la progreffion
1 > 2 5 4 ) $ 1 I f ÿ &c. repréfènte une fuite d’octaves
; la progrefiion 1 , 3 ,9 , 27 , 8 r , repréfente
une fuiîe qe douzièmes, 1 , 3 , 25 , 1 2 5 , 8cc. une
fuite de dix feptièmës majeures.; Or tout inter val le
ajpute a lui-'rî'iême forme une difforiaricé! Une fuite
d intervalles •feriibî^bles eft donc une fuite bu une
fomme de diffonances, 6c par conféquent doit ê f e
réjetée du no'mb’ré des fuites harmoniques; car quelle
ore lie pouf/oit fupporter un accord totalement corn—
pofè de diffonarC.s?
On ne doit donc regarder comtrie fuites.-harmo--
riiques que la progrefiion des nombres naturels 6c
celle deàhdmbresÏmpaïfs : o:r cëtté fécondé eft formée
de_ la , première par le ietrànçherrièr.t dès nombres
pairs; la fécondé eft donc renfermée dans la première.
Toutes celles-que nouis ave ris rejetées, ceff-
à-dire,;celles dont la différence eft 2 , 3 , 4 , &C: y
font egalement contenues. Il en eft de même des orO“
greffions geometnques dont nous venons de parler,
car toutes ces fuites étant formées c!e nombres entiers
font neceffairement contenues dans la progreffion des
nombres naturels. Donç cette progreffion engendre ,
produit, contient toutes celles qu’ba peut employer
oc cè’lës qu’ôiï 'doiri-eje ter. Elle doit donc être regardée
comme lé fondement de toutes les autres; on
peut donc l’appeler progreffion fondamentale.
Nota. -Ne pourroit-on pas faire' cette objeélion
contre la prog ëffibn des nombres impairs? « Le
fyftême mufical de là nature né peut porter fur
d’autres fondèmens que fur là réfonnance du corps
fonore;: pbncl bri* né doit regarder comme férié hâr-
moriique que la': prdgrëffio« des notribres naturels,
quii'*eft le'feùl' refitîtât immédiat de cette réfonnance.
Toute autre formule d’accord doit dohe être févère