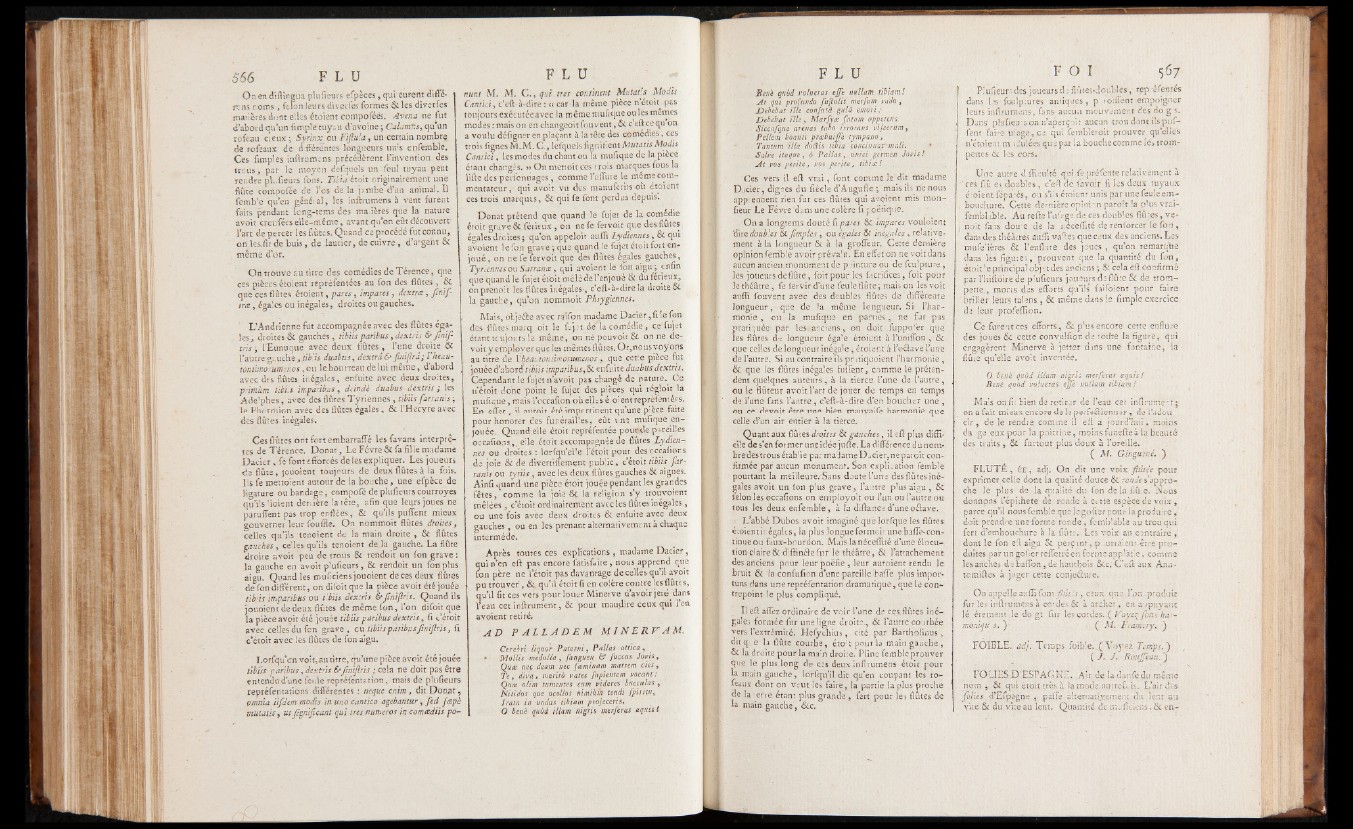
5 6 6 F L U
On en difiingua plufieurs efpèces, qui eurent difte*
rens roms , félon leurs diverfes formes & les diverfes
matières dont elles étoient eompoféës. Avenu ne fut
d’abord qu’un fimpletuyc.ii d’avoine ; CalamT,s, qu’un
rofeau creux ; Syrinx ou Fifiula, un certain nombre
de rofeaux de différentes longueurs unis enfemble.
Ces fimples inftrununs précédèrent l’invention des
trous, par le moyen defquels un feul tuyau peut
rendre pLfieurs fons. Tibia é i oit criginairément une
flûte compofée de l’os delà jambe d’un animal.il
femb’e qu’en généial, les inftrumens à vent furent
faits pendant lcng-tems des ma.ières que la nature
avoit creufées elle-même, avant qu’on eût découvert
l’art de percer les fûtes. Quand ce procédé fut connu,
ori les.fit de buis, de laurier, de cuivre, d’argent &
même d’or.
On trouve au titre des comédies de Térence, que
ces pièces étoient repréfentées au fon des flûtes, &
que ces flûtes étoient, pares, impures, dextm, finif-
tm , égales ou inégales, droites ou gauches.
L’Andriénne fut accompagnée avec des flûtes égales,
droites & gauches, tibiïs paribus, dextris & finif-
tris ; l’Eunuque avec deux flûtes , l’une droite &
l’autre gauche , tibiis duabus, dextrâ & Juiiflra • l heaii-
tontmorumznos, ou le bourreau de lui même, d’abord
avec des flûtes inégales, enfuite avec deux droites,
piimiim tibiis impuribus, deïndè duabus dextris ; les
Adelphes, avec des flûtes Tytiennes , tibiïs farranis ;
le Phcrmion avec des flûtes égales, & l’Hecyre avec
des flûtes inégales.
Ces flûtes ont fort embarraffé lesfavans interprètes
de Térence. Donat, Le Févre & fa fille madame
Dacier, fe font efforcés de les expliquer. Les joueurs
de flûte, jouoient toujours de deux flûtes à la fois.
Ils fe mettoient autour de la bouche, une efpèce de
ligature ou bandage, compofé de plufieurscourroyes
qu’ils 'ioient dernète la tête, afin que leqrs joues ne
paruffent pas trop enflées, & qu’ils puffent mieux
gouverner, leur fouffle. On nommoit flûtes droites ,
celles qu’ils tenoierit de la main droite , & flûtes
gauches, ce’les qu’ils tenoient de. la gauche. La flûte
droite avoit peu de trous & rendoit un fon grave :
la gauche en avoit plufieurs, & rendoit un fon plus
aigu. Quand les muficiens jouoient de ces deux flûtes
- de fon différent, on difoit que la pièce avoit été jouée
tibiis imparibus ou tibiis dextris &Jinijlris. Quand ils
jouoient de deux flûtes de même fon, l’on difoit que
la pièce avoir été jouée tibiis paribus dextris, fi c’étoit
avec celles du fcn grave, eu tibiis paribus Jinijlris t fi
c’étoit avec les flûtes de fon aigu.
Lorfqu’cm voit, au titre, qu’une pièce avoit été jouée
tibïcs paribus, dextris &Jinijlris ; cela ne doit pas être
entendu d’une feule repréfentation, mais de plufieurs
repréfen tâtions différentes : neque enim, dit Donat,
çrnnia iifdem modis in uno cantïco agebantur j fed foepè
mutatis, ut fignificartt qui très numéros in comoediis po-
F L U
nutit M. M. C . , qui très continent Mutatis Modis
Cantici, c’eft-à-dire : « car la même pièce n’etoit^ pas
toujours exécutée avec la même mufique ouïes memes
modes : mais on en changeoit fouvent, & c eu ce qu on
a voulu défigner en plaçant à la tête des comédies, ces
trois Agnes M. M. C ., lefquels fignifient-Mutatis Modis
Cantici, les modes du chant ou la mufique de la pièce
étant changés. » On mettoit ces trots marques fous la
lifte des perfonnages, comme l’affure le meme commentateur,
qui avoit vu des manuferits ou étoient
ces .trois marques, & qui fe font perdus-depuis.,
Donat prétend que quand le fujet de la comédie
étoit grave & férieux , on ne fe fervoit que des flûtes
égales droites ; qu’oft appeloit aufii Lydiennes , &. qui
avoient le fon grave ; que quand le fujet étoit fort enjoué,
on ne fe fervoit que des flûtes égales gauches,
Ty Tiennes ou S arrange, qui avoient le fon aigu ; enfin
que quand le fujet étoit mêlé de l’enjoue & du férieux,
on prenoit les flûtes inégales-, c’eft-à-dire la droite &
la gauche, qu’on nommoit Phrygiennes.
Mais, otje&e avec ra'ifon madame Dacier, Ale fon
des flûtes marq oit le fujet dé la comédie, ce fujet
étant .toujours le même, on né pouvoir & on ne de-
voit y employer que les mêmes flûtes. Or,nous voyons
au titre de Yheauonûmorumenos, que cette piece fût
jouée d’abord tibiis imparibus,& enfuite duabus dextris.
Cependant le fujet n’avoit pas changé de nature. Ce
n’étoit donc point le fujet des pièces qui régloit la
mufique, mais l’pccafion oii eilts é . o: ent repr éf en r ç?s.
En effet, il auroit été impertinent qu’une pièce faite
pour honorer des funérailles, eût une mufique enjouée.
Quand elle étoit repréfentée pout'de pareilles
occafions,. elle étoit.accompagnée de flûtes Lydiennes
ou droites : lor(quelleTétoit pour descccafiors
de joie & de divertiffement public, c’étoit tibiis farranis
ou tyrïis, avec les deux flûtes gauches & aigues.
Ainfi quand une pièce étoit jouée pendant les grandes
fêtes, comme la joie & la religion s’y trouvoient
mêlées , c’étoit ordinairement avecles flûtes inégales ,
ou une fois avec deux droites & enfuite avec deux
gauches , ou en les prenant alternativement à chaque
intermède.
Après toutes ces explications , madame Dacier,
qui n’en eft pas encore fatisfaite, nous apprend que
fon père ne l’étoit pas davantage de celles qu’il avoit
pu trouver , &. qu’il étoit fi en colère contre les flûte s,
qu’il fit ces vers pour louer Minerve d’avoir jeté dans
l’eau cet inftrument, & pour maudire ceux qui l’en
avoient retiré.
A D P A L L A D E M M I N E R V AM ,
Cerebri liqtior Pater ni, P allas attica,
• Mollis medulla , fanguen & fuccus Jouis,
Quoe nec deam nec feeminam mat rem. des,
Te, diva.3 merità vates fapientem vacant:
Quoe olim tumentes cum videres bucculas ,
Nitidos que oc&llos niiniàm tendi fpiritu,
Irata in undas tibiam projeceris
O benè quoi illain aigris mer fer as aquisi
F L U
Benè quàd volueras ejfe nullam tibiam!
At qui profundo ' ftiflulit metfam va'do,
JDebebat il le confut â gulâ emori:
Jjebebat ille, Mar [y ce fatum oppetens
Siccafque area as tabo irrorans vifeerum,
Pellein boanti prabuijfe tympano.
Tantum'ilia do6tis tibia cùnciniiat^mali. *
Salve itaque, ô Pallas uni ci germen Jovis!
At vos petite, vos perite, tibial .
Ces vers il eft v ra i, font comme le dit madame
Ddciér, dignes du fiècle d’Augufle ; mais ils" ne nous
apprennent rien fur ces flûtes qui avoient mis mon-
Aeur Le Févre dans une colère fi poétique.
On a longtems douté fi pares & impures voulaient
‘dire doubles 6L fimples , ou égales & inégales, relativement
à la longueur & à la groffeur. Cette dernière
opinion femble avoir pré valu. En effet on ne voit dans
aucun ancien monument de peinture ou de fcalpture,
les joueurs de flûte, foit pour les facrifices, foit pour
le théâtre, fe fervir d’une feule flûte; mais on les voit
aufli fouvent avec des doubles flûtes de différente
longueur, que de la même longueur. Si l’harmonie
, ou la mufique en parties, ne fur pas
pratiquée-par les anciens, on doit fuppo'er que
les flûtes d-s longueur éga’e étoient à l’uniflon , &
que celles de longueur inégale ; étoient à l’oélave l’une
de l’autre. Si au contraire ils pr itiquoient l’harmonie,
& que les flûtes inégales fuflent, comme le prétendent
quelques auteurs, à la tierce l’une de l’autre,
ou le Auteur avoit l’art de jouer de temps en temps
de l’une fans l’autre, c’eft-à-dire d’en boucher une ,
ou ce devoit être une bien mauyaife harmonie que
celle d’un air etftier à la tierce.
Quant aux flûtes drqites & gauches, il eft plus difficile
de s’eh former une idée jufle. La différence du nom-
bredestrousétablie par madamçDacier,ne paroît confirmée
par aucun monument. Son explication femble
pourtant la meilleure.'Sans doute l’une des flûtes inégales
avoit un fon plus grave, l’antre plus aigu , &
lelon les ôccafiôns on employolt ou l’un ou l’autre ou
tous les deux enfemble, à la diftanced’uneoftave.
L abbé Dubos avoit imaginé que lorfque les flûtes
étoient inégales, la plus longue formoir une bafle-con-
tinueou faux-bourdon. Mais lanéceflité d’une élocution
daire & diftinde fur le théâtre, & l’attachement
des anciens pour leur poëfie , leur auroient rendu le
bruit & la confufion d’une pareille baffe plus importuns
dans une repréfentation dramatique, que le contrepoint
le plus compliqué.
Il eft affez ordinaire de voir l’une de ces,flûtes inégales
formée fur une ligne droite., & l’autre courbée
vers l’extrémité. Hefychius, cité par Bartholinüs,
dit q e h flûte courbe, éto’t pour la main gauche ,
& la droite pour la ma’n droite. Pline femble prouver
que le plus long de c:s deux infi rumens étoit pour
la main gauche, lorfqu’il dit qu’en coupant les rofeaux
dont on veut les faire, la partie la plus proche
de la ferre étant plus grande , fert pour les flûtes de
la main gauche, &c.
F O I 567
Piufieur" des joueurs d ’ flûtes-doubles, repi éfentés
dans les' foulptures antiques, p .roi fient empoigner
leurs inftrumens, fans^ aucun mouvement des do.g s.
Dans plufieu's on n’aperçoit aucun trou dont ils puffent
faire ufage, ce qui fembleroit prouver qu’eliés
n’étoiem m vdulées que par la bouchecomme lé> trompettes
& les cors.
Une autre d fficulré qui fe.préfente relativement à
''ces fiû es doubles, c’eft de lavoir fi les deux tuyaux
éroient fépa'és, ou s’ils étoient unis par une feule embouchure.
Cette dernière opinion paroît la plusvrai-
fembhible. Au refte l’uftge de ces doubles flûres, ve-
noit fais dou'e. de la r.éeeffité de renforcer le fon ,
dans dés théâtres suffi vaftes que ceux des anciens. Les
mufe’ières & l’enflure des jones , qu’on remarque
dans les figure;, prouvent que la quantité du fon,
étoit 'e principal objet des anciens ; & cela eft confirmé
par l’hiftoire de plufieurs joueurs de flûte & de trompette.,
mûris des efforts qu’ils' faifoiént pour faire
briller leurs talens , & même dans lé ftmple exercice
ch lèur profeffion.
Ce furent ces efforts, & p’us encore cette enflure
des jolies & cette convulfton de toute la figure, qui
engagèrent Minerve à jetter dans une fontaine, la
flûte qu’elle avoit inventée.
O benè quàd illam nigriz merferas aquis!
Benè quàd volueras ejfe nullam tibiam!
Mais on fi: bien de retiror de 1|eau cet infiniment;
on a fait mieux encore de Ie perfeéîionner, de l’adoucir
, de le rendre comme il eft a -jourd’hui, moins
da;ge eux pour la poitrini3, mo irîs fuîiefteà la beauté
de;5 traits , & furtout plu:s doux à l’oreille.
( AI. Gïngtizné. )
F LU T É , ée , adj. On dit une voix flûtée pour
exprimer celle dont la qualité douce & ronde s’approche
le plus de la qualité du fon de la fiû:e. Nous
donnpns Fépithete de ronde à cette espèce de voix ,
parce qu’il nous femble que legofier pour la produire ,
doit prendre une forme ronde, femb’abla au trou qui
fert d’embouchure à la flûte. Les voix au contraire ,i
dont le fon eft aigu & perçinr, p .urraient-être produites
par un gofier refferré en forme applâtle, comme
les anches de baffon, de hautbois &c. C ’eft aux Ana-
temiftes à juger cette conje&ure.
On appelle au Aï fons fiât : s , ceux que Ion p rodent
fur les inftrumens à cordes & à archet, en appuyant
légèrement le do gt fur les cordes. ( Voye^ fions hàr-
moniqu s . f i ( M. Fiamcry. )
FÔIBLE. adj. Temps foibîe. ( Voyez Temps. )
( J. J. Roujfeau. )
FOLIES D ’ESPAGNE. Air de la danfe du même
nom , & qui étoit très à la mode autrefois. L’air des
folies d’Efpagne , paffe alternativement du lent au
vite & du, vite au lent. Quantité de nwficiens. & en