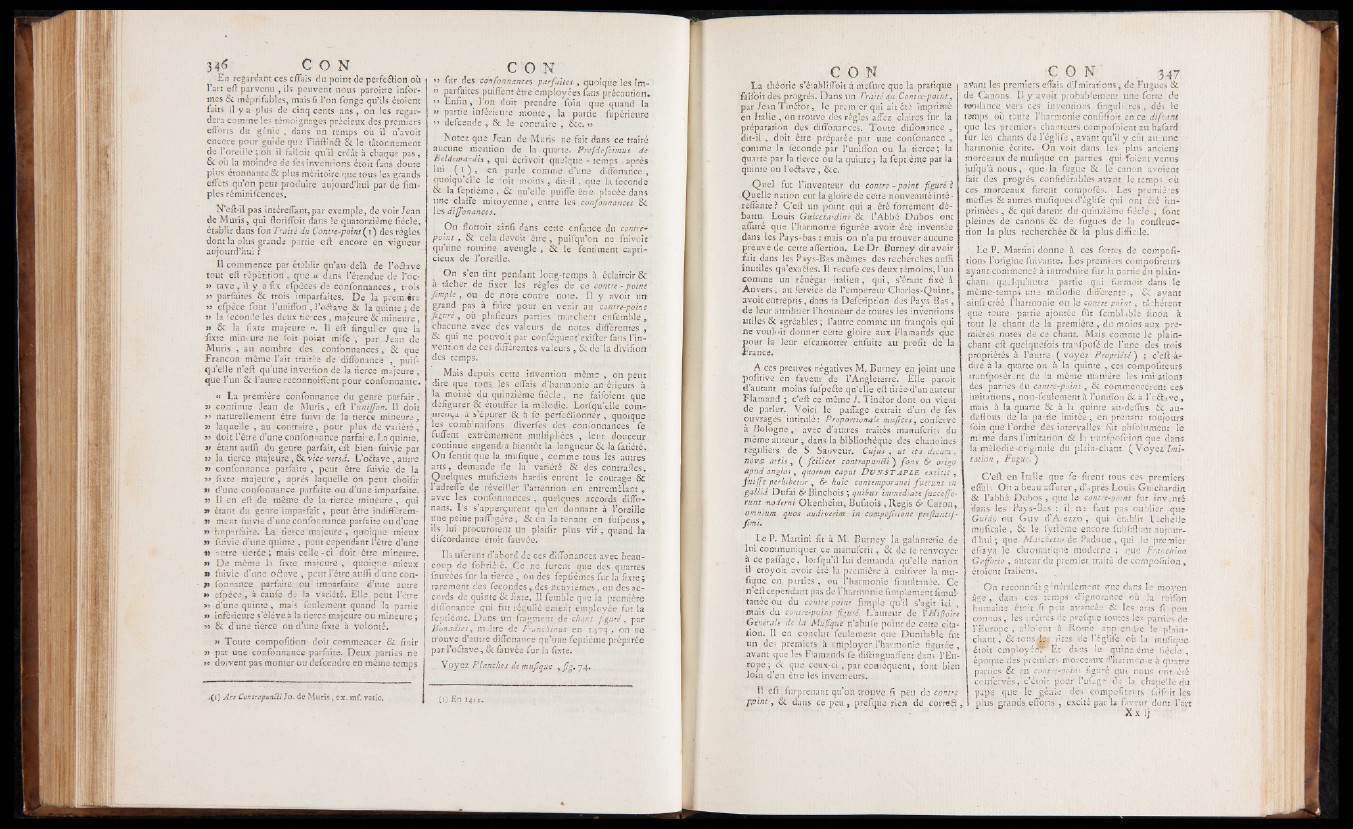
En regardant ces c fiais du point de perfe&îon où
l’art eft parvenu , ils peuvent nous paroître informes
& méprifables, mais fi l’on fonge qu’ils étoient
faits il y a plus de cinq cents ans, on les regardera
comme les témoignages précieux des premiers
eftorts du génie , dans un temps où il n’avôit
encore pour guide que l’inftinft & le tâtonnement
de l’oreille; on il falloit qu’il créât à chaque pas,
& où la moindre de fes inventions étoit fans doute
plus étonnante 8c plus méritoire que tous les grands
effets qu’on peut produire aujourd’hui par de fim-
ples réminifcences.
N’eft-il pas. intérefiant, par exemple, de voir Jean
de Mûris, qui floriflbit dans le quatorzième fiècle,
établir dans fon Traité du Contre-point ( i ) des règles
dont la plus grande partie eft encore en vigueur
aujourd’hui ?
Il commence par établir qu’au delà de l’oâave
tout eft répétition , que « dans l’étendue de l’oc-
j> tave , il y a fix efpèces de confonnances , trois
>5 parfaites & trois imparfaites. De la première
« efpèce font l’umflbn ,-Toâaye & la quinte ; de
la fécondé les deux tierces , majeure & mineure,
» & la fixte majeure ». Il eft fingulier que la
fixte mineure ne foit poiat mife par Jean de
Mûris , au nombre des confonnances , & que
Francon même l’ait traitée de diflonance , puif-
qu’elle n’eft qu’une invetfion dè la tierce majeure ,
que l’un & l’autre reconnoiffent pour confonnante.
« La première confonnance du genre- parfait,
ï> continue Jean de Mûris, eft Vunijfon. Il doit
s? naturellement être fuivi de la tierce mineure
yf laquelle , au contraire, pour plus de variété,
33 doit l’être d’une confonnance parfaite. La quinte,
v étant suffi du genre parfait, eft bien-fuivie par
33 la tierce majeure , & vice versa. L’o â a v e , autre
»> confonnance parfaite , peut être fuivie de la
33 fixte majeure, après laquelle on peut choifir
» d’une confonnance parfaite ou d’une imparfaite,
s? IL en eft de même de la tierce mineure , qui
» étant du genre imparfait, peut être indifterem-
sy ment fuivie d’une confonnance parfaite ou d’une
j> imparfaite. La tierce majeure , quoique mieux
33 fuivie d’une quinte , peut cependant l’être d’une
33 autre tierce; mais c e lle -c i doit être mineure.
3> De même l-i fixte majeure , quoique mieux
» fuivie d’une ofiave , peut l’être auffi d'une con-
73 fonnance parfaite ou imparfaite d’une autre
»3 efpèce , à caufe de la variété. Elle peut l’être
» d’une quinte , mais feulement quand la partie
33 inférieure s’élève à la tierce majeure ou mineure ;
>3 & d une tierce ou d’une fixte à volonté.
» Toute compofition doit commencer & finir
33 par une confonnance parfaite. Deux parties ne
3*3 doivent pas monter ou defeendre en même-temps
4P) Ats Contrapuncli Jo. de Mûris, ex. mf. varie.
C O N
>3 fur des confonnances parfaites , quoique les îm-
” parfaites puiflent être employées fans précaution*
»J Enfin, l ’on doit prendre foin que quand la
3> partie inférieure monte, la partie fupérieure
33 defçende , & le contraire | &c. »
Notez que Jean de Mûris ne fait dans ce traité
aucune mention de la quarte. Profdofcirnus de .
Beldemardis, qui écri voit quelque - temps . après
lui ( ï ) , en parle comme d’une diflonance,
quoiqu’elle le .»oit moins , dit-il, que la fécondé
& la feptième , & qu’elle puifle être placée dans
une dalle mitoyenne, entre les confonnances 8c
les dijfonances.
On flottoit ainfi dans cette enfance du contre-
point, & cela devok être, puifqu’on ne fui.voit
qu’une routine aveugle , & le fentiment capricieux
de l ’oreille.
On s’en tint pendant long-temps à éclaircir &
à- tâcher de fixer les règles de ce contre - point
fimple, ou de note contre note. Il y avoit un
grand pas à faire pour en venir au contre-point
figuré , où plufieurs parties marchent enfemble,
chacune avec des valeurs de notes différentes ,
& qui ne pouvoir par conféqüenf exifter fansTin-
vention de ces différentes-valeurs , 8c de la diyifion
des temps.
Mais depuis cette invention même , on peut
dire que tons, les effais d’harmonie antérieurs à
la moitié du quinzième fiècle, ne faifoient que
défigurer & étouffer la mélodie. Lorfqu’elle com-
anença à s’épurer & à fe perfectionner , quoique
les comb'naifons diverfes des confonnances fe
fuffent extrêmement multipliées , leur douceur
continué engendra bientôt la langueur 8c là fatiété.
On fentit que la mufique, comme tous les autres
arts,. demande de la variété & des contrariés.
Quelques muficiens hardis eurent le courage &
l’adrefle de réveiller l’attention en entremêlant ,
avec les confonnances , quelques accords diflb-
nans. I's s’apperçurent qu’en donnant à l’oreille
une peine paflagère, & en la tenant en g fufpens ,
Us lui procuroient un plaifir plus v i f , quand la
difeordahee étoit fauvée.
Ils uferent d’abord de ces diflohances avec beaucoup
de fobriété. Ce. ne furent que des quartes
fauvées fur la tierce, ou des feptièmes fur la fixte;
rarement des fécondés, des neuvièmes, ou des accords
de quinte & fixte. Il fernble que la première
diflonance qui fut réguliè ement employée fut la
feptième. Dans un fragment de chant f ig u r é par
Bonadies, maître de Franchi nus en 1473 , on ne
trouve d’autre diflonance qu’une feptième préparée
par l’o&ave, & fauvée fur la fixte.
. Voyez Planches de mufique y.fig, 74.
(0 En 1412.
C O N
La théorie s’étabîiffoit à mefure qüe la pratique
faifoit des progrès. Dans un Traité du Contre-point,
par Jean Tin&or, le prenrer qui ait été imprimé
en Italie , on trouve des règles a fiez claires fur la
préparation des diflonances. Toute diflonance ,
dit-il , doit être préparée par une confonance ,
comme la fécondé par l’uniffon ou la tierce; la'
quarte par la tierce ou la quinte; la feptième par la
quinte ou l ’oâave , &c.
Quel fut l’inventeur du contre - point figuré ?
Quelle nation eut la gloire de cette nouveauté inté -
reliante? C ’eft un point qui a été fortement débattu.
Louis Guicciardini 8c l’Abbé Dubos ont
afîùré- que l’harmonie figurée avoit été. inventée
dans les Pays-bas : mais on n’a pu trouver aucune
préuve de cette affertion. Le Dr. Burney dit avoir
fait dans les Pays-Bas mêmes des recherches auffi
inutiles qu’exaâes. Il réeufe ces deux témoins, l’un
comme un rénégar italien, qui, s’étant fixé à
Anvers , au fervice de l’empereur Çharles-Quint,
avoit entrepris, dans fa Defcription des Pays Bas ,
de leur attribuer l’honneur de toutes les inventions
utiles & agréables ; l’autre comme un françois qui
ne youloit donner cette gloire aux Flamands que
pour la leur efeamotter enfuite au profit de la
France.
A ces preuves négatives M. Burney en joint une
Jjofitive en faveur de l’Angleterre. Elle parcît
d’autant moins fufpe&e qu’elle eft tirée-d’un auteur
Flamand ; c’eft ce même J. Tinctor dont on vient
de parler. Voici le paffage extrait d’un de fes
Ouvrages intitulé : P roportionale mu f ie e s , confervé
à Bologne, avec d’autres traités manuferits du
même auteur , dans la bibliothèque des chanoines :
réguliers de S Sauveur. Cujus , ut ita dicarn,
novae artis , ( fcüicet contrapunéîi ) fions & origo
apud ahglos , quorum caput D ü N S T A P LE ex titit,
fu i (fie perhibetur , & huic contemporanei fuerunt in-
galTid Dufai 6* Binchois ; qui b us immédiate fuccejfe-
runt moderni Okenheim, Bufnois , Regis & Caron,,
omnium quos audiverim in compofiiione prejlantij-
fimi.
Le P. Martini fit à M. Burney la galanterie de
lui communiquer ce manuferit, & de le renvoyer
à ce paffage, lorfqu’il lui demanda qu’elle nation
il croyoit avoir été la première à cultiver la mn-
fique en, parties , ou l’harmonie fimultanée. Ce
n’eft cependant pas de l'harmonie Amplement fitnul-
tanée ou du contre point fimple qu’il s’agit ici ,
mais du contre-point figuré. L’auteur de l'Hifloire
Générait de la Mufique n’abufe point de cette citation.
Il en conclut feulement que Dunftable fut
un des premiers à' employer l’harmonie figurée ,
avant que les Flamands fe diftinguaffenr dam l’Europe
; & que ceux-ci, par conléquent, font bien
avant les premiers effais ‘d?Imitations, de Fugues &
de Canons. Il y avoit probablement une forte de
tendance vers ces inventions finguliéres , dès le
temps où toute l’harmonie confiftoit en ce difeant
que les premiers chanteurs compofoient au hafard
fur les chants de l’églife , avant qu’il y eût aucune
harmonie écrite. On voit dans les plus anciens
morceaux de mufique en parties qui îfoiënt venus
jufqu’à nous , que la fugue & le canon avojent
fait des progrès confidérables avant le temps où
ces morceaux furent compofés. Les premiè es
rneffes & autres mufiques d’églife qui ont été imprimées
loin d’en être les inventeurs.
Il eft furprenant qu’on trouve fi peu de contre-
ppint y 8c dans ce p eu, prefque rien de oorreâ:, I
, 8c qui datent du quinzième fiècle , font
pleines de canons & de fugues de la conftruc-
tion la plus recherchée & la plus difficile.
Le P. Martini donne à ces fortes de compofi*
tions l’origine fuivante. Les premiers compofiteurs
ayant commencé à introduire fur la partie du plain-
chan; quel qu’autre partie qui formoït dans le
même-temps une mélodie différente , & - ayant
ainficré.é l’harmonie ou le contre point, tâchèrent
que toute partie ajoutée fût femblable finon à
tout le chant de la première , du moins aux premières
notes de ce chant. Mais comme le plain-
chant eft quelquefois tranipefé de l’une des trois
propriétés à l’autre (v o y e z Propriété') ; c’eft:-àr
dire à la quarte ou à la quinte , ces compofiteurs
tranfposèrcnt de la même manière les imi ation's
des parties du contre-point , & commencèrent ces
imitations, non-feulement à l’uniffon & à i’c&ave ,
mais à la quarte & à la quinte au-deflus & au-
déflous de la patrie imitée, en prenant toujours
foin que l’ordre des intervalles fût abfolument lé
mime dans l’imitation 6c la t’anfpofirion que clans
la mélodie-originale du plain-chant. ( V o y e z Imitation
, Fugue. )
C ’eft en Italie que fe firent tous ces premiers-
effa'u On a beau affurer , d’après Louis Guichardin
& l’abbé Dubos , que le contre-point fut inventé
"dans les Pays-Bas : il ne faut pas oublier que
Guido ou G uy d’A ezzo , qui établit l'échelle
muficale , & le fyftème encore fubfiftant aujourd'hui;
que Marchetto de Padoue , qui le premier
efifaya le chromatique moderne ; que Franchino
Gafforio , auteur du premier traité de compofition,
étoient Italiens.
On reconnoit généralement que dans la moyen
âge , dans .ces temps cî’ignorance' où la raifon
humaine é'tcit fi peu avancée 8c les arts fi peu
connus, les urètres de prefque toutes lés parties de
l’Europe , aUô'ént à Rome app endre le plain-
chant , & tousday rites de l’églife où la mufique-
étoit employé^ 1 Et dans le quinzième fiècle ,
■ époque des premiers morceaux d’harmon-e à quatre
parties & en contre-point figuré qui nous ont été
confervés, c’étoit pour l’ufuge de la chapelle du
pape, que le génie des compofiteurs fai fi it les
plus grands efforts , excité par la faveur dont l’art
X x i j