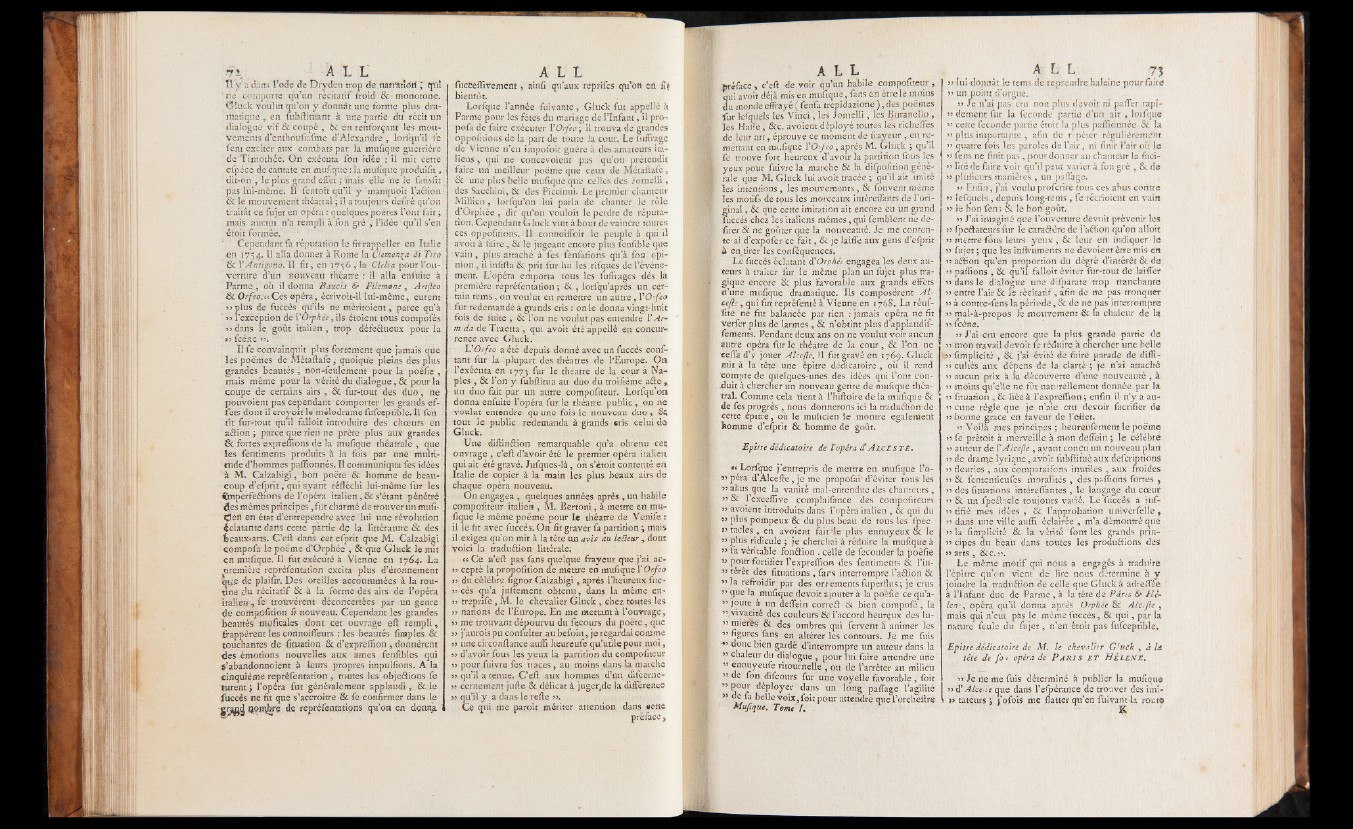
?! ALI
ï l y a dans l’ode de Dryden trop de natfàtïdrf j qtiî
lié comporte qu’un récitatif froid & monotone.
Gluck voulut qu’on y donnât une forme plus dramatique
, en fiibftituant à une partie du récit un
dialogue v if & coupé , 6c en renforçant les mouvements
d’enthoufiafme d’A lexandre, lorfqu’il fe
fent exciter aux combats par la mufique guerrière
de Timothée. On exécuta fon idée : il mit cette
efpèce de cantate en mufique :1a mufique produifit,
dit-on , le plus grand effet ;; mais elle ne le fatisflt
pas lui-même. 11 fentoit qu’il y manquoit f’aéîion
8c le mouvement théâtral ; îl a toujours defiré qu’on
traitât ce fujet en opéra : quelques poètes l’ont fait ;
mais aucun n’a rempli à fon gré , l’idée qu’il s’en
étoit formée.
Cependant fa réputation le fit rappeller en Italie
en 1754. U alla donner à Rome la demanda di Tito
Si Y Antigono. Il fit, en 1756 /la CUlia pour l’ouverture
d’un nouveau théâtre : il alla eniuite à
Parme, où il donna Baucïs & Fïlemone , Arifïeo
SiOrfeo.c« Ces opéra, écrivoit-il lui-même, eurent
33 plus de fuccès qu’il* ne méritoient, parce qu’à
l ’exception deY Orphée, ils étoient tous compofés
>3 dans le goût italien, trop défeétueux pour la
*3 fcène 33. f
Il fe convainquit plus fortement que jamais que
les poèmes dè Métaftafequoiqu'e pleins des plus
grandes beautés , non-feulement pour la poéfie ,
mais même pour la vérité du dialogue, & pour la
coupe de certains airs , & fur-tout des d uo, ne
pouvoient pas cependant comporter les grands effets
dont il croyoif le mélodrame fufceptible. 11 fen-
tit fur-tout qu’il falloit introduire des choeurs en
aétion ; parce que rien ne prête plus aux grandes
& fortes exprefîions de la mufique théâtrale , que
les fentiments produits à la fois par une multi-:
tilde d’hommes paffionnés. Il communiqua fes idées
à M. Calzabigi, bon poète & homme de beaucoup
d’efprit, qui ayant réfléchi lui-même fur les
Cmperfeâions de l’opéra italien, & s’étant pénétré ■
clés mêmes principes, fut charmé de trouver un mufi-
^Çîêfl en état d’entrependre avec lui une révolution
éclatante dans cette parti« de là littérature & des ;
f>eaux»arts. C ’eft dans cet efprit que M. Calzabigi
çompofa le poème d’Orphée , 8c que Gluck le mit
en mufique. 11 fut exécuté à Vienne en 1764. La
première, repréfentation excita plus d’étonnement
qt£.e de plaifir. Des oreilles accoutumées à la routine
du récitatif & à la forme des airs de l ’opéra
italien, fe trouvèrent déconcertées par un genre
de comppfition fi nouveau. Cependant les grandes
beautés muficales dont cet ouvrage eft rempli,
frappèrent les connoiffeurs : les beautés fimples 8c
touchantes de fituation & d’exprefïion , donnèrent
des émotions nouvelles aux âmes fenfibles qui
ç’abandonnoiènt à leurs propres impulfions. A la
cinquième repréfentation , toutes les objeétions fe
turent ; l’opéra fut généralement applaudi, & le
fuccès ne fit que s’accroître & fe confirmer dans le
gr^gçj QOfllkf'e de repréfentafions qu’on en donn^.
A L L
fucCeflîvement, ainfi qu’aux reprifes qu’on eh fij>
bientôt.
Lorfque l’année fu iv an te, G lu ck fut appellé à
Parme pour les fêtes du mariage de l’Infant, il pro-
pofa de faire exécuter YOrfeo ; il trouva de grandes
oppofitions de la part de toute la cour. Le luffrage
de Vienne n’en impofoit guère à des amateurs italiens
, qui ne coneevoient pas qu’on prétendît
faire un meilleur poème que ceux de Métaftafe,
& une plus b elle mufique que celles des J om e ili,
des Sacchini, 8c des Piccinni. Le premier chanteur
M illic o , lorfqu’on lui parla de chanter le rôle
d’Orphée , dit qu’on vouloit le perdre de réputation.
C ependant G lu ck vint à bout de vaincre toutes
ces oppofitions. 11 eonnoiffoit le peuple à qui il
avoit à fa ire , & le jugeant encore plus lenfible que
v a in , plus attaché à fes fenfations qu’à fon opinion
, il infifta & prit fur lui les rifques de l’événement.
L ’opéra emporta tous les fuftrag.es dès la
première repréfentation ; & , lorfqu’après un certain
tem s , on voulut en remettre un au tre , YOrfeo
fut redemandé à grands cris : on le donna vingt-huit
fois de fuite , 8c l’on ne voulut pas entendre l ’ Ar-
in d u de Traetta , qui avoit été appellé en concurrence
avec G lu ck .
L 'Orfeo a été depuis donné avec un fuccès confr
tant fur la plupart des théâtres de l’Europe. O i i
l’exécuta en 1773 fur le théâtre de la cour à Naples
, & l’on y fubftitua au duo du troifième a&e *
un duo fait par un autre compofiteur. Lorfqu’oit
donna enfuite l’opéra fur le théâtre public , on ne
vou lu t entendre q u u n e fois le nouveau d u o , 8$
tout le public redemanda à grands «ris celui de
G lu ck .
Une diftinétion remarquable qu’a obtenu ce*
ouvrage , c ’eft d’avoir été le premier opéra .italien
qui ait été gravé. Jufques-là, oh s’étoit contenté en
Italie de copier à la main les plus beaux airs de
chaque opéra nouveau.
O n engagea , quelques années après , un habile
compofiteur italien , M. B e r to n i, à mettre en mufique
le même poème pour le théâtre de V en ife :
il le fit a vec fuccès. O n fit g raver fa partition ; mais
il exigea qu’on mît à la tête un avis au le fleur , dont
vo ic i la traduétion littérale;
« C e n’eft pas fans quelque fra yeur que j’ai, ac-
»3 cep té la propofition de mettre en mufique YOrfeo
33 du célèbre fignor C a lz a b ig i, après l ’heureux fuc-
33cès qu’a juftement ob ten u, dans la même en-
33 trep r ife , M. le chevalier G lu c k , chez toutes les
33 nations de l ’Europe. En me mettant à l’ouv rag e,
33 me trouvant dépourvu du fecours du p o è te , que
33 j’aurois pu confulter au b efo in , je regardai comme
33 une circonftance aufti heureufe qu’utile pour m o i,
33 d’avoir,fous les y e u x la partition du compofiteur
33 pour fuivre fes traces, au moins dans la marche
33 qu’il a tenue. C ’eft aux hommes d’un difcerne-
33 cernement jufte Si délicat à juger^de la différence
33 qu’il y a dans le refte 33.
C e qui me paroît mériter attention dans «ette
préface *
À L L
préface > c’eft -de voir qu’un habile compofiteur 9
qiii avoit déjà mis en mufique, fans en être le moins
du monde effrayé ( fen'fa trepidazione ) , des poèmes
fur lefquels les Vinci § les Jomeili, les Buranello ,
Tes Haffe, &c. avôient déployé toutes les richeftes
de leur art, éprouve ce moment de frayeur , en remettant
en mufique YOrfeo, après M. Gluck ; qu’il
fe trouve fort heureux d’avoir la partition fous les
yeux pour fuivre la marche 8c la difpofition générale
que M. Gluck lui avoit tracée ; qu’il ait imité
les intentions, les mouvements -, & fouvent même
les motifs de tous les morceaux mtéreflànts de l’original
, & qîie cette imitation ait encore eu un grand
fuccès chez les italiens mêmes, qui femblent ne de-
firer & ne goûter que la nouveauté. Je me contenterai
d’expofer ce fait, 8c je laiffe aux gens d’efprit
-à en tirër les conféquences.
Le fuccès éclatant d’Orphée engagea les deux auteurs
à traiter fur le même plan un fujet plus tragique
encore 8c plus favorable aux grands effets
d’une mufique dramatique. Ils composèrent Al-
cejle, qui fut reprèfenté à Vienne en 1768. La réuf-
'fite nè fut balancée par rien : jamais opéra ne fit
verfer plus de larmes , & n’obtint plus d’applaudif-
fements. Pendant deux ans on ne voulut voir aucun
antre opéra fur le théâtre de la cour, Si l ’on ne
eeflà d’ y jouer Alcefle. 11 fut gravé èn 1769. Gluck
mit à la tête une èpître dédicatoire , où il rend
compte de quelques-unes des idées qui l’ont con-
-duit à chercher un nouveau genre de mufique théâtral.
Comme cela tient à l’hiftoire de la mufique Si
de fes progrès , nous donnerons ici la traduétiôn de
cette épitre, où le muficien fe montre egalement
komme d’efprit & homme de goût.
E p itre dédicatoire de l'opéra c ?A ï c è s t ê .
*« Lorfque j ’entrepris de mettre en mufique l’ô-
■»» pera d’Àlcefte, je me propôfar d’éviter tous les
■ 33 abus que la vanité mal-entendüe des chanteurs ,
3i 8i l’excefiive complaifanCe des Compofitelirs
>3 avoient introduits dans l’opéra italien , oc qui du
■ » plus pompeux 6i du plus beau de tous les fpec
93 tacles , en avoient faittie plus ennuyeux Si le
33 plus ridicule ; je cherchai à réduire la mufique à
33 fa véritable fonction , celle de féconder la poéfie
33 pour fortifier l’expreffiom des fentiments 8c l’in-
33 têrêt des fituations , far*s interrompre l’a&ion 8c
■>3 la refroidir par des errements fuperfltiS ; je crus
” que la mufique devoit ajouter à la poéfie ce qu’a-
33 joute à un deffein correâ & bien compofé, la
’ ’ .vivacité des couleurs 8ç l’accord heurçux des lu-
33 mieres 8c des ombres qui fervent a animer les
” figures fans en altérer les contours. Je me fuis
K l ^’interrompre lin auteur dans la
” chaleur du dialogue , pour lui faire attendre une
” ennuyeufe ritournelle , ou de l’arrêter au milieu
>3 de fon difeours fur une voyelle favorable , foit
3» pour déployer dans un long paffage l’agilité
» de fa belle voix, foit pour attendre que l’orcheftre
Mufique. Tome 1,
A L L 73
’’ lui donnât le tems de reprendre haleine pour faire
33 un point d’orgue.
33 Je n’ai pas cru non plus devoir ni paffer rapi-
»3 dement fur la fécondé partie d’un air , lorfque
33 cette fécondé partie étoit la plus paftionnée S i la
>3 plus importante -, afin de répéter régulièrement
33 quatre fois le s paroles de l’air , ni finir l’air ou le
»3 fens ne finit pas , pour donner au chanteur la faci-
33 lité de faire voir qu’ il peut varier à fon gré , 8 c de
»J plufieurs manières , un paffage.
3J Enfin, j’ ai voulu proferire tous ces abus contre
33 le fq u e ls , depuis long-tems , fe récrioient en vain
J» le bon fens 8 c le bon-goût.
33 J’ai imaginé que l ’ouverture dévoit prévenir les
» fpeétateurs fur le caractère de l’aélion qu’on alloit
»3 mettre fous leurs y e u x , 8c leur efl indiquer le
»3 fujet ; que les inftruments ne dévoient être mis ert
33 aétion qu’en proportion du degré d’intérêt 8c de
33 paflions , 8 c qu’il falloit éviter fiir^tout de laiffef
33 dans le dialogue une difparate trop tranchante
33 entre l ’air 8c le réc ita tif, afin de ne pas tronquer
33 à contre-fens la période, 8c de nê pas interrompre
>3 maNà-propos le mouvement S i là chaleur de la
>3 fcène.
33 J’ai crû encore que la plus grande partie de
* 33 mon travail de voit fe réduire à chercher une belle
S?3 fimplicité , 8c j’ai évité de faire parade de diffi-
■ 33 cultéS aux dépens de la clarté ; je n’ai attaché
33 aucun prix à la découverte d’une nouveauté , à
33 moins qu’çlle ne fût nati-rellertlent donnée par la
33 fituation , S i liée à l’expreflion ; enfin il n’y a au-
>3 cime règle que je n’aie cru devoir facrifier de
33 bonne grâce en faveur de l’éffet.
33 V o ilà mes principes ; hëureufement le poème
33 fe prêtoit à merveille à mon deffein ; le célèbre
>3 auteur de Y Alcefle , ay ant conéu un nouveau p lan
33 de drame ly r iq u e , avoit fubftifüéaux deferiptions
33 fleuries , aux eomparaifons inutiles , aux froides
JJ 8c fententieufes moralités , des paflions fortes ,
>3 des fituations intèreffantes , le langage dii coeur
’ » 8c un fpe&ac ie toujours Varié. L e fiiccés a ;uf-
33 tifié mes idées t Si l’approbation urtiverfelle ^
33 dans une v ille àufii éclairée , m’a démontré que
>3 la fimplicité 8 c la vérité font les grands prin-
33 cipes du beaii dans toutes les produftlons des
»3 arts , 8cc. 3;.
L e même m o tif qui nous a engagés à traduire
l’épitre qu’on vient de lire nous détermine à y
joindre la traduction de celle que G liick à âdrëfféè
à l’infant duc de Parme , à la tête de P a r is & He~
l e n t opéra qu’il donna après Orphée S i A Ici fie ,
mais qui n’eut pàs le même fu c c è s , 8 c q u i , par la
nature feule du fu je t , n’en étoit pas fufceptible.
E p itr e dédicatoire de M . le chevalier G ’u c k , à la-
têt e de f o i opéra de P a r i s £ f H e l e n è .
3J Je ne me fuis déterminé à publier la mufique
>3 d’ AIcede que dans l’efpérance de trouver des imi-
» tateurs ; jo fo is me flatter qu’en fuivant la route