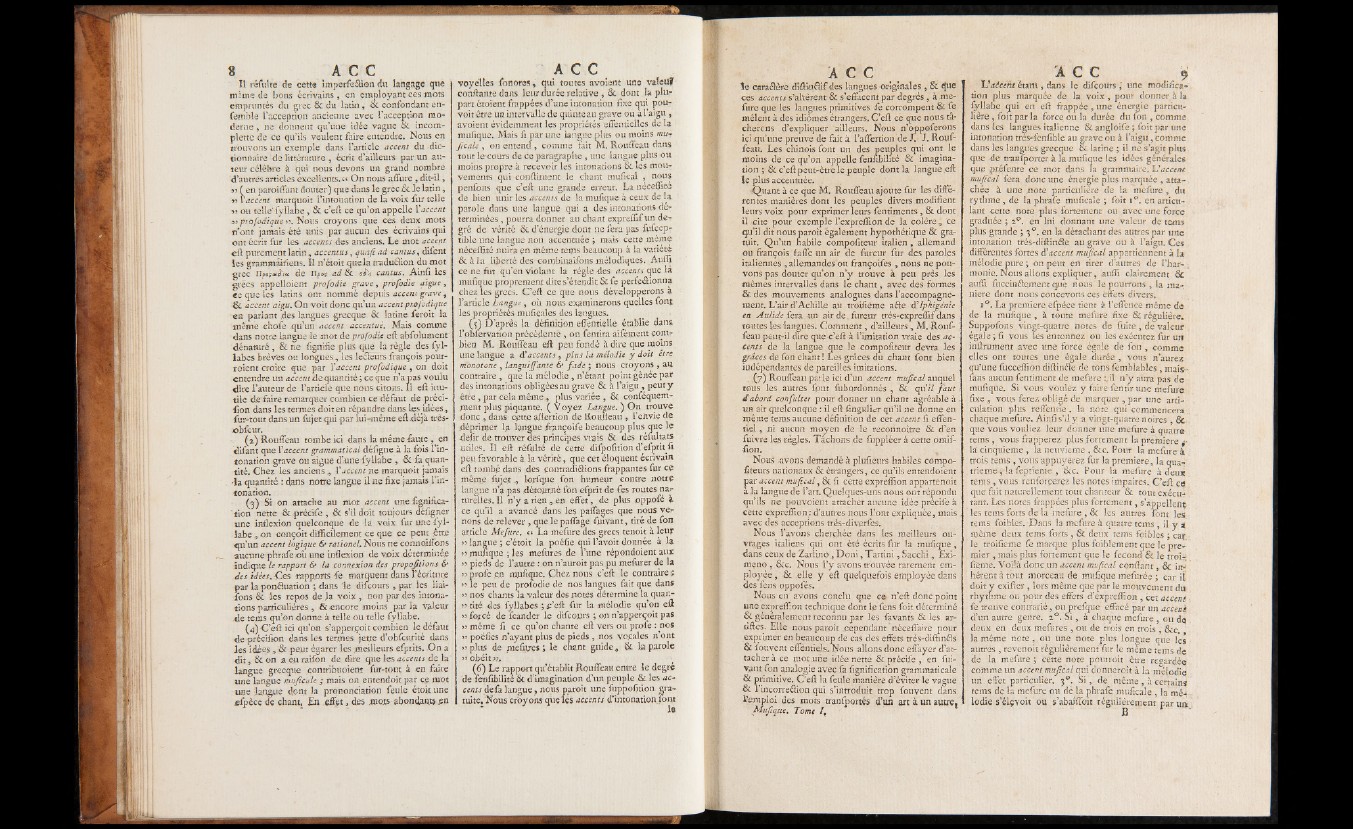
8 A C C
Il réfulte de cette imperfe&ion du langage que
mime de bons écrivains , en employant ces mots
empruntés du grec & du latin, & confondant en-
feanble l’acception ancienne avec l ’acception moderne,
ne donnent qu’une idée vague &. incom-
plette de ce qu’ils veulent faire entendre. Nous en
trouvons un exemple dans l’article accent du dictionnaire
de littérature , écrit d’ailleurs par un auteur
célèbre à qui nous devons un grand nombre
d’autres articles excellents. c< On nous a dure, dit-il,
53 ( en parodiant douter) que dans le grec & le latin,
w Y accent marquoit l’intonation de la voix fur telle
53 ou telle' fyllabe , & c’eft ce qu’on appelle Y accent
53 ptofadique »3. Nous croyons que ces deux mots
n’ont jamais été unis par aucun des écrivains qui ;
©rit écrit fur les accents .des anciens. Le mot accent
eft purement latin, accentus, quafi ad c an tus, difent
les grammairiens. Il n’étoit quela tradu&ion du mot
grec nposaà'ix de np»? ad&i. oh cantus. Ainfi les
grées appelloient profodie grave, profodie aigue,
ee que les latins ont nommé depuis accent grave,
& accent aigu. On voit donc qu’un accent pmf odique
en pariant des langues grecque & latine feroit la
même ehofe qu’un accent accentué. Mais comme
dans notre langue le mot de profodie eft abfolument
dénaturé , & ne fignifie plus que la règle des fyl-
labes brèves ou longues , les le&eurs françois pour-
roient croire que par Y accent profodique , on doit
entendre un accent de quantité ; ce que n’a pas voulu
dire l’auteur de l’article que nous citons. Il eft inutile
de faire remarquer combien ce défaut de précision
dans les termes doit en répandre dans les idées.,
fur-tout dans un fùj et qui par lui-même eft déjà très-
ob&ur.
(2.) Roufléau tombe ici dans la même -faute , en
difant que Yaccent grammatical défigne .à la fois l’intonation
grave ou aigue d’une fyllabe., & fa quantité.
Chez les anciens , l'accent ne marquoit jamais
-la quantité. : dans notre langue il ne fixe jamais l’intonation.
(3) Si on attache au mot accent une lignification
nette & précife, & s’il doit toujours défigner
une inflexion quelconque de la voix fur une fy llabe
., on conçoit difficilement ce que ce peut être
qu’un accent logique 6* rationelNous ne connoifTons
aucune phrafe ou une inflexion de voix déterminée
indique le rapport & la connexion djes proportions &
des idées. Ces rapports fe marquent dans Y écriture
par la ponéhiation ; dans le difeours , par les liai-
fons & les repos de, la voix , non par des intonations
particulières , & encore moins par la valeur
de teins qu’on donne à telle ou telle fyllabe.
(4) C ’eft ici qu’on s’apperçoit combien le défaut
de -précifion dans les termes jette d’obfctirité dans
les idées , =& peut égarer les meilleurs efprits. On a
d it , & on a eu raifon de dire que les accents rie la
langue grecque contribuoient fur-tout à en faire
une langue muficale ; mais on entendoit par ç.e mot
une langue dont la prononciation feule étoit .une
ofpèce de chant, En effet, des mois abondantsj;n
a c c
voyelles fonores, qui toutes avoient une valetîf
confiante dans leur durée relative , & dont la plupart
ètoient frappées d’une intonation fixe qui pou-
voit 'être un intervalle de quinte au grave ou à l’aigu,
avoient évidemment les propriétés eflentielles de la
mufique. Mais fi par une langue plus ou moins mufle
ale , on entend , comme fait M. Rouflfeau dans
tout le cours de ce paragraphe, une langue plus ou
moins propre à recevoir les intonations & les mouvements
qui conftituent le chant miifieal , nous
penfons que c’eft une grande erreur. La néceflite
de bien unir les accents, de la mufique à ceux de la
parole dans une langue qui a des intonations déterminées
, pourra donner au chant expreffif un degré
de vérité & d’énergie dont ne fera pas fofeep-
tïble une langue non accentuée ; mais cette meme
néceffité nuira en même tems beaucoup à la variété
& à la liberté des combinaifons mélodiques. Audi
ce ne fut qu’en violant la règle des accents que la
mufique proprement dite s’étendit & fe perfectionna
chez les grecs. C ’eft ce que nous développerons à
l’article Langue, où nous examinerons quelles font,
les propriétés muficales des langues.
(5) D ’après la définition eflçntielle établie dans
l’pbfervation précédente on fendra aifément combien
M. RoufTeau eft peu fondé à dire que moins
| une langue a d'accents , plus la mélodie y doit etre
| monotone , languijfante & fade ; nous croyons , au
contraire , que la mélodie, n’étant point gênée par
des intonations obligées au grave & à l’aigu , peut y
être, par cela même , plus variée , & conféquem-
ment plus piquante. (V o y e z Langue.} On trouve
donc , dans cett.e aflertion de RoufTeau , l’ehvie de
.déprimer la langue françoife beaucoup plus que le
riefir de trouver des principes vrais & des réfultats
utiles. Il eft réfulté de cette difpofition d’efprit fi
peu favorable à la vérité, que cet éloquent écrivain
eft tombé dans des çontradiâions frappantes fur ce
même fujet , lorfque fon humeur contre notre
langue n’a pas détourné fon efprit de fes routes naturelles.
Il n’y a rien, en effet, de plus oppofé a
ce qu’il a avancé dans les panages que nous venons
de relever, que le paffage fuivant, tiré de fon
article Me Jure, « La mefure des grecs tenoit à leur
33 langue.; c’étoit la poéfie qui l’avoit donnée à la
33 mufique ; les mefures de l’une répondoient aux
33 pieds dp l’autre : on n’auroit pas pu mefurer de la
33 profe .en mufique. Chez nous c’eft le contraire 5
>3 le peu de profodie de nos langues fait que dans
33 nos chants la valeur des notes détermine la quan-
33 tité des fyllabes ; c ’eft fur la mélodie qu’on eft
33 forcé de feander le difeours ; on n’apperçoit pas
»3 même fi ce qu’on chante eft vers ou profe : nos
35 poéfies n’ayant plus de pieds , nos vocales n’ont
33 plus de mefurps ; le enant guide d & la parole
. >3 obéit.3?,
(6) Le rapport qu’établit RoufTeau entre le degré
de fenfibilite & d’imagination d’un peuple & les ac-
cents de fa langue ? nous paroît une fuppofition gratuite,'
Nous croyons que les accents dffntonatioji.lorit
A c c
îe caraélère diftinéfif ries langues originales , & que
ces accents s’altèrent & s’effacent par degrés, àme-
fure que les langues primitives ie corrompent & fe
mêlent à des idiomes étrangers. C ’eft ce que nous tacherons
d’expliquer ailleurs. Nous n’oppoferons
ici .qu’une preuve de fait à l ’affertion de J. J. Rouf-
feau. Les chinois font un des peuples qui ont le
moins de ce qu’on appelle fenfibilité & imagination
; & c’eft peut-êtrele peuple dont la langue eft
le plus accentuée.
-Quant à ce que M. RoufTeau ajoute fur les différentes
manières dont les peuples divers modifient
leurs voix pour exprimer leurs fentiments, & dont
il ’.cite pour exemple Texprefiion de la colère, ce
qu’il dit nous paroît également hypothétique & gratuit.
Qu’iin habile compofiteur italien, allemand
ou françois faffe un air de fureur fur des paroles
italiennes , allemandes ou françoifes , nous ne pou- .
vons pas douter qu’on n’y trouve à peu près les
mêmes intervalles dans le chant, avec des formes
& des mouvements analogues dans l’accompagnement.
L’air d’Achille au troiftéme aâe ri’Iphigénie .
en Aulide fera -un air de. fureur très-expreflif dans :
toutes les langues. Comment, d’ailleurs , M. Rouf- ;
feau peut-il dire que c’eft à l’imitation vraie des accents
de la langue que le compofiteur devra les
grâces de fon chant ! Les grâces du chaut font bien
indépendantes de pareilles imitations.
. (7) RoufTeau parle ici d’un accent mufical auquel
tous les autres font fubordonnés , & qu’i/ faut ■
d’abord conflulter pour donner un chant agréable à .
un air quelconque : il eft fingulier qii’il ne donne en
même tems aucune définition de cet accent fi effen-
tiel., ni aucun moyen de le reconnoître & d’en
fuivre les règles. Tâchons de ûippléer à cette omif-
fion.
Nous avons demandé à plufieurs habiles compo-
fiteurs nationaux & étrangers, ce qu’ils entendoient
par accent mufle a l, & fi cette expreflion appartenoit
à la langue de l’art. Quelques-uns nous ont répondu
qu’ils ne pouvoient attacher aucune idée précife à
cette expreflion : d’autres nous l’ont expliquée, mais
avec des acceptions très-diverfes.
Nous l’avons cherchée dans les meilleurs ouvrages
italiens qui ont été écrits fur la mufique,
dans ceux de Zarlino, D o n i, Tartini, Sacchi, £xi-
meno , .&c. Nous l’y avons trouvée rarement employée
, •& .elle y eft quelquefois employée dans
ries fens oppofés.
Nous en avons conclu que ce n’eft donc point
une expreflion technique dont le fens foit déterminé
& généralement reconnu par les favants & les ar-
tiftes. Elle nous paroît .cependant néceffaire pour
exprimer en beaucoup de cas des effets très-diftinéîs
& louvent eflêntiels., Nous allons donc effayer d’attacher
à ce uiomme idée nette & précife , en fui-
Vjant fon analogie avec fa lignification grammaticale
& primitive. C ’efl la feule manière d’éviter le vague
& l’incorreélion qui s’introduit trop fouvent dans
Remploi des mots tranfportés d’un art à un autre.
Mufique. Tome I,
A C C 9
L 'décent étant, dans le difeours ,' une modification
plus marquée de la voix , pour donner à la
fyllabe qui en eft frappée , une énergie particulière
, foit par la force ou la durée du fon , comme
dans les langues italienne & angloife ; foit par une
intonation très-fenfible au grave ou à l’aigu, comme
dans les langues grecque oc latine ; il ne s’agit plus
que de transporter à la mufique les idées générales
que -préfeiue ce mpt dans la grammaire. Uaccent
mufical fera donc une énergie plus marquée , attachée
à une note particulière de la mefure, du
rythme, de la phrafe muficale ; foit t° . en articulant
cette note plus fortement ou avec une force
graduée ; 20. en lui donnant une valeur de tems
plus grande ; 30. en la détachant des autres par une
intonation très-diftinéle au grave ou à l’aigu. Ces
différentes fortes à?accent mufical appartiennent à la
mélodie pure ; on peut en tirer d’autres de l’harmonie.
Nous allons expliquer, auflî clairement &
aufli fuccinéiement que nous le pourrons , la maniéré
dont nous concevons ces effets divers.
i ° . La première efpèce tient à i’effence même de
de la mufique, à toute mefure fixe & régulière.
Suppofons vingt-quatre notes de fuite , de valeur
égale ; fi vous les entonnez ou les exécutez fur un
infiniment avec une force égale de fo n , comme
elles ont toutes une égale durée , vous n’aurez
qu’une fucceflîon diftinéle de tons femblables , mais -
fans aucun fentiment de mefure il n’y aura pas de
mufique. Si vous voulez y faire fentir une mefure
fixe „ vous ferez obligé de marquer , par une articulation
plus reffentie, la note qui commencera
chaque mefure. Ainfi s’il y a vingt-quatre noires &
que vous vouliez leur donner une mefure à quatre
tems , vous frapperez plus .fortement la première $
là cinquième , la neuvième , &c. Pour la mefure-à
trois tems , vous appuyerez fur la première, la quai
. trie me yla feprie.me , ikc. Four la mefure à deux
tems , vous renforcerez les notes impaires. C ’eft ce
que fait naturellement tout chanteur & tout exécül
tant. Les notes frappées plus fortement, s’appellent
les tems forts de la mefure, & les autres Font les
tems foibles. Dans la mefure à quatre tems , il y à
meme deux tems forts , & deux tems foibles ; car
le troifieme fe marque plus foiblement que le premier
, mais plus fortement que le fécond & le troi?
fiême. Voilà donc.un accent mufical confiant, & ii>‘
hérent à tout morceau de mufique mefurée ; car il
doit y exifter , lors même que par le mouvement du
rhytbme ou pour des effets d’exprefltion , cet accent
fe trouve contrarié, ouprefque effacé par un accent
d’un autre genre. 20. S i , à chaque mefure , ou dq
deux en deux mefures , ou de trois en trois , & c.
la même note, ou une note plus longue que les
autres , revenoit régulièrement fur le même tems de
, de la mefiire ; cette note poùnoit être regardée
comme un accent mufical qui denneroît à la mélodie
un effet particulier. 30. S i , de même , :i certains
tems de la mefure ou de la phrafe muficale , la mé-»
lodie s’élçyoit ou s’abaiflbit régulièrement par uix