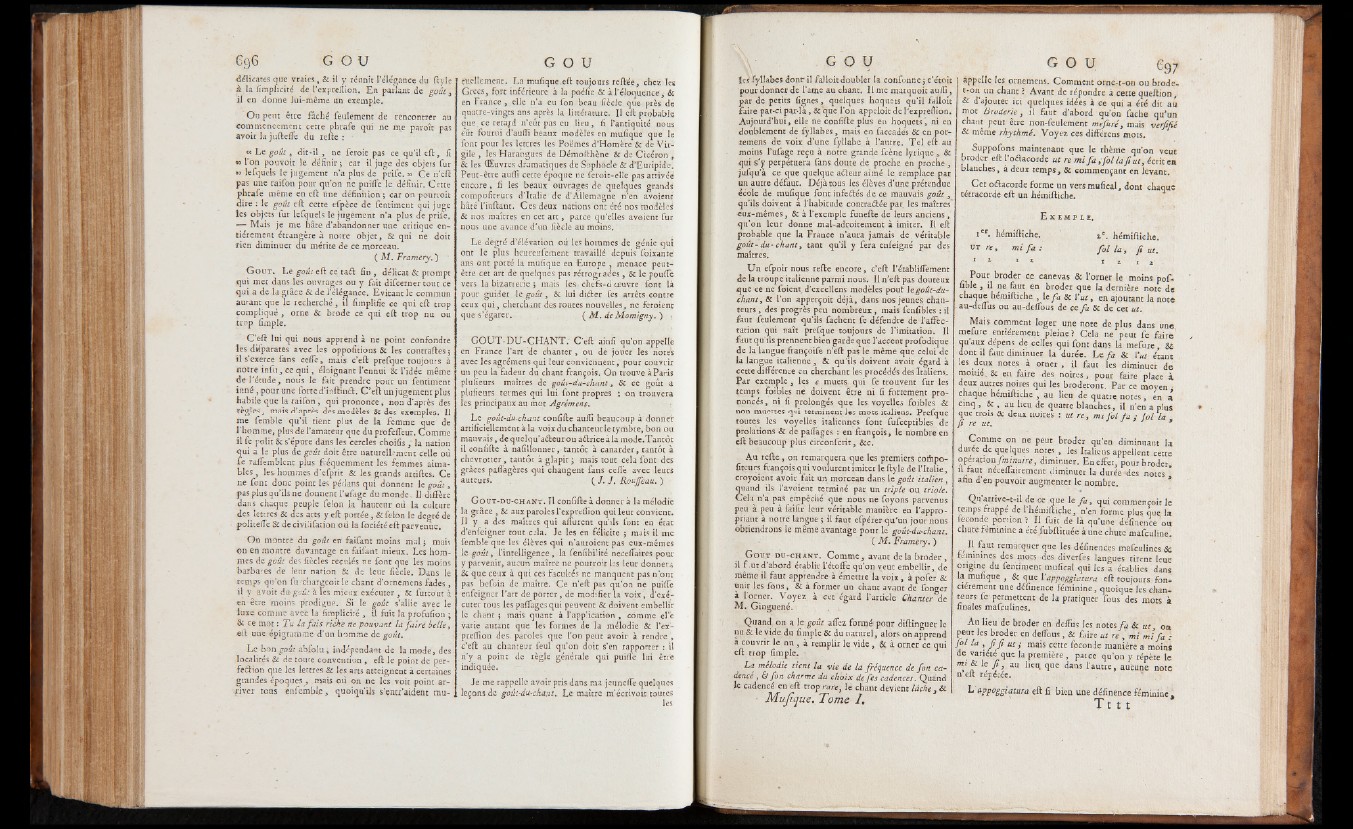
délicates que vraies , & il y réunie l’élégance du ftyle
à la fimplicité de l’exprelfion. En parlant de goût,
il en donne lui-même un exemple.
On peut être fâché feulement de rencontrer au
commencement cette phrafe qui ne me paroît pas
avoir la jufteffe du refte :
« L e goût , d i t - i f , ne feroit pas ce qu’il e f t , fi
n l’on pouvoit le définir j car il juge des objets fur
33 lefqüels le jugement n’ a plus de prife. » C e "n’iÉ
pas une raifon pour qu’on ne puiffe le définir. Cette
phrafe même en eft One définition $ car on pourroit
dire : le goût eft cette efpèce de fentiment qui juge
les objets Lur lefqüels le jugement n’a plus de prife,
— Mais je me hâte d’abandonner une critique entièrement
étrangère à notre ob je t, & qui ne doit
arien diminuer du mérite de ce morceau.
( M. Framery. )
G oût. L e goût eft ce'tatft fin , délicat & prompt
qui met dans les ouvrages ou y fait difeerner tout ce
qui a de la grâce & de l ’élégance. Evitant le commun
autant que le recherché, il Amplifie ce qui eft trop
compliqué , orne & brode ce qui eft trop nu ou
trop fimple.
C ’eft lui qui nous apprend à ne point confondre
les difparates avec les oppofitions & les contraftesj
il s’exerce fans cefie, mais c’eft prefque toujours à
notre in fu , ce q u i, éloignant l’ennui & l’idée même
de l’étude, nous le fait prendre pour un fentiment
in n é , pour une forte d’inftind. C ’eft un jugement plus
babile que la raifon , qui prononce, non d’après des
règles, mais d’après des modèles & des exemples. II
me femble qu’ il tient plus de la femme que de
l'homme, plus de l’amateur que du proféfleur. Comme
il fe polit & s’épure dans les cercles choifîs ; la nation
■ qui a le plus de goût doit être naturellement celle où
le raffemblent plus fréquemment les femmes aimables
| les.hommes d ’efprit & les grands artiftes. C e
ne font donc point les pédans qui donnent le goût,
pas plus qu’ils ne donnent i'ufagc du monde. Il diffère
dans chaque peuple félon la hauteur où la culture
des lettres & des arts y eft portée, & félon le degré de
polite/Te & de civfifation où la fociété eft parvenue.
On montre du goût en faifant moins mal ; mais
•on en montre davantage en faifant mieux. Les hommes
de goût des fiècles reculés ne font que les moins
barbares de leur nation & de leur fiècle. Dans le
temps qu’on furchargeoit le chant d’ornemens fades ,
il y avoit dn-goût à les mieux exécuter, & furtout à
eh être moins prodigue. Si le goût s’allie avec le
luxe comme avec la {implicite , il fuit fa profufion ;
& ce mot : Tu la fais riche ne pouvant la f a i r é belle,
oft une épigramrae d’un homme de goût.
Le bon goût abfolu; indépendant de la mode, des
localités & de toute convention , eft le point de per-
feârion que les lettres & les arts atteignent à certaines
grandes époques , mais où on ne les voit point arriver
tons enfemble, quoiqu’ils s’çntr’aident mutuellement.
L a mufique.eft toujours reftée, chez les.
Grecs, fort inférieure à la poéfie & à l ’éloquence 3 &
en F rance, elle n’a eu fon beau fiècle que- près de
quatre-vingts ans après la littérature. Il eft probable
que. ce retapd n’eût pas eu lieu , fi l’antiquité nous
eût fourni d’aufli beaux modèles en mufique que le
font pour les lettres les Poëmes d’Homère & de V ir gile
, les Harangues de Démofthène & de Cicéron ,
& les OEuvres dramatiques de Sophocle & d’Euripide.
Peut-être auffi cette époque ne feroit-elle pas arrivée
encore, fi les beaux ouvrages de quelques grands
compofiteurs d’Italie de d’Allemagne n’en avoient
hâté l’inftant. Ces deux nations ont été nos modèles
& nos maîtres en cet a r t , parce qu’elles avoient fur
nous une avance d’ un fiècle au moins. '
Le degré d’élévation où les hommes de génie qui
ont le plus heureufement travaillé depuis foixantê
ans ont porté la mufique en Europe , menace peut-
être cet art de quelques pas rétrogrades, & le pouffe
vers la bizarrerie } mais les chefs-doeuvre font là
pour guider...Je goût, & lui diéfer fes arrêts contre
ceux q u i , cherchant des routes nouvelles, ne feroient
que s’égarer. _., ( M . de Momigny. ) ,
G O U T -D U -C H A N T . C ’eft ainii qu’on appelle
en France l ’art de chanter, ou dé jouer les notes
avec les agrémens qui leur conviennent j pour couvrir
un peu la fadeur du chant françois. On trouve à Paris
plufieurs maîtres de goûc-du-ckant, & ce goût a
plufieurs termes qui lui font propres : on trouvera
ies principaux au mot Agrémens.
Le goût-du.-chant confifte auffi beaucoup à donner
artificiellement à la voix du chanteur le tymbre, bon ou
mauvais, de quelqu’aéfeur ou aéfrice à la mode.Tantôt
il confifte à nafillonner, tantôt à canarder, tantôt à
chevrorter, tantôt à glapir 5 mais tout cela font des
grâces paffagères qui changent fans cefie avec leurs
auteurs. . ( J. J. Roujfèau. )
G o u t -du-c h a n t . Il confifte à donner à la mélodie
la grâce , & aux paroles i’expreffion qui leur convient.
Il y a des maîtres qui aflurent qu’ils font en état
d’enfeigner tout cela. Je les en félicite ; mais il me
femble que les élèves qui n’auroient pas eux-mêmes
le goût, l’intelligence, la fenfîbüité neceflaires pour
y parvenir, aucun maître ne pourroit les leur donner*
& que ceux à qui ces faculcés ne manquent pas n ’ont
pas befoin de maître. C e n’eft pas qu’on ne puiffe
enfeigner l’art de porter, de modifier la vo ix, d'exécuter
tous les palPagcs qui peuvent & doivent embellir
le chant ; mais quant à fappücation , comme el'è
varie autant que les formes de la mélodie & l’ex-
preffion des. paroles que l’on peut avoir à rendre ,
c’eft au chanteur feul qu’on doit s’en rapporter : il
n’y a point de règle générale qui puiffe lui être
indiquée.
Je me rappelle avoir pris dans ma jeu ne fie quelques
leçons de goût-du-chant. L e maître m’écrivoit toutes
les
IcsJyîlabes dont* il failoit doubler la confonne ; c ’étoit
pour donner de l’atne au chant. Il me marquoit auffi,
par de petits lignes, quelques hoquets qu’il failoit
faire par-ci par-la, & que l’on appelpic de l'exprefiïon.
Aujourd’hui, elle ne confifte plus en hoquets\ ni en
doublement de fyllabes, mais en faccadés & en por-
remens de voix d’une fyllabe à l’autre. T e l eft au
moins l’ufage reçu à notre grande fcène lyrique , &
<jui s’y perpétuera fans doute de proche en proche ,
jufqu’à ce que quelque aôteur aimé le remplace par
un autre défaut. Déjà tous les élèves d’une prétendue
école de mufique font infeéiés de ce mauvais goût ,
qu’ils doivent a l’habitude contra&ée par les maîtres*
eux-mêmes, & à l’exemple funefte de leurs anciens ,
qu’on leur donne mal-adroitement à imiter. Il eft
probable que la France n’aura jamais de. véritable
goût- du- chant, tant qu’il y fera enfeigné par des
maîtres.
Un efpoir nous refte encore, c’eft l’établiflement
de la troupe italienne parmi nous. Il n’eft pas douteux
que ce ne foient d’excellens modèles pouf Iegoût-du-
thant, & l’on apperçoit déjà, dans nos jeunes chanteurs,
des progrès peu nombreux, mais fenfibles : il
faut feulement qu’ils fâchent fe défendre de l'affectation
qui naît prefque toujours de l’imitation. Il
faut qu'ils prennent bien garde que l’accent profodique
de la langue françôife n’eft pas le même que celui de
la langue italienne , & qu’ils doivent avoir égard à
cette différence en cherchant les procédés des Italiens.
Par exemple , les e muets qui fe trouvent fur les
temps foibles ne doivent être ni fi fortement prononcés
, ni fi prolongés que les voyelles foibles &
non muettes qui terminent ies mots italiens. Prefque
toutes les voyelles italiennes font fufeeptibies de
prolations & de partages : en françois, le nombre en
eft beaucoup plus circonfcrit, &c.
A u refte,.on remarquera que les premiers coihpo-
fiteurs françois qui voulurent imiter le ftyle de l’Italie,
croyoient avoir fait un morceau dans le goût italien,
quand ils l’avoient terminé par un triple ou triole.
C e la n’a pas empêché que nous ne foyons parvenus
peu à peu à faifîr leur véritable manière en l’appropriant
à notre langue 5 il faut efpérer qu’un jour nous
obtiendrons le même avantage pour le goût-du-chant.
( M. Framery. )
G ou.t du- c h a n t . C om m e , avant delà broder,
il f .u t d ’abord établir l’étoffe qii’on veut embellir, de
même il faut apprendre à émettre la voix , à pofer &
unir les fon s , & à former un chant avant de fonder
à 1 orner. V o y e z à cet égard l’article Chanter de
M . Ginguené.
Quand on a le goût aflez formé pour diftinguer le
nu & le Vide du fimple & du naturel, alors oh apprend
à couvrir le nu , à remplir le v id e , & à orner ce qui
eft trop fimple.
La mélodie tient la vie de la fréquence de fon cadence
y & fon charme du choix de fes cadences. Quand
le cadencé en eft trop rare, le chant devient lâche , &
• Mufique. Tome / .
appelle les ornemens. Comment orne-t-on ou brode-
t-on un chant ? Avant de répondre à cette queftion,
& d ajouter ici quelques idées à ce qui a été dit au
mot Broderie, il faut d’abord qu’on fâche qu’ un
chant peut etre non-feulement mefuré, mais verfifié
& même rhythmé. V o y e z ces différens mots.
Suppofons maintenant que le thème qu’on veut
broder eft Todacorde ut re mi fa ; fo l la f u t , écrit en
blanches, à deux temps, & commençant en levant.
C e t odacorde forme un versmufical, dont chaque
tétracorde eft un hémiftiche.
E x e m p l e .
i cc. hémiftiche. i e. hémiftiche.
UT re, mi fa : fo l la , f i ut. 1 z 11 I X I X .
Pour broder ce canevas & l’orner le moins pof-
fible , il ne faut en broder que la dernière note de
chaque hémiftiche , le fa 8c l'ut, en ajoutant la note
-au-deflus ou au-deflous de çcfa & de cet ut.
Mais comment loger une note de plus dans une
mefure entièrement pleine? Ce la 11e peut fe faire'
qu’aux dépens de celles qui font dans la mefure, 8t
dont il faut diminuer la durée. L e fa Sc Y ut étant
les deux notes à orner , il faut les diminuer de
moitié, & eu faire des noires, pour faire place à
deux autres noires qui les broderont. Par ce moyen -
chaque hémiftiche , au lieu de quatre notes, en a
cinq , & , au lieu de quatre blanches, il n’en a plus
que trois & deux noires : ut re, mi fo l fa ; fo l la
f i re ut. 3
Comme on ne peut broder qu’en diminuant la
durée de quelques notes , les Italiens appellent cette
opération fminuirey diminuer. En effet, pour broder,
il faut néceftairemcnt diminuer la durée ’des notes
afin d’en pouvoir augmenter le nombre.
Qu arrive-t-il de ce que le f a , qui commençoit le
temps frappé de l’hémiftiçhe, n’en forme plus que la
fécondé portion? Il fuie de là qu’une définence ou
chute féminine a été fubftituée à une chute mafeuline.
W ^aut remarquer que les définenc.es mafeulines 8c
féminines des mots des diverfes langues tirent leur
origine du fentiment mufîcal qui ies a établies dans
la mufique , & que Yappoggiatura eft toujours foncièrement
une définence féminine, quoique les chanteurs
fe permettent de la pratiquer fous des mots à
finales mafeulines.
A u lieu de broder en defiùs les notes fa & ut, o a
peut les broder en deflous, & faire ut re , mi mi fa :
Jol la , f i f i ut; mais cette fécondé manière a moins
de variété que la première , paice qu’on y répète le
mi & le f i 3 au lieu, que dans l’autre, aucune note
n eft répétée.
L appoggiatura eft fi bien une définence féminine*
T t t t