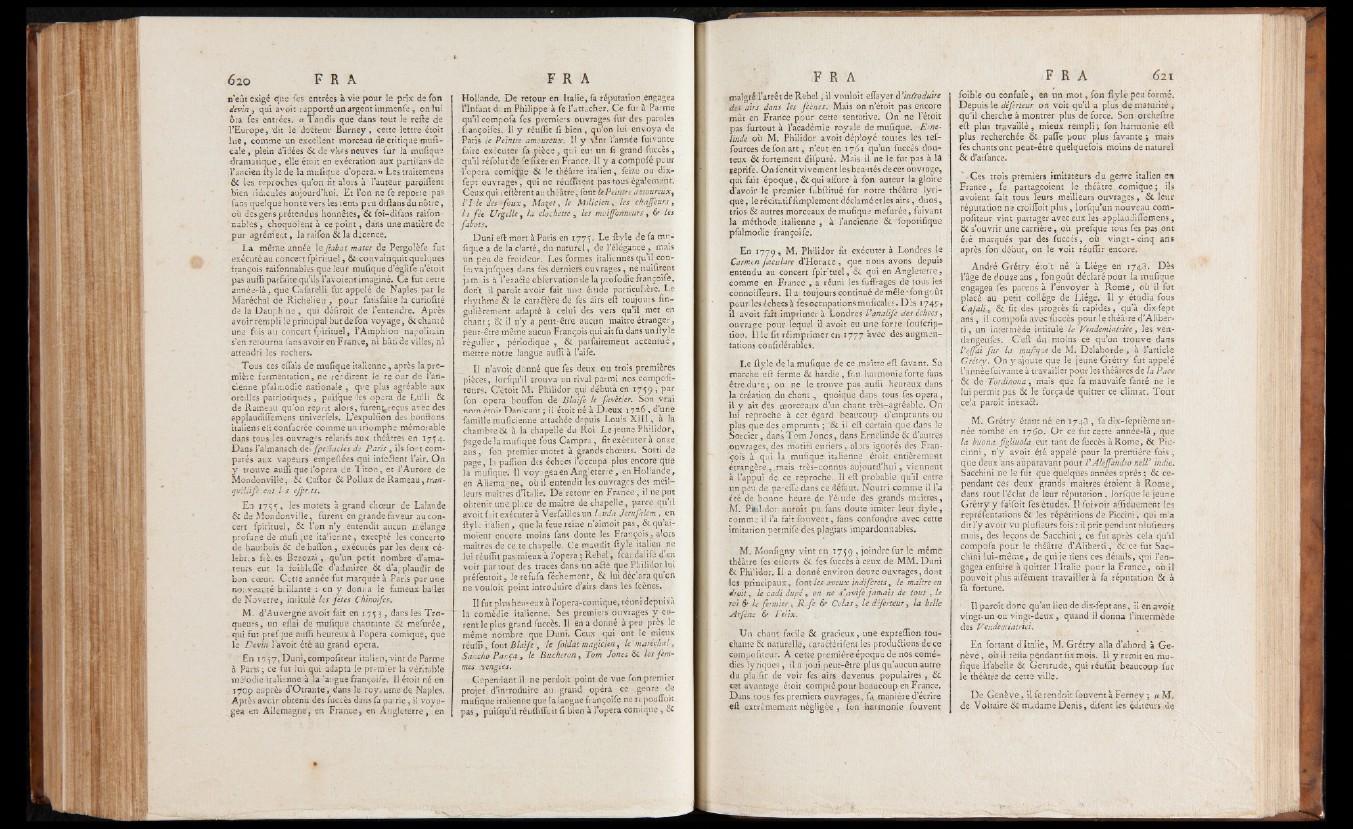
n’eût exigé que fes entrées à vie pour le prix de fon
devinj qui avoit rapporté un argent immenfe , on lui
ôta fes entrées. «Tandis que dans tout le refte de
l’Europe, dit le dolfeur Burney, cette lettre- étoit
lu e , comme un excellent morceau de critique mufi-
caîe , plein d’idées & de vhes neuves fur la mufique
dramatique, elle étoit en exécration aux partifans-de
l’ancien üy le de la mufique d’opera. » Les traitemens
& les reproches qu’on fit alors à l’auteur paroiffent
bien ridicules aujourd’hui. Et l’on ne fe reporte pas
fans quelque honte vers les tems peu diftans du nôtre,
où des gens prétendus honnêtes, & foi-difans raifon-
nables, çhoquoient à ce point, dans une matière de
pur agrément, la raifon & la décence.
La même.année le fin bat mater de Pergolèfe fut
exécuté au concert fpirituel, convainquit quelques
françois raifonnables que leur mufique d’églife n’étoit
pas auffi parfaite qu’ils l’avoient imaginé. Ce fut cette,
année-là, que Cafarelli fut appelé de Naples par le
Maréchal de Richelieu , pour fatisfaire la curiofité
de la Dauphine, qui défiroit de l’entendre. Après
avoir rempli le principal butdefon voyage, & chanté
line fois au concert fpirituel, l’Amphion' napolitain
s’en retourna fans avoir en France, ni bâti de villes, ni
attendri les rochers.
Tous ces effais de mufique italienne, après la première
fermentation, ne rendirent le re our de l’ancienne
pfalmodie nationale , que plus agréable aux
oreilles patriotiques , puifque tes opéra de Lulli &
de Rameau qu’on reprit alors, furen^reçus avec des
applaudiffemens univerfels. L’expulfion des bouffons
italiens eit confacrée comme un triomphe mémorable
dans tous les ouvrages relatifs aux théâtres en 175 4.
Dans l’almanach de«, fpectacles de Paris , ils fort comparés
aux vapeurs empe fiées qui infe&ent l’air. On
y trouve auffi que i’opera de Titon, et l’Aurore de
Mondonville, & Caftor & Pollux de Rameau, tran-
quïUifè. eut L s efpr.ts.
En 1755, les motets à grand choeur de Lalande
& de Mondonville, furent en grande faveur au concert
fpirituel, & l’on n’y entendit aucun mélange
profane de mufique italienne, excepté les concerto
de hautbois & de ballon, exécutés par les deux célèbres
frères Bezozzi , qu’un petit nombre d’amateurs
eut la foibleffe d’admirer & d’applaudir de
bon- coeur. Cette année fut marquée à Paris par une
nouveauté b.illante : en y donna le fameux ballet
de Noverre, intitulé les fêtes Chïnoijes.
M. d’Auvergne avoit fait en 17 53, dans les Tro-
queurs, un eflai de mufique chantante & mefurée,
qui fut.prefqué auffi heureux à l’opéra comique, que
le Devin l’avoit été au grand opéra.
En 1757, Dunî,compofiteur italien, vint de Parme
à Paris ; ce fut lui qui adapta Je premier la véritable
mélodie italienne à la -angue françoife. 11 étoit né en
j 709 auprès d’Otrante , dans le royaume de Naples.
Après avoir obtenu des fuccès dans fa pairie, il voyagea
en Allemagne, en France, en Angleterre, en
Hollande. De retour en Italie, fa réputation engagea
l’Infant dem Philippe à fe l’attacher. Ce fut à Parme
qu’il compofa fes premiers ouvrages fur des paroles
. fiançoifes. Il y réuffit fi bien, qu’on lui envoya de
Paris le Peintre amoureux. Il y vSnt l’année fuivante
..faire exécuter fa.-pièce, qui eut un f i grand fuccès,
qu’il réfolut de/effiler en France. 11 y a compofé pour
l’opéra comitjye & le théâtre ita'ien, feize ou dix-
fept ouvrages, qui ne réuffirent pas tous également.
Ceux qui 1 eftèrent au théâtre, font lePeintre amoureux,
Vide des *faux, Ma^et, le Milicien, les chajfeurs,
la fée Urgelle, la clochette , les moijfonneurs, & les
fabats. x
Duni eft mort à Paris en 1775. Le ftyle de fa mr-
fique a de la clarté, du naturel, de l’élégance , mais
un peu de froideur. Les formes italiennes qu’il confier
va jufques dans fes derniers ouvrages, nenuifirent
jam.-.is à l’exaéte cbfervation de la profodie françoife,
dont il paroît avoir fait une eiiide particulière. Le
rhythme & le cara&ère de fes airs eft toujours fin-
gulièrement adapté à celui des vers qu’il met en
chant; & il n’y a peut-être aucun maître étranger,
peut-être même aucun François qui ait fu dans unftyle
régulier , périodique , .&. parfaitement accentué,
mettre notre langue âuftî à l’aife.
Il n’avoit donné que fes deux ou trois premières
pièces, lorfqu’il trouva un rival parmi nos compofi-
teurs. C’étoit M. Philidor qui débuta en 1759 ; par
fon opéra bouffon de Blaife le fav'etier. Son vr.ai
nom étoit Danicant ; il étoit né à Dreux 1726, d’une
famille muficienne attachée depuis Louis X I I I , à la
chambre & à la chapelle du Roi Le jeune Philidor,
page de la mufique fous Campra , fit exécuter à onze’
ans, fon premier motet à grands choeurs. Sorti de
page, la paffion des échecs l’occupa plus encore que
la mufique. Il voyngeaen Angleterre , en Hollande,
en Allemagne, où il entendit les ouvrages des meilleurs
maîtres d’Italie. De retour en France , il ne put
obtenir une place de maître de chapelle , parce qu’il
avoit fait exécuter à VerfailJes un Lvda Jerufalem , en
ftyle irai!en , que la feue reine n’aimoit pas , ôtqu’ai-
moiëiit encore moins fans doute les François, alors
maîtres de ce:te chapelle. Ce maudit ftyle italien ^ne
lui réuffit pas mieux à l’opera ; Rebel, feandalifé d’en
voir partout des traces dans un allé que Philidor lui
préfentoit, lerefufa féchement, & lui déclara qu’en
ne vouloit point introduire d’airs dans les fcènes.
Il fut plus heureux à l’opera-comique, réuni depuis»
la comédie italienne. Ses premiers ouvrages y eurent
le plus grand fuccès. Il en a donné à peu près le
même nombre que Duni. Ceux qui ont le mieux
réuffi, font Blaife , le foldat magicien, le "maréchal -,
Sancho Par, ça , le Bûcheron, Torn Jones & les femmes
.vengées.
. Cependant il ne perdoit point de vue Ton premier
projet, d’introduire au grand opéra ce genre de
mufique italienne que la 'langue françoife ne rc pouffoit
pas, puifqu’il réuffiffc.it fi bien à l’opéra comique , &
malgré l’arrêt de Rebel, il vouloit eflayer d’introduire
des airs dans les fcènes. Mais on n’étoit pas encore
mûr en France pour cette tentative. On ne l’étoit
pas furtout à l’académie royale de mufique. Eme-
linde ôù M. Philidor avoit déployé toutes les ref-
fources de fon art, n’eut en 1761 qu’un fuccès douteux
& fortement difputé. Mais il ne le fut pas à là
jeprife. On fen-tit vivement les beautés de cet ouvrage,
qui fait époque, & qui allure à fon auteur la gloire
d’avoir le premier fubftitué fur notre théâtre lyrique,
le récitatif Amplement déclamé et les airs , duos,
trios & autres morceaux de mufique mefurée, fuivant
la méthode italienne , à l’ancienne &. Soporifique
pfalmodie françoife.
En 1779 » M» Philidor fit exécuter à Londres le
Carmin feeculare d’Horace, que nous avons depuis
entendu au concert fpir’tuel, Si. qui en Angleterre,
comme en France , a réuni les fuffrages de tous les
connoiffeurs. Il a toujours continué de mêle • fon goût
pour les échecs à fes occupations muficale*. D ’s 1747»
il avoit fait imprimer à Londres Vçnalife des échecs,
ouvrage pour lequel il avoit eu une forre fouferip-
tion. 11 le fit réimprimer en 1777 avec des augmentations
confidérables.
Le ftyle de la mufique de ce maître eft favant. Sa
marche eft ferme & hardie, fon harmonie forte fans
être,du'e ; on ne le trouve pas auffi heureux dans
la création du chant , quoique dans tous fes opéra,
il y ait des morceaux d’un chant très-agréable. On
lui reproche à cet égard beaucoup d’emprunts ou
plus que des emprunts ; & il eft certain que dans le
Sorcier, dans Tom Jones, dans Ernelinde & d’autres
ouvrages, des ffiotifs entiers, alors ignorés des François
à qui la mufique italienne étoit. entièrement
étrangère , .mais très-connus aujourd’hui , viennent
à l’appui de ce reproche. 11 eft probable qu’il entre
un peu de pa^effe dans ce défaut. Nourri comme il l’a
été de bonne heure de l’éiude dès grands maîtres,
M. Pteilidor auroit pu,fans doute imiter leur ftyle,
comme il Ta fait fou vent, fans confondre avec cette
imitation permife des plagiats impardonnables.
M. Monfigny vînt en 1759 , joindre fur le même
théâtre fes eftorts -& fes fuccès à ceux de MM. Duni
& Phi’idor. Il a donné environ douze ouvrages, dont
les principaux, font les aveux indiferets,1e maître en
droit, le cadj, dupé, on ne s’avife jamais de tout , le
roi & le fermier , Rjfe & Calas, le dèferteur, la belle
Arfhie 6» Félix.
Un chant facile & gracieux, une expreffion touchante
Si naturelle, taraélé ri fient les productions de ce
compofiteur. A cette première époque de nos comédies
lyriques, il a joui peut-être plus qu’aucun autre
du plaifir de voir fes airs devenus populaires , &
cet avantage étoit compté pour beaucoup en France,
Dans tous fes premiers ouvrages, fa manière d’écrire
eft extrêmement négligée , fon harmonie fouvent
foibîe ou confufe, en un mot, fon ftyle peu’formé.
Depuis le déferteur on voit qu’il a plus de maturité ,
qu’il cherche à montrer plus de force. Son orcheftre
eft plus travaillé, mieux rempli ; fon harmonie eft
plus recherchée & paffe pour plus favante ; mais
fes chants ont peut-être quelquefois moins de naturel
& d’aifance.
.'•C e s trois premiers imitateurs du genre italien en
France, fe partageoient le théâtre comique ; ils
avoient fait tous leurs meilleurs ouvrages, & leur
réputation ne croiftoit plus, lorfqu’un nouveau compofiteur
vint partager avec eux les applaudiffemens,
& s’ouvrir une carrière, où prefque tous fes pas _ont
été marqués par des fuccès, où vingt-cinq ans
après fon début, on le voit réuffir encore.
André Grétry é:o!t né à Liège en 1743. Dès
l’âge de douze ans , fon goût déclaré pour la mufique
engagea fes parens à l’envoyer à Rome, où il fut
placé au petit collège de Liège. 11 y étudia fous
Cajali, & fit des progrès fi rapides, qu’à dix-fept
. ans , il compofa avec fuccès pour le théâire d’Aliber-
t i , un intermède intitulé le Vendemiairice, les ven-
dangeufes. C ’eft du moins ce qu’on trouve dans
Ve-ffai fur la mufique de M. Delaborde, à l’article
Grétry. On y ajoute que le jeune Grétry fut appelé
l’année fuivante à travailler pour les théâtres de la Pace
& de Tordinona, mais que fa mauvaife fanté ne le
lui permit pas & le força de quitter ce climat. Tout
cela paroît inexaél.
M. Grétry étant né en 1743 , fa dix-feptième année
tombe en 1760. Or ce fut cette année-là, que
la buona. fifliuola eut tant de fuccès à Rome, & Pic-
cinni, n’y avoit éîé appelé pour la première fois,
que deux ans auparavant pour VAleffandro nelV indie.
Sacchini ne le fut que quelques années après ; & cependant
ces deux grands maîtres étoient à Rome,
dans tout l’éclat de leur réputation , lorfque le jeune
Grétry y faifoit fes études. Il fuiroit affiduement les
repréfentations & les répétitions de Piccini, qui m’a
dit l’y avoir vu plufieurs fois ; il prit pendant plufteurs
mois, des leçons de Sacchini; ce fut ap\ès cela qu’il
compofa pour, le théâtre d’Aliberti, & ce fut Sacchini
lui-même, de qui je tiens ces détails, qui l’engagea
enfuîte à quitter l'Italie pour la France, où il
pouvoit plus aifément travailler à fa réputation & à
fa fortune.
Il paroît donc qu’au lieu de dix-feptans, il en avoit
vingt-un ou vingt-deux, quand il donna l’imermède
des Vendemiatrïcï.
En fortant d'Italie, M. Grétry alla d’abord à Genève
, où il refta pendant fix mois. Il y remit en mufique
Ifabelle & Gertrude, qui réuffit beaucoup fur
le théâtre de cette ville.
De Genève, il fe rendoit fouvent à Ferneÿ ; u M.
de Voltaire & madame Denis, difent les éditeurs .de