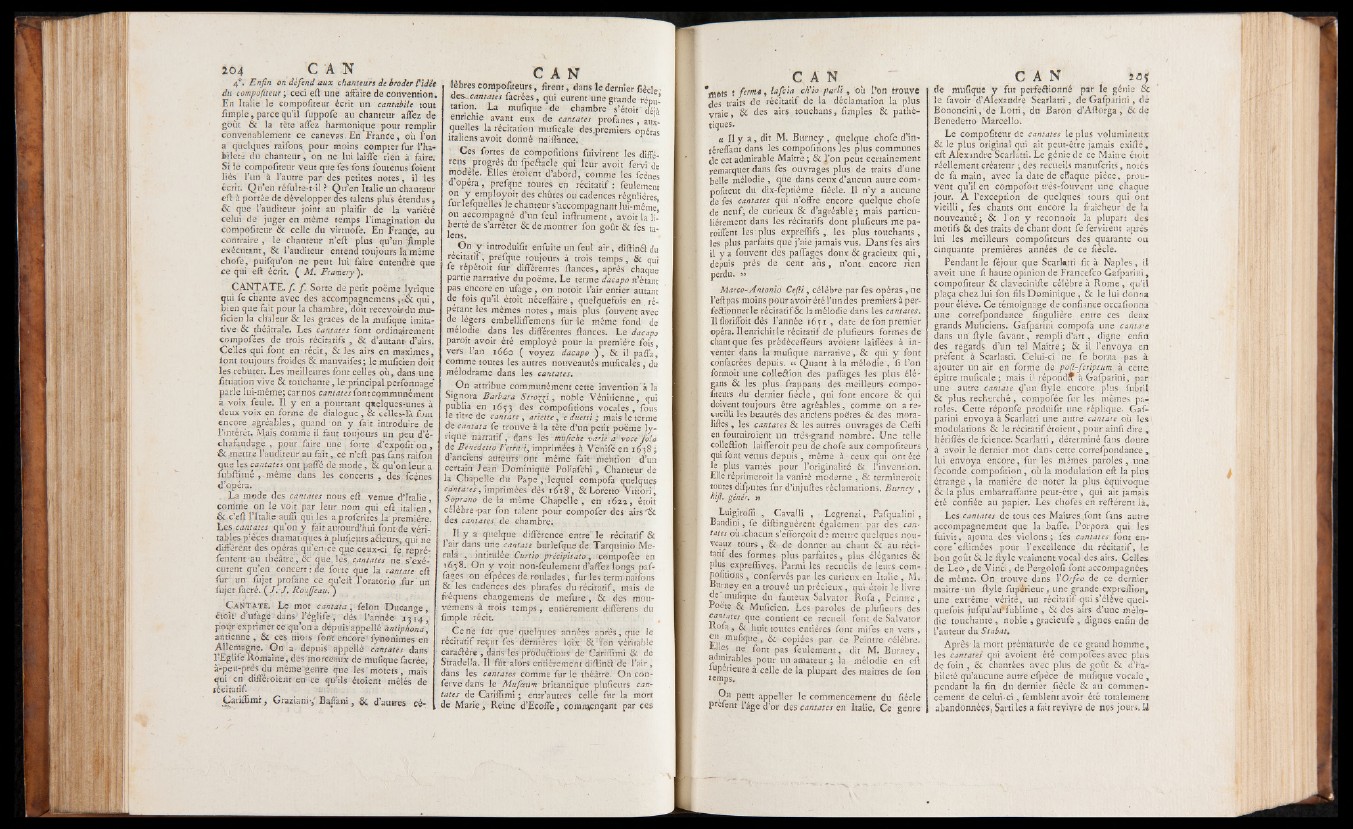
ao4 C A N
4°. Enfin on défend aux chanteurs de broder tid ît
du compofiteur ; ceci eft une affaire de convention.
En Italie le compofiteur écrit un cantabile tout
fimple, parce qu’il fuppofe au chanteur affez de
goût & la tête affez harmonique pour remplir
convenablement ce canevas. En France, où l’on
a quelques raifons pour moins compter fur Tha-
feiletè du chanteur, on ne lui laiffe rien à faire.
Si lé compofiteur veut que fes fons fouténus'foient
liés l’un à l ’autre par des petites notes, il les
écrit. Q u ’en réfulte-t-il ? Qu^en Italie un chanteur
eft à portée de développer des talens plus étendus,
8c que Panditeur joint au plaifir de la variété
celui de juger en même temps l'imagination du
compofiteur & celle du virtuofe. En Frangé, au
contraire , le chanteur n’eft plus qu’un jfimple
exécutant, & l’auditeur entend toujours là même
chofe, puifqu’on ne peut lui faire entendre que
ce qui eft écrit. ( M. Framery ).
CAN TA TE , f . f . Sorte de petit poème lyrique
qui fe chante avec des accompagnemens fj&c qui,
bien que fait pour la chambre, doit recevoir du mu-
ficien la chaleur & les grâces de la mufique imitative
& théâtrale* Les cantates font ordinairement
compofées de trois récitatifs , & d’autant- d’airs.
Celles qui font en récit, & les airs en maximes,
lont toujours froide,s & m au va i fes; le muficien doit \
les rebuter. Les meilleures font celles où, dans une
fituation vive & touchante, le principal perfonnage*
parle lui-même; car nos cantates font communément
à voix feule. Il y en a pourtant qaelquesùmes à
deux voix en forme de dialogue, 8c celles-là font
encore agréables, quand on y fait introduire de
l ’intérêt. M.ais comme il faut toujours un peu d'échafaudage.
, . ppur faire une . forte d’ëxpofiton ,
■ 8c mettre l’auditeur au fait, ce n’eft p'a$ fans raifon
que les cantates ont paffé de mode, & qu’on leur a
lubftitué , même dans les concerts , des.fcènes
d’ppéra..
La mode des cantates nous eft venue d’ Italie,
comme on le voit par leur nom qui eft italien,
& c’eft l’Italie aufii qui les a profcrites Ja première.
"Les-cantates qu’on y fait ^ujpurd’htii font-de véritables
pièces dramatiques à plu/ieprs aéîeurs, qui ne
diffèrént des opéras qu’enjce que ceux-ci fe repré-
fentenr au théâtre , 8c que. les?.cfintates ne ' s’exë-
curent qu’en concert : de forte que la cantate eft
fur un~ fujet profane ce qu’eft l’oratorio ,fur un
fujet facré. ( / . /. Roitjfeau. )
C à n ïAte. Le mot cantàta ; félon Ducange, ,
étoi't; d’ufagè dihs3 l’églife ', dés - l’année- j p q , j
ppqr exprimer ce iqu’on à députe appelle Zn'tiphond’
antienne , & ces itiois fôtff encore’ fÿnonimes en
Allemagne. On a: depuis appelle- cantates dans ;
FEglife Romaineé déSmorc&ûix de mufique facrée,
à-peu-près du même'genre que les ' motets , mais
qui en différaient en ce qu’ils étoient mêlés de
récitatif.
Çariiïimr, Graziani / B a fia n i , & d’auires. cé-
C A N
lebres compofiteurs, firent, dans le dernier fiècle-
decantâtes facrées, qui eurent une grande répu!
tation. La mufique- de chambre s’étoit déjà
enrichie avant eux de cantates profanes , auxquelles
la récitation muficale des.premiers opéras
italiens avoit donné naifiance.
Ces fortes de compofitions fuivirent les différées
progrès du fpeétacle qui leur avoit fervi de
njodele. Elles étoient d’abord, comme les fcènes
d’opéra, prefque toutes en récitatif: feulement
on y employoit des chûtes où cadences régulières,
fur lefquelles le chanteur s’accompagnant lui-même)
ou accompagné d’un feul infiniment, avoit la liberté
de s’arrêter & de montrer fon goût 8c fes talens.
On y introduifit enfuite un feul air, dîfiinél du
récitatif, prefque toujours à trois temps, & qui
fe répétoit fur différentes fiances, après chaque
partie narrative du poème. Le terme daeapo n’étant
pas encore en ufage, on notoit l’air entier autant
de fois qu’il étoit néceffaire, quelquefois en.répétant
les mêmes notes , mais plus fouvent avec
de légers embelliffemens fur le même fond de
mélodie dans les différentes fiances. Le daeapo
paroît avoir été employé pour la première fois,
vers l’an 166o ( voyez daeapo ) , & il paffa,
comme toutes les autres nouveautés mufrcales, du
mélodrame dans les cantates.
On attribue communément cette invention à la
Signora Barbara Strofti, noble Vénitienne, qui
publia en 1653 des compofitions vocales, fous
le titre de cantate , ariette, e duetti ,* mais'le terme
de cantata fe trouve à la tête d’un petit poème lyrique
narratif, dans les mufiche varie a''vocefola
de Benédetto Ferrari) imprimées à Vènifé en 1638 ;
d’anciens auteùW'Ont même fait -mention d’un
certain Jean Dominique Poliafchi , Chanteur de
la Chapelle du Pape ,* lequel compbfa quelques
cantates , imprimées dès 16 18, & Lorettb Vittori?
Soprano de la même Chapelle, en 1622, étoit
célèbre «par fon talent pour compofer des airs *8c
; des cantates de chambre.
Il y a quelque différence entre' Ie récitatif &
1 air dans une cantate burlefque de Tarquinio Me-
r m à i nt i t u l é e Curtio prècipitato, compofee en
16jS . On y. voit non-feulement d’afiez longs paffages
vo.u efpèces de roulades, fur les terminaifons
& les cadences des phrafes du récitatif, mais de
fréquens chapgemens de mefure, & des mou-
vémens a trois temps, entièrement difierens du
fimple récit.
Ce né fut que’ quelques années après, que le
récitatif reçut fes dernières ldix & 'fo ’n véritable
cara<fière , dàns lés p^diTélibns de 'Càrifiimi & de
Strâdella. Il fût alors entièrement dîfiinél de l’a ir,
dans les cantates comme fur le théâtre. On con-
ferve dans le Mu fatum britannique plufieurs cantates
de Cariffimi ; entr’autres celle fur la mort
de Marie, Reine d’Ecoffe, commençant par ces
C A
î ferma, lafcia ch'io parti, où l’on trouve
des traits de récitatif de la déclamation la plus
vraie, & des airs touchans, fimples & pathétiques.
u II y a , dit M. Burney, quelque chofe d’in-
téreffant danfc les compofitions les plus communes
de cet admirable Maître ; & l ’on peut certainement
remarquer dans fes ouvrages plus de traits d’une
belle mélodie , que dans ceux d’aucun autre com-
pofiteut du dix-feptième fiècle. 11 n’y a aucune
de fes cantates qui 11’offre encorp quelque chofe
de neuf; de curieux & d’agréable; mais particulièrement
dans les récitatifs dont plufieurs me pa-
roiffent les’ plus expreflifs , les plus touchants,
les plus parfaits que j’aie jamais vus. Dans*fes airs
il y a fouvent des paffages doux & gracieux qui,
depuis près de cent ans, n’ont encore rien
perdu. »?
Marco-Antonio Cefii, célèbre par fes opéras , ne
l’eftpas moins pour avoir été l’ un des premiers à perfectionner
le récitatif & lamélodie dans les cantates.
Il florifibit dès l’année 1631 , date de fon premier
opéra. Il enrichit le récitatif de plufieurs formes de
chant que fes prédéceffëurs avoient laiffées à inventer
dans la mufique narrative, & qui y font
confacrées depuis. « Quant à la mélodie , fi l ’on
formoit une collection des paffages les plus élé-
gans & les plus frappans des meilleurs compofiteurs
du dernier fiècle, qui font encore & qui
doivent toujours être agréables, comme on a recueilli
les beautés des anciens poètes 8c des mora-
liftes , les cantates 8c les autres ouvrages de Cefii
en fourniroient un très-grand nombre. Une telle
colleCtioîi laifferoit peu de chofe aux compofiteurs
qui font venus depuis , même à ceux qui ont été
le plus vantés pour l’originalité & l’invention.
Elle rèprimeroit la vanité moderne , & terminerait
toutes difputes fur d’injuftes réclamations. Burney
hiß. génér. »
Luigirofli , Cavalli ? Legrenzi, Pafqualini ,
Bandini, fe diftinguèrent,également par des cantates
où .chacun s’efforçoit de mettre quelques nouveaux
tours , & de donner au chant 8c au réci-
des formes plus parfaites, plus élégantes &
plus expreflives.. rarmi les recueils de leurs coin- ,
pofitions , xonfefrvés par les curieux en Italie , M.
Burney en a trouvé un précieux , qui étoit le livre
de mufique du fameux Salvator Rofa , Peintre,
Poète & Muficien. Les paroles de plufieurs des
cantates que contient ce recueil font de Salvator
K o la, & huit toutes entières font mifes en vers ,
én mufique , 8c copiées par ce Peintre célèbre.
Files ne font pas feulement, dit M. Burney,
admirables pour un amateur ; la mélodie en eft
supérieure à celle de la plupart des maîtres de fon
temps,,
2 n aPPe^er commencement du fiècle
prient l’âge d’or des cantates en Italie, Ce genre
C A N iaÿ
de mufique y fut perfeétionné par le génie &
le favoir c”Alexandre Scarlatti, de Gafparini, dé
Bononcini, de Lotti, du Baron d’Aftorga, 8c de
Benedetto Marcello.
Le compofiteur de cantates le plus volumineux
& le plus original qui ait peut-être jamais exifté,
eft Alexandre Scarlatti. Le génie de ce Maître étoit
réellement créateur ; des recueils manuferits, notés
de fa main, avec la date de clîaque pièce, prouvent
qu’il en compofoit très-fouvent une chaque
jour. A l’exception de quelques tours qui ont
v ieilli, fes chants ont encore la fraîcheur de la
nouveauté; & Ton y reconnoît la plupart des
motifs & des traits de chant dont fe fervirent après
lui les meilleurs compofiteurs des quarante ou
cinquante premières années de ce fiècle.
Pendant le féjour que ScarUtti fit à Naples, il
avoit une fi haute opinion de Francefco Gafparini,
compofiteur & clavecinifie célèbre à Rome , qu’il
plaça chez lui fon fils Dominique, & le lui donna
pour élève. Ce témoignage de confiance occafionnà
une correfpondance fingulière entre ces deux
grands Muficiens. Gafparini compofa une cantate
dans un ftyle favant, rempli d’a r t, digne enfin
des regards d’un tel Maître ; 8c il l’envoya en
préfent à Scarlatti. Celui-ci ne fe borna -pas à
ajouter un air en forme de poft-feriptum à cette,
épître muficale ; mais il répond* à Gafparini, par
une autre cantate d’un ftyle encore plus fubtil
8c plus recherché, compofée fur les mêmes paroles.
Cette réponfe prodiùfit une réplique- Gafparini
envoya à Scarlatti une autre cantate ou le s 1
modulations & le récitatif étoient, pour ainfi dire ,
hériffés de fcience. Scarlatti, déterminé fans doute
à avoir le dernier mot dans cette correfpondance,
lui envoya encore, fur les mêmes paroles, une
fécondé compofition, où la modulation eft la plus
étrange , la manière de noter la plus équivoque
& la plus embarraffante peut-être , qui ait jamais
été confiée au papier. Les chofes en refièrent là.
Les cantates de tous ces Maîtres font fans autre
accompagnement que la baffe. Porpora qui les
fuivit, ajouta des violons ; fes cantates font encore
*eftimées pour l'excellence du récitatif, le
bon goût & le ftyle vraiment vocal des airs. Celles
de Léo , de Vinci, de Pergolofi font accompagnées
de même. On^ trouve dans YOrfeo de ce dernier
maître un ftyle fupérieur, une grande expreilion,
une extrême vérité, un récitatif qui s’élève quelquefois
jufqu’au*fublime , & des airs d’une mélodie
touchante , noble , gracieufe , dignes enfin de
l’auteur du Stabàt.
Après-la mort prématurée de ce grand homme,
les cantates qui avoient été compofées avec plus
de foin , & chantées avec plus de goût & d'habileté
qu’aucune autre efpèce dé mufique vocale ,
pendant la fin du dernier fiècle & au commencement
de .celui-ci, femblent avoir été totalement
abandonnées, Sartiles a fait revivre de nçs jours, U