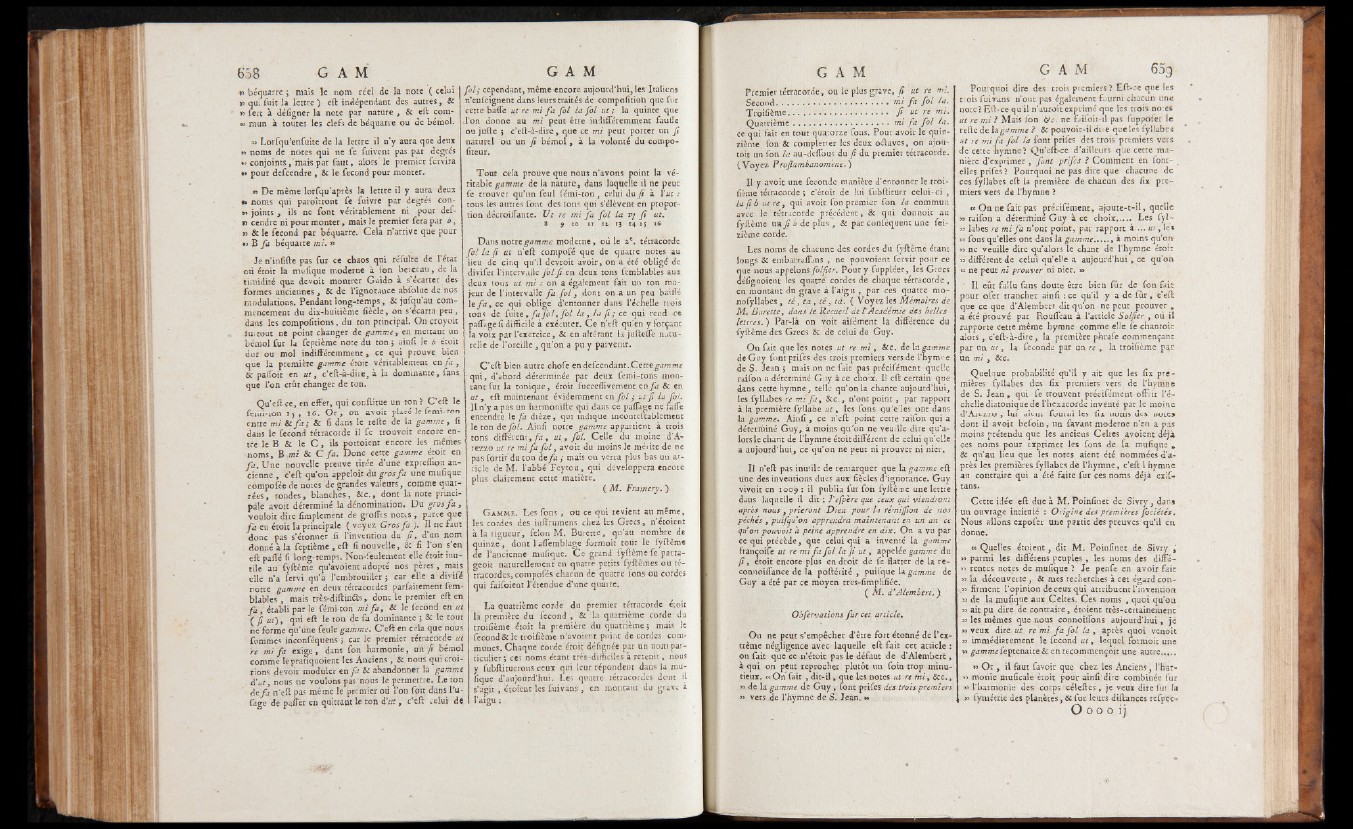
•» béquarre j mais le nom réel de la note ( celui
» qui fuit la lettre ) eft indépendant des autres, 8c
» lert à défigner la note par nature , & eft com-
w mun à toutes les clefs de béquarre ou de bémol.
» Lorfqu’enfuite de la lettre il n’y aura que deux
» noms de notes qui ne fe fuivent pas par degrés
•> conjoints, 'mais par faut, alors le premier fervira
•» pour dcfcendre , & le fécond pour monter.
» De même Iorfqu'après la lettre il y aura deux
*• noms qui paroîtront fe fuivre par degrés con-
»» joints , ils ne font véritablement ni pour def-
» cendre ni pour monter, mais le premier fera par b ,
» & le fécond par béquarre. Cela n’arrive que pour
•j B fa béquarre mi. »
Je n’infifte pas fur- ce chaos qui réfulte de l’état
où étoit la mufique moderne à Ton berceau, de la
timidité que devoit montrer Guido à s’écarter des
formes anciennes , & de l’ignorance abfoluc de nos
modulations. Pendant long-temps, & jufqu’au commencement
du dix-huitième fiècle, on s écarta.peu ,
dans les comportions, du ton principal. On croyoit
lu;tout ne point changer de gamme-, en mettant un
bémol fur la feptième note du ton ; ainfi le b étoit
dur ou mol indifféremment, ce qui prouve bien
que la première gamme étoit véritablement en fa ,
& paffoit en ut, c’cft-à-dire, à la dominante, fans,
que l’on crût changer de ton.
Qu’eft ce, en effet, qui conftitùe un ton ? C ’eft le
femi-ton 1 5 , 16. O r , on avoic placé le femi-ton
entre mi & fa ; & fi dans le refte de la gamme, fi
dans le fécond tétracordc il fe trouvoit encore entre
le B & le C , ils portoient encore les mêmes
noms, B mi & C fa. Donc cette gamme étoit en
fa . Une nouvelle preuve tirée d’une expreflion ancienne
fo l j cependant, même encore aujourd’hui, les Italiens
n’enfeignent dans leurs traités de compofitioh que fur
cette baffe ut re mi fa fo l la fo l ut ; la quinte que
.l’on donne au mi peut être indifféremment fauiîc
ou jufte j c’eft-à-dirc, que ce mi peut porter un f i
naturel ou un f i bémol , à la volonté du compo-
fiteur.
, c’eft qu’on appeloit du gros fa une mufique
compofée de notes de grandes valeurs, comme quar-
rées, rondes , blanches, & c ., donc la note principale
avoit déterminé la dénomination. Du gros f a ,
vouloir, dire Amplement de groffes notes , parce que
fa en étoit la principale ( voyez Gros fa ). Il ne faut
donc pas s’étonner fi l’invention du f i , d un nom
donné à la feptième , eft fi nouvelle, & fi l’on s’en
eft paffé fi long-temps. Non-feulement elle étoit inutile
au fyftême qu’avoient adopté nos pères, mais
elle n’a fervi qu’a l’embrouiller; car elle a divifé
notre gamme en deux tétracordes parfaitement lem-
blables, mais très-diftinds, donc le premier eft en
fa , établi par le fémi-ton mi fa , & le fécond en ut
( f i ut), qui eft le ton de fa dominante ; & le tout
ne forme qu’une feule gamme. C ’eft en cela que nous
fommes inconféquens 5 car le premier tétracordc ut
re mi fa exige, dans fon harmonie, un' f i bémol
comme lepratiquoient les Anciens, & nous qui croirions
devoir moduler en fa 8c abandonner la gamme
à'ut, nous ne voulons pas nous le permettre. Le ton
de fa n’eft pas même le premier ou l’on fpit dans l'u-
fage de potier en quittant le ton d'ut, c’cft celui de
Tout cela prouve que nous n'avons point la vé-
; ritablc gamme de la nature, dans laquelle il ne peut
j fe trouver qu’un feul fémi-ton, celui du f i à lut :
tous les autres font des tons qui s’élèvent en proportion
décroiffantc. Ut re mi fa fo l la v j f i ut.
8 9 1 0 1 1 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6
Dans notre gamme moderne, où le zc. tétracordc
fol la fi ut n’eft compofé que de quatre notes au
lieu de cinq qu’il devroit avoir, on a été obligé de
divifer l’intervaiie fol f i en deux tons femblabies aux
deux tous ut mi : on a également fait un ton majeur
de l’intervalle fa fo l, donc on .a un peu baiffé
le fa , ce qui oblige d’entonner dans l'échelle trois
tons de fuite, fa fol, fol la , la fi ; ce qui rend ce
paffage fi difficile à exécuter. Ce n’eft qu'en y forçant
la voix par l’exercice, 3c en altérant k jufteue naturelle
de l’oreille , qu’on a pu y parvenir.
C ’eft bien autre chofe en defeendant. Cette gamme
qui, d’abord -déterminée par deux femi-tons montant
fur la tonique, éroit fucceflivement en fa 8c en
u t , eft maintenant évidemment en fo l ; ut f i la fol.
Il n’y a pas un harmonifte qui dans ce paffage ne faffe
entendre le fa dièze, qui indique inconteftablement
le ton de fo l. Ainfi notre gamme appartient à trois
tons différens, f a , u t, fol. Celle du moine d’A-
rezzo ut re mi fa f o l , avoit du moins Je même de ne
pas fortir du ton de fa y mais on verra plus bas un article
de M. l’abbé Feytou, qui développera encore
plus clairement cette matière.
( M. Framery. )
G amme. Les fons , ou ce qui revient au même,
les cordes des inftrumens chez les Grecs, n’étoient
à la rigueur', félon M. Burette, qu’au nombre de
quinze, dont l'affemblage formoit tout le fyftême
de l’ancienne mufique. C e grand fyftême fe parta-
geoit naturellement en quatre petits fyftêmes ou tétracordes,
compofés chacun de quatre fons ou cordes
qui faifoient l’étendue d’une quarte.
La quatrième corde du premier tétracorde étoit
la première du fécond , & k quatrième corde du
troifième étoit la première du quatrième ; mais le
feeond&Ie troifième n’avoient point de cordes communes.
Chaque corde étoit défignée par un nom particulier;
ce; noms étant très-difficiles à retenir, nous
y fubftituerons ceux qui leur répondent dans la mufique
d’aujourd’hui. Les quatre tétracordes dont il
s’agit, étoient les fùivans , en montant du grave à
l’aigu ;
Premier tétracorde, ou le plus grave, f i ut re mi.
Second................................................mi fa fo l la.
Troifième.... ................................ f i ut re mi.
Quatrième . ■...................................... mi fa fo l la.
ce qui fait en tout quatorze fons. Pour avoir le quinzième
fon & completrer les deux oélaves, on ajou-
toit un fon la au-deflfous du fi du premier tétracorde.
(Voyez Profiambanom'ene.)
Il y avoit une féconde manière d’entonner le troifième
tétracordc ; c’étoic de lui fubftituer celui-ci ,
la fi b ut re y qui avoit fon premier fon la commun
avec le tétracorde précédent , & qui donnoic au
fyftême u* f i b de plus , & par conléquenc une fei-
zième corde.
Les noms de chacune des cordes du fyftême étant
longs 3c embarraflans , ne pouvoien.t fervir pour ce
ue nous appelons folfier. Pour y fuppléer, les Grecs
éfignoient les quatre cordes de chaque tétracorde,
en montant du grave à l'aigu , par ces quatre mo-
nofyllabes, té , t a t ê , ta. ( Voyez les Mémoires de•
M. Burette, dans le Recueil de VAcadémie des belles
lettres.) Par-là on voit aifément la différence du ;
fyftême des Grecs & de celui de Guy.
On fait que les notes ut re m i, 6cc. de la gamme
de Guy fontprifes des trois premiers vers de l’hymre |
de S. Jean 5 mais on ne fait pas précisément quelle j
raifon a déterminé Guy à ce choix. Il eft certain que 1
dans cette hymne, telle qu’on la chante aujourd’hui,
les fyllabes re mi'fa, & c ., n’ont point , par rapport
à la première fyllabe u t, les fons qu’e'les ont dans
la gamme. Ainfi , ce n’eft point cette raifon qui a
déterminé Guy, à moins qu’on ne veuille dire qu’a-
lorsle chant de l’hymne étoit différent de celui qu’elle
a aujourd'hui, ce qu’on ne peut ni prouver ni nier.
Il n’eft: pas inutile de remarquer que la gamme eft
une des inventions dues aux fiècles d'ignorance. Guy
vivoit en 1009 : il publia fur fon fyftême une lettre
dans laquelle il dit : J'efpére que ceux qui viendront
apres nous , prieront Dieu pour la rémijfion de nos :
pêchés , puifquon apprendra maintenant en un an ce
quon pouvoit a peine apprendre en dix. On a vu par
ce qui précède, que celui qui a inventé la gamme
françoife ut re mi fa fo l la f i u t, appelée gamme du
f i , étoit encore plus en droit de fe flatter de la re-
connoiffance de la poftérité , puilque la gamme de
Guy a été par ce moyen tres-fimplifiéc.
( Af. a Alembert. )
Obfervations fur cet article.
On ne peut s’empêcher d’être fort étonné de l’extrême
négligence avec laquelle eft fait cet article :
on fait que ce n’étoit pas le défaut de d’Alembert,
à qui on peut reprocher plutôt un foin trop minutieux.
«On fait , dit-il, que les notes ut re mi, 8cc.,
»s de la gamme de G u y , font prifes des trois premiers\
» vers .de l’hymne de Si Jean. »•
Pourquoi dire des trois premiers ? Eft-ce que les
trois fui vans n’ont pas également fourni chacun une
note? Eft-ce qu’il n’auroit exprimé que les trois nores
ut re mi ? Mais fon &c. ne foifoit-il pas fuppofer le
refte de la gamme ? 3c pouvoit-il dise que les fyllabes
ut re mi fa fo l ta font prifes des trois premiers vers
de cette hymne? Qu’eft-ce d’ailleurs que cette manière
d’exprimer , font prifes ? Comment en font- .
elles prifes ? Pourquoi ne pas dire que chacune de
ces fyllabes eft k première de chacun des fix premiers
vers de l’hymne ?
e* On ne fait pas précifément, ajoute-t-il, quelle
s* raifon a détermine Guy à ce choix...... Les fyl-
93'labes re mi fa n’ont point, par rapport à.... ut, les
33 fons qu’elles ont dans la gamme....... à moins qu’on
33 ne veuille dire qu’alors le chant de l'hymne étoit
9s différent de celui quelle a aujourd’hui , ce qu’on
» ne peut ni prouver ni nier. *»
Il eût fallu fans doute être bien fur de fon fait
pour ofer trancher ainfi :ce qu’il y a de fur, c’eft
que ce que d’Alembert dit qu’on ne peut prouver ,
a écé prouvé par Rouffcau à l’article Solfier , où il
rapporte cette même hymne comme elle fe chantoit
alors , c’eft-à-dire, la première phrafe commençant
par un u t, la fécondé par un re , la troifième par
un mi y &c.
Quelque probabilité qu’il y ait que les fix premières
fyllabes des fix premiers vers de l’hymne
de S. Jean, qui fe trouvent précifément offrit l’échelle
diatonique de i’hexacorde inventé par le moine
d’Arezzo , lui aient fourni les fix noms des notes
dont il avoit befoin, un favant moderne n’en a pas
moins prétendu que les anciens Celtes avoient déjà
ces noms pour exprimer les fons de la mufique *
& qu’au lieu que les notes aient été nommées d’après
les premières fyllabes de l’hymne, c’eft l hymne
au contraire qui a été faite fur ces noms déjà exifi-
tans.
Cette idée eft due à M. Poinfinet de Sivry , dans
un ouvrage intitulé : Origine des premières fociétés.
Nous allons expofer une partie des preuves qu’il en
donne.
« Quelles étoient, dit M. Poinfinet de Sivry ÿ
33 parmi les différens peuples , les noms des diffé-
» rentes notes de mufique ? Je penfe en avoir fait
>3 la découverte, & mes recherches à cet égard con-
<33 firment l’opinion de ceux qui attribuent l'invention
33 de la mufique aux Celtes. Ces noms , quoi qu’on
» ait pu dire de contraire, étoient très-certainement
33 les mêmes que nous connoiffons aujourd’hui , Je
»3 veux dire ut re mi fa fol la , après quoi venoit
33 immédiatement le fécond u t, lequel formoit une
»3 g'amme feptenaire & en reçommençoic une autre......
>3 Or , il fout favoir que chez les Anciens, l’har-
93 monie muficale étoit pour ainfi dire combinée fur
» l’harmonie des corps céleftes , je veux dire fur la
»9 fymétrie des planètes, & fur leurs diftançcs refpçc-«
O o o o ij