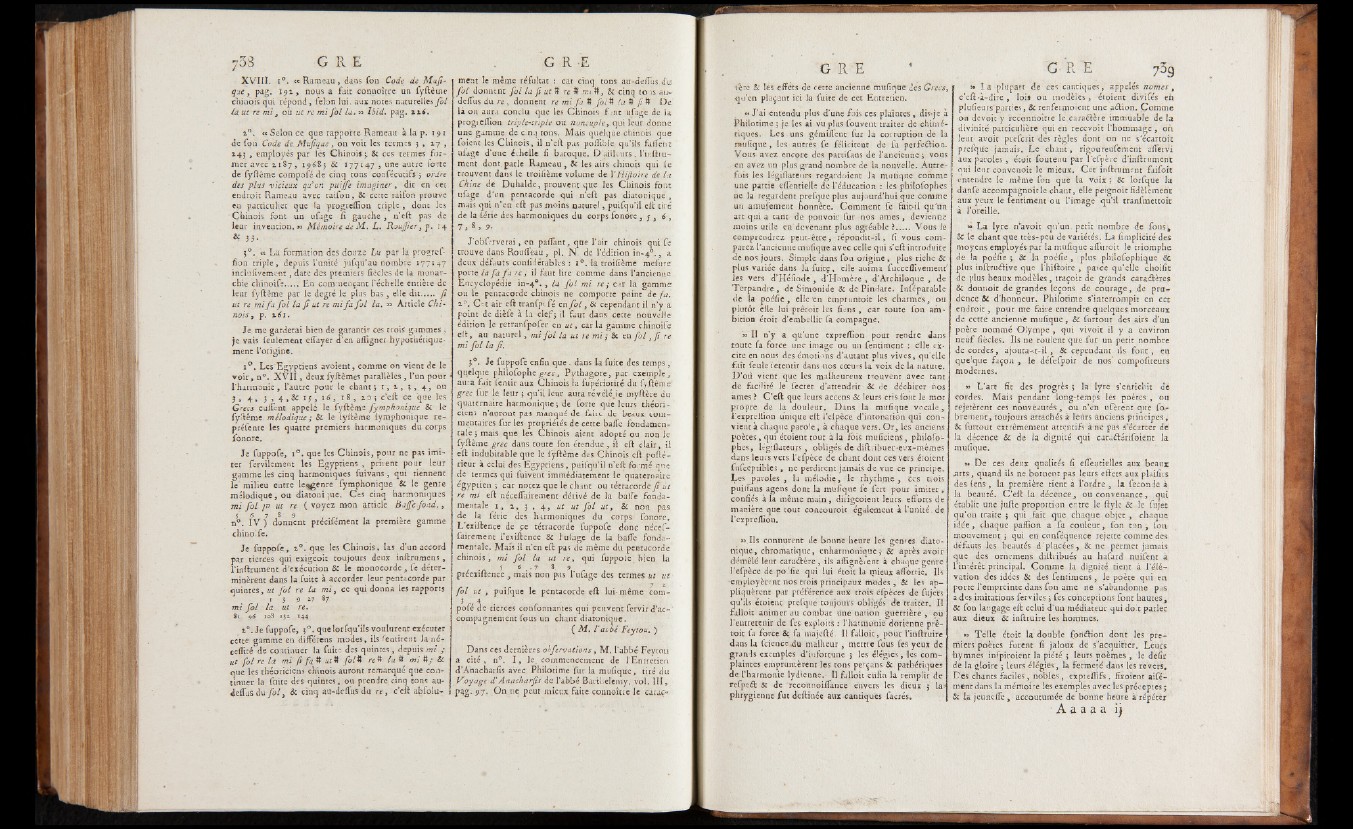
733 G R E
XVIII. i° . ce Rameau, dans fou Code de Mufique
, pag. 151, nous a fait connoître un fyftêrne
chinois qui répond, félon lui, aux notes naturelles fol
la. ut re mi, ou ut re mi Jol la, » Ibid. pag. 116.
«« Selon ce que rapporte Rameau à la p. ip i
dè (on Code de. Mufique , on voit les termes 3 , 1 7 ,
143 , employés par lés Chinois 3 8c ces termes former
avec 1187, 12683 6c 177147 , une autre lotte
de fyftêrne compofé de cinq tons coofécutifs 3 ordre
des plus vicieux qu on puijfe imaginer,- dit en cet
endroit Rameau avec raifon, & cette raifon prouve
en particulier que la progreflîon triple , dont les
Chinois font un ufage fi gauche, n’eft pas de
leur inveution. » Mémoire de M. L. Roujfier3 p. 14
^ 3 3 *
30. «e La formation des douze Lu par la progref-
fion triple, depuis l’unité jufqu’au nombre 177147
inclufiveme-nt, date des premiers fiècles de la monarchie
chinoifs__ En commençant l’échelle entière de
leur fyftêrne par le degré le plus bas , elle dit..... fi
ut re mi fa fo l la fi ut re mi fa fo l la. ** Article Chinois
, p. 161.
Je me garderai bien de garantir ces trois gammes ;
je vais feulement effayer d’en afligner hypothétiquement
l’origine.
i ° . Les Egyptiens avoient, comme on vient de le
voir, n°. X V I I , deux fyftêmes parallèles , l’un pour
l ’harmonie, l’autre pour le chant5 1 , t , ?, 4 , ou
3 , 4 , 3 , 4 , & 1 ƒ , 16 , 18 , xo ; c’eft ce que les
Grecs euffent appelé le fyftêrne fympkonique 8c le
fyftêrne mélodique,* 8c le fyftêrne fymphonique re-
préfente les quatre premiers harmoniques du corps
jfonorc.
Je fuppofe, i®. que les Chinois, pour ne pas imiter
fervilement les Egyptiens , prirent pour leur
gamme les cinq harmoniques fuivans-, qui tiennent
le' milieu entre le^genrc fymphonique & le genre
mélodique, ou diatonijue. Ces cinq harmoniques
7ni fol jv ut re ( voyez mon article Bajfe fond. ,
5 & 7 ,8 9 ' . . r / . ..
n°. IV ) donnent précilement la première gamme
chinoife.
Je fuppofe , z°. que les Chinois, las d’un accord
par tierces qui exigeoit toujours deux inftrumens,
l’inftrument d’exécution 8c le monocorde , fe déterminèrent
dans la.fuitç à accorder leur pentacorde par
quintes, ut fo l re la mi, ce qui donna les rapports
r 3 9 Z7 87
mi fo l la ut re.
Si p6 io3 131 144
x°. Je fuppofe, 3°. quelorfqu’ils voulurent exécuter
cette gamme en différens modes, ils fentirent la né-
eeflité de continuer la fuie? des quintes, depuis mi ,*
ut fo l re la mi fi fa % ut% fol% re% la mi tty &
que les théoriciens chinois auront remarqué que con-
tirmer la faite des quintes, ou prendre cinq tons au- i
deffusdu fo l 3 8c cinq au-deffus du ret c’eft abfolu- J
G R E
ment le même réfultat : car cinq tons au-deffus du'
fo l donnent Jol la fi ut § re % nu # , & cinq to îs au-
deffus du re , donnent re mi fa # fol% la # fi # De
là on aura conclu que les Chinois f-mt ufage de la
! progieffion triple-triple ou nçncuple, qui leur donne
| un.e- gamme de cinq tons. Mais quelque chinois que
S foient les Chinois, il n’eft pas poflibîe qu’ils faffenc
| ufage d’une échelle fi baroque. D'ailleurs. l’icftru-
! ment dont parle Rajneau, 8c les airs chinois qui le
! trouvent dans le troifième vofume de l ’Hijtoire de la
! Chine de Duhalde, prouvent que les Chinois font
; ufage d’un pentacorde qui n’eft pas diatonique ,
mais qui n’en 'eft pas moins nature!, puifqn’il eft tiré
i de la lérie des harmoniques du corps fondre, y , 6 }
7 s%>9-
J’o b firve ra i, en paffànt, que l’air chinois qui fe
trouve dans Rouffeau , pl. N. de l’édition in-40. , a
deux défauts considérables ; i ° . la croifîème mefure
porte la fa fa fe y il faut lire comme dans l’ancienne
Encyclopédie in-40. , M fol mi re 3 c.<r la gamme
ou le pentacorde chinois ne comporte point de fa.
! i ° . C e t air eft tranfpcfé en f o l , & cependant il n’y a
point de dièfe à la c le f3 il faut dans cette nouvelle
édition le retranfpofer en uct caria gamme chinoife
e f t , au naturel, mi fo l la ut re mi ; & en f o l , fi re
mi fo l la fi.
3°. Je fuppofe enfin que . dans la fuite des temps,
quelque philofophe grec, Pythagore, par exemple,
aura fait fentir aux Chinois la fupériorité du fyftêrne
grec fur le leur 3 qu’il leur aura ré v é lé je myftère du
quaternaire harmonique, de force que leurs théoriciens
n’auront pas manqué de faire de beaux commentaires
fur les propriétés de cette baffe fondamentale
5 mais que les Chinois aient adopté ou non le
fyftêrne grec dans toute fon étendue , il eft clair, il
eft indubitable que le fyftêrne des Chinois eft pofté-
rieur à celui des Egyptiens, puifqu’il ffeft formé que
de termes qui fuivenc immédiatement le quaternaire
égyptien ; car notez que le chant ou tétraco'rde f i ut
re mi eft néceffairement dérivé de la baffe fondamentale
1 , x , 3 , 4 , ut ut fo l ut, & non pas
de la lérie des harmoniques du corps fonore*
L ’exiftence de ce tétracorde fuppofe donc nécef-
faircmcnt l’exiftence 8c l ulagc de la baffe fondamentale.
Mais il n’en eft pas de même du pentacorde
chinois, mi fo l la ut re3 qui fuppole bien la
J 6 .7 8. 9
préexiftence , mais non pas l’ufage des termes ut ut
fo l ut , puifque le pentacorde eft lui-même com-
3 4
pofé de tierces confonnantes qui peuvent fervir d’accompagnement
fous un chant diatonique.
( M. l'abbé Feytou. )
Dans ces dernières ohfervations, M. l’abbé Feytou
a c ité , n°. I , le. commencement de l'Entretien
d’Anacharfis avec Philotime fur la mufique, tiré du
Voyage d?Anacharfis de l’abbé Barthélémy, vol. I II,
pqg. 2 7 * .On ne peut mieux faire connoîtie le cataç-
G R E G R E 739
i^re & les effets de cette ancienne mufique des Grecs,
-qu’en plaçant ici la fuite de cet Entretien.
«« J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes , dis-je à
Philotime 3 je les ai vu plus Couvent traiter de chimériques.
Les uns gémiffent fur la corruption de la
mufique, les autres fe féliciteut de fa perfection.
Vous avez encore des partifans de l’ancienne 3 vous
en avez un plus grand nombre de la nouvelle. Autrefois
les législateurs regardoient la mufique comme
une partie effentiellc de l’éducation : les philofophes
ne la regardent prefque plus aujourd’hui que comme
un amufement honnête. Comment fe fait-il qu’un
art qui a tant de pouvoir fur nos âmes, devienne
moins utile en devenant plus agréable ?.......V ous le
comprendrez peut-être, répondit-il, fi vous comparez
l’ancienne mufique avec celle qui s’eft introduite
de nos jours. Simple dans fon origine, plus riche 8c •
plus variée dans la fu itç , elle anima fucceflïveiiient',
les vers d’Héfiode, d’Homère ,, d’Archiloque , de i
Terpandre, de Simonide 8c de Pindare. Inféparable
de la poéfie, e lle -en ëmpruntoit les charmes, ou
plutôt elle lui prêtoit les fîcns , car toute fon ambition
étoit d’embellir fa compagne.
» Il n’y a qu’une cxpreffïon pour rendre dans
toute fa force une image ou un fentiment : elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle
fait feule retentir dans -nos coeurs la voix de la nature.
D ’où vient que les malheureux trouvent âvec tant
de facilité le fecret d’attendrir' 8c rie déchirer nos
âmes ? C ’eft que leurs accens & leurs cris font le mot
propre de la douleur. Dans la mufique vocale,
Texprcmon unique eft l’efpèce d’intonation qui convient
a chaque.parole, à chaque vers. O r , les anciens
poètes, qui étoient tout à la fois muficiens, philofo1-
phes, légiflateurs, obligés de diftiibuer-eux-mémes
dans leurs vers l’efpèce de chant dont ces vers étoient
fufccptibles, ne perdirent jamais de vue ce principe-.
Les p a ro les , la mélodie, le rhythme , des trois
puiffans agens dont la mufique fe fert pour imiter,
confiés à la même main, dirigeoient leurs efforts de
manière que tout concouroic également à l’unité.de
l ’cxprellion.
»a ils connurent de bonne heure les genres diatonique,
chromatique, enharmonique3 & après avoir
démêlé leur caraÂère , ils affignèient à chaque genre
l’efpèce de po:fie qui lui étoit la mieux afl'ortie. 1k
•employèrent nos trois principaux modes, & les appliquèrent
par préférence aux trois efpèces de fujets
qu’ils écoient prefque toujours obligés de traiter. Il
falloir animer au combat line nation guerrière , ou
l’entretenir de fes exploits : l’harmonie dorienne prêtoit
fa force 8c fa majefté. Il falloir, pour l’inftruire
dans la Iciencc^lu malheur, mettre fous fes yeux de
grands exemples d’infortune j les élégies, les complaintes
empruntèrent les tons perçàns & pathétiques
de L’harmonie lydienne. Il falloir enfin la remplir de
refpeét & de reconnoiffance envers les dieux j la1-'
phrygienne fut deftinée aux cantiques facrés.
>» La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’eft-à-dire , lois ou modèles , étoient divifés eh
plufieurs'parties, & renfermoient une atftion. Comme
ou devoir y recènnoître le,caractère immuable de la
divinité particulière qui en recevoir l’hommage , oh
leur avoit preferit dés règles dont on ne s’écartott
prefque jamais. Le ch ant, rigonreiifemént affervi
aux paroles, étoit foutenu par l ’efpèce d’inftrument
qui leur corivenoit le mieux. Ce t inftrumcnt faifoit
entendre le même fon que la voix ; & lorfque la
danfc accompagnoitle chant, elle peignoir fidèlement
aux yeux le fentiment ou l’ image qu’il tranfmettoit
à l’oreille.
» La lyre n’àvoit qù’un. petit nombre de fon s,
& le chant que très-peu de variécés. La (implicite des
moyens employés par la mufique affuroit le triomphe
de la poéfie 3 & la poéfie , plus philofophique &
plus inftruétive que l'hiftoire , parce qu’elle choifit
de plus beaux modèles, traçoit de grands caraéfcères
& donuoit de grandes leçons de cou rage, de prudence
& d’honneur. Philotime s’interrompit en cet
endroit, pour me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne mufique, 8c furtout des airs d’un
poète nommé Olympe , qui vivoit il y a environ
neuf fiècles. Ils ne roulent que fur un petit nombre
de cordes, ajouta-.t-il, 8c cependant ils f o n t , en
quelque façon , le défefpoir de nos compofiteurs
modernes.
» L ’art fit des progrès ; la lyre s’enrichit dé
cordes. Mais pendant long-temps les p oètes, ou
rejetèrent ces nouvèaurés , ou n’eh ufèrent que fo*-
brement, toujours attachés à leurs anciens p rincipes,
& furtout extrêmement attentifs à ne pas s’écarter dé
la décence & de la dignité qui caraéHrifoiént la
mufique.
»» De ces deux qualités fi effeutielies aux beaux
.arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plaifirs
des (ens, la première tient à Tordre , la fécondé à
la beauté. C ’eft la décence, ou convenance, qui
établit une jufte proportion entre le ftyle & le fujet
qu’on traite 5 qui fait que chaque objet , chaque
idée, chaque paffion a fa couleur, fon ton , Ion
mouvement 3 qui en conféquence rejette comme des
défauts les beautés déplacées, & ne permet jamais
que des ornemens diltribués au hafard nuifent à
l’inrérêt principal. Comme la dignité tient à l ’élévation
des idées & des fentimens, le poète qui en
porte l’empreinte dans fon ame ne s’abandonne pas
a des imitations ferviles 3 fes conceptions font hautes,
& fon langage eft celui d’un média-teür qui doit parler
aux dieux 8c inftruire les hommes.
»3 Telle étoit la double forttftiort dont les premiers
poètes furent fi jaloux de s’acquitter. Leurs
hymnes infpiroient la piété 3 leurs poèmes , le dèfir
de la gloire 3 leurs élégies, là fermeté dans les revers.
Des chants faciles , nobles , expreflîfs , fîxoient aifé- .
ment dans la mémoire les exemples avec les préceptes 3
8c fa jeuneffe, accoutumée de bonne heure à répétez
A a a p. a ij
1