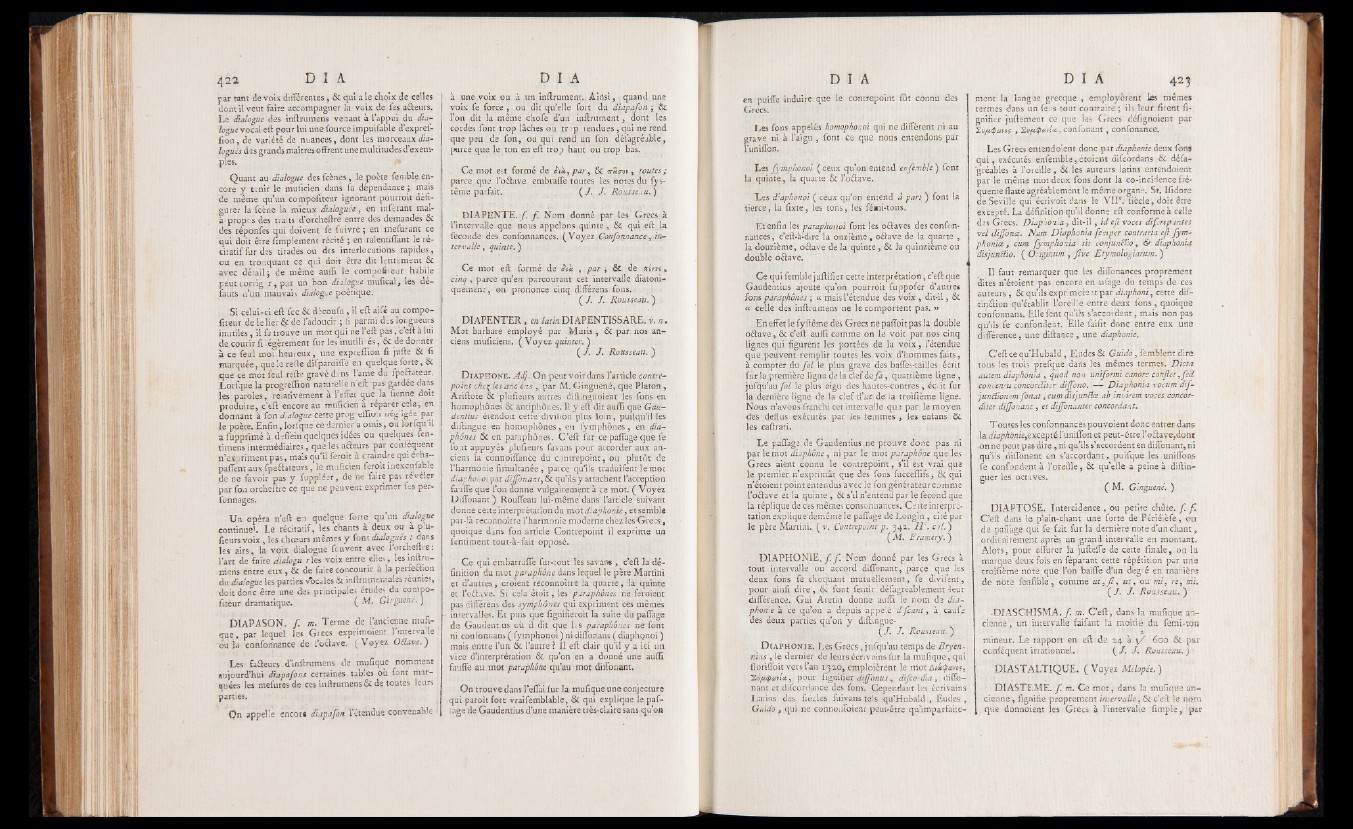
par tant de voix differentes, & qui a le choix de celles j
dont il veut faire accompagner la voix de fes aâeurs.
Le dialogue des inftrumens venant à l’appui du dialogue
vocal eft pour lui une fource impuifable d’expref-
Jfion, de variété de nuances, dont les morceaux dialogues
des grands maîtres offrent une multitudes d’exemples.
Quant au dialogue des fcènes, le poète femble encore
y tenir le muficien dans fa dépendance ; mais '
de même qu’un compofiteur ignorant pourroit défigurer
la fcène la mieux dialoguée, en inférant malà
propos des traits d’orcheftre entre des demandes &
des réponfes qui doivent fe fuivre ; en mefurant ce
qui doit être Amplement récité ; en ralentiffant le récitatif
fur des tirades ou des interlocutions rapides,
ou en tronquant ce qui doit être dit lentement &
avec détail; de même aufli le compofiteur habile
peut corrig.r, par un bon dialogue mufical, les défauts
a’un mauvais dialogue poétique.
Si çelui-ci eft lec & découfu, il eft aife au compo- ■
fiteur de le lier & de l’adoucir ; fi parmi des longueurs j
inutiles, il fe trouve un mot qui ne l’eft pas, c’eft à lui
de.courir fi légèrement fur les inutili' es, & de donner
à ce feul mot heureux, une exprefîïon fi jufte & fi
marquée, que le refie difparoiffe en quelque forte, &
que ce mot feul refte grave dans 1 ame -du fpeôateur.
Lorfque la progtefüon naturelle n eft pas gardee dans ;
les paroles, relativement à l’effet que la fienne doit
produire, c’eft encore àu muficien à réparer cela, en
donnant à fon dialogue cette progeflion neg igee par
le poète. Enfin, lorlque ce dernier a omis, ou lorfqu il
a fupprimé à deffein quelques idees ou quelques fen-
timens intermédiaires, que les aéteurs par confequent
n’expriment pas, mais qu’il feroit a craindre qui echa-
paffent aux fpeftateurs, le muficien feroit inexécutable
de ne favoir pas y fuppléer, de ne faire pas révéler
par fon orcheftre ce que ne peuvent exprimer fes per-
fonnages.
Un opéra n’eft en quelque forte qu’un dialogue
continuel. Le récitatif, les chants a deux ou a p.u-
fieurs voix , les choeurs mêmes y font dialogues : dans
les airs, la voix dialogue fcuvent avec 1 orcheftre :
l’art de faire dïalogu ries voix entre elles, les inftrumens
entre eux, & de faire concourir à la- perfeéhon
du dialogue les parties Vbcales & inftrumentales réunies,
doit donc être une des principales études du compofiteur
dramatique. ( M. Girguené. )
DIAPASON, f . m. Terme de l’ancienne mufique,
par lequel les Grecs exprimoient 1 interva'le
ou la conformance de i’oélave. (V o y e z OElave. )
Les faveurs d’inftrumens de mufique nomment
aujourd’hui diapafons certaines tab;es où font marquées
les mefures de ces inftrumens & de toutes leurs
parties.
On appelle encore diapajon l’étendue convenable -•
I à une voix ou à un inftrument. Airtsi, quand une
voix fe force , ou dit qu’elle fort du diapafoh ; &
l’on dit la même chofe d’un inftrument, dont les
cordes font trop lâches ou tr:p tendues ,qui ne rend
que peu de fon, ou qui rend un fon déiagréable,
parce que le ton en eft trop haut ou trop bas.
Ce mot est formé de h u ,p a r , & veie-ov, toutes;
parce que l’oélave embraffe toutes les notes du fys-
tême parfait. ( J. J. Rousseau. )
DIAPENTE. f . f Nom donné par les Grecs à
l’intervalle que nous appelons quinte , & qui eft la
fécondé des confonnances. (Voyez Confonnançe, intervalle
, quinte.')
Ce mot eft formé de «h« , par -, & de »svté ,
cinq , parce qu’en parcourant cet intervalle diatoniquement
, on prononce cinq dîfférens fons.
( / . J. Rousseau.') ..
DIAPENTER, en latin DIAPENTISS ARE. v. n.
Mot barbare employé par Mûris , & par nos an-
ciens muficiens. ( Voyez quinter. )
( J. J. Rousseau. )
Di APHONE. Ad]. On peut voir dans l’article contrepoint
che^ les anc eus , par M. Ginguené, que Platon ,
Ariftote & plufieurs autres d'iftinguoient les fons en
homophones & antiphônes. Il y eft dit aufli que Gau-
dentïus étendoit cette divifion plus loin , puifqu’il les
diftingue en homophones, en fymphônes, en diaphanes
& en paraphé nés. C ’eft fur ce paffage que fe
font appuyés plufieurs favans pour accorder aux anciens
la connoiffance du contrepoint, ou plutôt de
l’harmonie fimultanée , parce qu’ils traduifent le mot
diaphonoi par diffonant, & qu’ils y attachent l’acception
fauffe que l’on donne vulgairement à ce mot. ( Voyez
Diffonant) Rouffeau lui-même dans l’article, suivant
donne cette interprétation du mot diaphonie, et semble
par-là reconnoître l’harmonie moderne chez les Grecs ,
quoique dans fon article Contrepoint il exprime un
fentiment tout-à-fait opposé.
Ce qui embarraffe fur-tout les savarw , c’eft la définition
du mot par aphone dans lequel le père Martini
et d’autres, croient reconnoître la quarte, ~là quinte
et l’o&ave. Si celaétoit, les paraphones ne feroient
pas diftêreris des symphônes qui expriment ces mêmes
- intervalles. Et puis que fignifieroit la suite du paffage
de Gaudentius où il dit que b s paraphônes ne font
ni confonnans ( fymphonoi) ni diffonans ( diaphonoi )
mais entre l’un & l’autre ? Il eft clair qu’il y a ici un
vice d’interprétation & qu’on en a donné une aufli
fauffe au mot paraphône qu’au mot diffonant.
On trouve dans l’effai fur la mufique une conjecture
qui paroît fort vraifemblable, & qui explique le paf-
iage de Gaudentius d’une manière très-claire sans qu’on
en puiffe induire que le contrepoint fût connu des
Grecs.
Les fons appelés homophonoi qui ne different ni au
grave ni à l’aigu , font ce que nous entendons par
l’uniffon.
Les fymphonoi (ceux qu’on entend en femble) font
la quinte, la quarte & l’oélave.
Les d'aphonoï ( ceux qu’on entend à part ) font la
tierce, la fixte, les tons, les fé«ii-tons.
Et enfin les paraphonoi font les oélaves desconfon- :
nances, c’eft-à-dire la onzième, oélave de la quarte ,
la douzième, oélave de la quinte, & la quinzième ou
double oétave.
Ce qui femble juftifier cette interprétation, c’eft que
Gaudentius ajoute qu’on pourroit fuppofer d’autre»
fons paraphônes ; « mais l’étendue des v o ix , dit-il, &
« celle des inftrumens ne le comportent pas. m
En effet le fyftême des Grecs ne paffoit pas la double
oélave, & c’eft aufli comme on le voit par nos cinq
lignes qpi figurent les portées de la v oix , l’étendue
que peuvent remplir toutes les voix d’hommes faits,
à compter du fol le plus grave des baffes-tailles écrit
fur la première ligne de la clef de f a , quatrième ligne ,
jufqu’au fol le plus aigu des hautes-contres, éç.it fur
la dernière ligne de la clef d’üf de: ia troifième ligne.
Nous n’avons franchi cet intervalle qui par le moyen
des deffus exécutés par les femmes , les enfans &
les caftrati.
Le paffage.de Gaudentius.ne prouve donc pas ni
par lemot diaphône, ni par le mot paraphône que les
Grecs aient connu le contrepoint, s’il est vrai que
le premier n’exprimât que des fons fucceflifs, & qui
n’étoient point entendus avec le fon générateur comme
l’o&ave et la quinte , & s’il n’entend par le fécond que
la réplique de ces mêmes consonnances. Cette interprétation
explique demême le paffage de Longin , cité par
le père Martini, (v . Contrepoint p. 342. l d . o l . )
( M. Frqmery. )
DIAPHONIE, f f . Nom donné par les Grecs à
tout intervalle, ou accord diffonant, parce que les
deux fons fe choquant mutuellement, fe divifent,
pour ainfi dire, & font fentir défagréablement4eur
différence. Gui Aretin donne aufli le nom de diaphonie
à ce qu’on a depuis appelé d fcant, à caufe
dès deux parties qu’on y diftingue-
( J. J. Rousseau. )
D taphonie. Les Grecs, jufqu’au temps de Bryen-
nïus , le dernier de leurs écrivains fur la mufique, qui
floriffoit vers l’an 132.0, emploièrent le mot Atatpavoç,
3Zv/z<pancc, pour fignifier diffonus, difcordia ,. diffonant
et difcordance des fons. Cependant les écrivains
Latins des fiècles fuivans tels qu’Hubald , Eudes,
Guido, qui ne conno:ffoiem peut-être qu’imparfaitement
la langue grecque , employèrent les mêmes
termes dans un fe;;s tout contraire ; ils leu^ firent fignifier
juftement ce que les Grecs défignoient par
^EiVftcpcovoç y iZu/ictpcovlct 5 confonant, confonance.
Les Grecs entend oient donc par diaphonie deux fon#
qui, exécutés enfemble, étoient difcordans & défa-
gréables à l’oreille, & les auteurs latins entendoient
par le même mot deux fons dont la co-incidence fréquente
flatte agréablement le même organe. St. Ifidore
deSevilîe qui écrivoit dans le VIIe. fiècle, doit être
excepté. La définition qu’il donne eft conforme à celle
des Grecs. Duip 'ion.ia, dit-il , id ejl voces difcrêpantes
vel diffomz. Nam Diaphonia femper contraria ejl fym-
phonice. t cum fymphonia sis conjunfllo, & diaphonie
disjunttio. f Originum , jzve Etymologiarum. )
Il faut remarquer que les. diffonances proprement
dites n’étoient pas encore en ufage du temps de ces
auteurs , & qu’ils exprimoient par diaphonie cette dif-
tinélion qu’établit l’oreil'e entre deux fons, quoique
confonnans. Ellefent qu’ils s’accordent, mais non pas
qu’ils fe confondent. Elle faifit donc entre eux une
différence, une diftance, une diaphonie.
C’eft ce qu’Hubald, Eudes & Guido, femblent dire
tous les trois prefque dans les mêmes termes. Dicta
autcm diaphonia , quod non uniformi canore confies , fed
concentu concorditer dijfono. — Diaphonia vocum dif-
jun&ionem fonat, cum disjunâlce ab invirem voces concor-
duer diffonant, et diffonanter concordant.
T ou tes les confonnances pouvoient donc entrer dans
la diaphonie,exceptéd’uniffon et peut-être l’oftave,dont
on ne peut pas dire, ni qu’ils s’accordent en diffonant, ni
qu’ils diffonent en s’accordant, puifque les unifions
fe confondent à l’oreille, & qu’elle a peine à diftin-
guer les octaves.
( M. Gïnguené. )
DIAPTOSE. Intercidence , ou petire chute, f f .
C ’eft dans le plain-chant une forte de Périéièfe, ou
de paffage qui fe fait fur la dernière note d’un chant,
ordinairement après un grand intervalle en montant.
Alors, pour affurer la jufteffe de cette finale, on la
i marque deux fois en féparant cette répétition par une
troifième noté que l’on baiffe d’un deg^é en manière
de note fenfible, comme ut, f i , ut, ou mi, re, mi.
( J. J. Rousseau. )
-DIASCHISMA. f m. C ’eft, dans la mufique ancienne
, un intervalle faifant la moitié du femi-ton
mineur. Le rapport en eft de 24 à y/ 600 & par
ccnféquent irrationnel. ( J. J. Rousseau. ) '
DIASTALTIQUE . ( Voyez Mélopée. )
DIASTEME. f . m. Ce mot, dans la mufique ancienne,
fignifie proprement intervalle, & c’eft le nom
que donnoient les Grecs à l’intervalle fimple, par