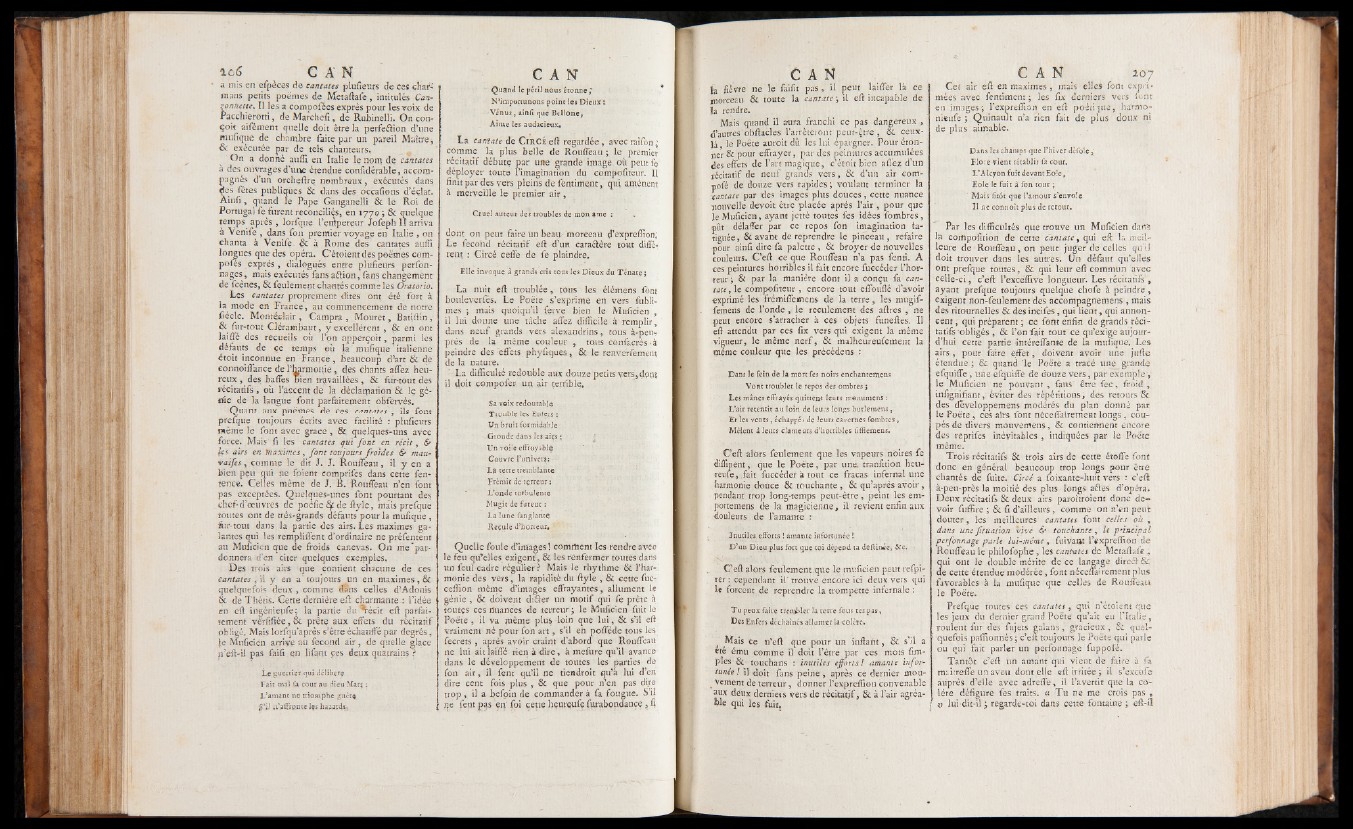
10 6 v C A' N
a nus en efpèces de cantates plufieurs de ces çhaf-
Mans petits poënies de Metaftafe, intitulés Can-
ronnette. Il les a compofées exprès pour les voix de
Pacchierotti, de Marchefi, de Rubinelli. On conçoit
aifément quelle doit être la perfeâion d’une
mufique de chambre faite par un pareil Maître,
& exécutée par de tels chanteurs.
On a donné auffi. en Italie le nom de cantates
à des ouvrages d’une étendue confidérable, accompagnés
d’un orcheftrç nombreux , exécutés dans
des fêtes publiques Si dans des occafions d’éclat.
A in fi, quand le Pape Ganganelli & le Roi de
Portugal fe furent reconciliés, en 177e ; Si quelque
temps après, lorfque l’emperçur Jofeph II arriva
à Venife , dans fon premier voyage én Italie , on
chanta à Venife. à Rome des cantates auffi
longues que des opéra. Ç ’étoient des poèmes com-
poles exprès, dialogues, entre plufieurs perfon-
nages, mais exécutés fans aâion, fans changement
dé fcènes, & feulement chantés comme les Oratorio.
Les cantates proprement dites ont été fort à
la mode en France, au commencement de notre
liècle. MontÇjdair , Campra , Mouret, Batiftin ,
& fur-tout Clérambaut, y excellèrent , & en ont
lai/Té des recueils oiT l ’on apperçoit, parmi les
défauts de çe temps où la mufique italienne
étoit inconnue en France, beaucoup d’art & de
eonnoiffance de l’harmonie, des chants affez heureux
, des baffes bien travaillées, & fur-tout des
récitatifs, où l’accent de la déclamation & lç génie
de la langue font parfaitement obfervés.
Quant aux poèmes de ces cantates , ils font
prefque toujours écrits avec facilité : plufieurs
même le font avec grâce, & quelques-uns avec
force. Mais' fi les cantates qui font en récit, &
les airs en 'maximes, font toujours froides & mau- j
v ai fe s , comme le dit J. J. Rouffeau, il y en a
bien pçu qui ne fpient comprifes dans cette fen- ,
tence. Celles même de J. B. Rouffeau n’en font
pas exceptées. Quelques-unes font pourtant des
chef-d’oeuvres de poéfie 8f de ftyle, mais prefque
toutes ont de très-grands défauts pour la mufique ,
Sir-tout dans la partie des airs. Les maximes galantes
qui les rempliffent d’ordinaire ne préfentent
au Muficien que de froids canevas. On me pardonnera
d’en citer quelques exemples.
Des trois airs que contient chacune de ces
cantates 5 il y en a toujours un en maximes, &
quelquefois deux , comme dans celles d’Adonis
oi de Thétis. Cette dernière efl charmante : l’idée
en eft ingénieufe; la partie du Trécit eft parfaitement
vérfifiée, Si prête aux effets du récitatif
obligé. Mais lorfquaprès s’être échauffé par degrés,
Je Muficien arrive aii fécond air, de quelle glace
n’eft-il pas faifi en lifant ces deux quatrains ?
Le guerrier qui délibéré
Fait mai fa cour au dieu Mars :
L’amant ne triomphe guèrq
g.’i.l n'affronte lçs hazards*
C A N
Quand le péril nous étonne;
NMmporrunons point les Dieux!
Vénus, ainfi que Bellone,
Aime les audacieux«
La cantate de C ir c é eft regardée, avec ration J
comme la plus belle de Rouffeau ; le premier
récitatif débute par une grande image où peut f<?
déployer toute l’imagination du compofiteur. li
finit par des vers pleins de fentiment, qui amènent
à merveille le premier a i f ,
Cruel auteur des troubles de mon asne :
dont on peut faire un beaip- morceau çl’expreffion,'
Le fécond récitatif eft d’un caractère tout différent
: Circé ceffe de fe plaindre.
Elle invoque à grands cris tous les Dieux du Ténare;
La nuit eft troublée, tous les élémens font
bouleverfés. Le Poète s’exprime en vers fubli-
mes j mais quoiqu’il ferve bien le Muficien ,
il lui donne une tâcjie affez difficile à remplir,
dans neuf grands vers alexandrins, tous à-peu«?
près de la même couleur , tous confacrés-à
peindre des effets phyfiques, & le renverfemenç
de la nature.
La difficulté redouble aux douze petits yers, clouî
il doit compo’fer un, air terrible.
Sa voix redoutable
Trouble les Enfers :
Vn bruit formidable
Gionde dans les airs ;
Un voile effroyable
Couvre l’univers:
La terre tremblante
Frémit de terreur :
Lfonde turbulente
Mugit de fureur :
La lune fanglante
Reculé d’horreur,
Quelle foule d’images! comrtient les rendre avec
le feu qu’elles exigent, & les renfermer toutes dans
un feul cadre régulier ? Mais le rhythme & l’harmonie
des vers, la rapidité du ftyle , & cette fuc-
ceffion même d’imagès effrayantes, allument le
génie, & doivent diéler un motif qui fe prête à
toutes ces rîuances de terreur ; le Muficien fuit le
Poète , il va même plus loin que lui, & s’il eft
vraiment né pour fon a r t, s’il en poffède tous les
fecrets , après avoir craint d’abord que Rouffeau
ne lui ait laiffé rien à dire, à mefüre qu’il avance
dans le développement de toutes les parties de
fon air, il fent qu’il ne tiendroit qu’à lui d’en
dire cent fois plus , Si que pour n’en pas dire
trop, il a befpin de commander à fa fougue. S’il
ne fent pas en; (pi cette heureufe furabond^nçe * A
C A K
hi fièvre ne le faifit pas, il peut laiffer là ce
morceau Si toute la cantate ; il eft incapable de
la rendre.
Mais quand il aura franchi ce pas dangereux ,
d’autres obfticles l'arrêteront peut-être, & ceux-
là le Poète auroit dit les lui épargner. Pour étonner
& pour effrayer, par des peintures accumulées
des effets de l’art magique, c’étoit bien allez d’un
récitatif de neuf grands vers , Si d’un air com-
pofé de douze vers rapides; voxilant terminer la
xantate par des images plus douces, cette nuance
nouvelle devoit être placée après l’a ir , pour que
le Muficien, ayant jetté toutes fes idées fombres,
pût délaffer par ce repos fon imagination fatiguée,
& avant de reprendre le pinceau , refaire
pour ainfi dire fa palette , & broyer de nouvelles
couleurs, C’eft ce que Rouffeau n’a pas fenti. A
ces peintures horribles il fait encore fuecéder l’horreur
; & par la manière dont il a conçu fa cantate,
le compofiteur , encore tout effouflé d’aVoir
exprimé les frémiffemens de la terre, les mügif-
femens de l’onde , le reculement des aftres , ne
peut encore s’arracher à ces objets funeftes. Il
eft attendu par ces fix vers qui exigent la même
vigueur, le même nerf, & malheureufement la
même couleur que les précédé ns :
Dans le fein de la mort fes noirs enchaïiteftiens
Vont troubler le repos des ombres ;
Les mânes effrayés quittent leurs menumens :
L’air retentit au loin de leurs longs hurlemens,
Er les vents, échappés de leurs cavernes fombres,
Mêlent à leurs clameurs d’horribles lifflemens.
C’eft alors feulement que les vapeurs noires fe
difïipent, que le Poète, par une; tranfition heu-
reuie, ,fait fuecéder à tout ce fracas infernal une
harmonie douce & touchante , Si qu’après avoir,
pendant' trop long-temps peut-être , peint les em-
portemens de la magicienne, il revient enfin aux
douleurs de l’amante :
Inutiles. efforts ! amante infortunée !
D’un Dieu plus fort que côi dépend ta deftinse, &c.
C’ eft alors feulement que le muficien peut refpi-
rer : cependant il' trouve encore ici deux vers qui
le forcent de reprendre la trompette infernale :
Tu peux faire trcnjbler la terre fous tes pas,
Des Enfers déchaînés allumer la colère.
Mais ce n’eft que pour un inftaht, Si s’ il a
«te ému comme il doit l ’être par ces mots fim-
ples & touchans : inutiles efforts! amante infortunée
! il doit fans peine , après ce dernier mou-
vement de terreur, donner l’expreffion convenable
aux deux derniers vers de récitatif, Si à l’air agréable
qui les ftiit.
C A N 207
Cet air eft en maximes, mais elles font exprimées
avec fentiment ; les fix derniers vers font
en images; l’expreffion en eft poétiqùf, hàrmo-
nieufe ; Quinault n’a rien fait de plus doux ni
de plus aimable.
Dans les champs que l’hiver défoie ;
Flore vient rétablir fa cour,
L’Alcyon fuie devant Eole,
Eole le fuit à fon tour *,
’ Mais fitôi que l’amour s’envole
U ne connoît plus de retour.
Par les difficultés que trouve un Muficien dans
la compofition de cette cantate, qui eft la meilleure
de Rouffeau, on peut juger de celles qu'il
doit trouver dans les autres. Un défaut qu’elles
ont prefque toutes, & qui leur eft commun avec
celle-ci, c’eft l’excèffive longueur. Les récitatifs,
ayant prefque toujours quelque chofe à peindre,
exigent non-feulement des âccompagnemens , mais
des ritournelles & des incifes, qui lient, qui annoncent
, qui préparent ; ce font enfin de grands récitatifs
'obligés , & l’on fait tout ce qu’exige aujourd’hui
cette partie intéreffante de la mufique. Les
airs , pour faire effet, doivent avoir une jufte
étendue ; & quand le Poète a tracé une grande
efquiffe , une efquiffe de douze vers, par exemple,
le Muficien ne pouvant , fans être fe c , froid ,
infignifiant, éviter des répétitions, des retours &
des développemens modérés du plan donné par
le Poète , ces airs font néceffairemeot longs, coupés
de divers mouvemens, Si contiennent encore
des reprifes inévitables , indiquées par le Poète
même.
Trois récitatifs & trois airs de cette étoffe font
donc en général beaucoup trop longs pour être
chantés de fuite. Circé a foixante-huit vers : c’eft
à'-peu-près la moitié des plus longs aéles d’opéra*
Deux récitatifs & deux airs paroîtroient donc devoir
fuffire ; & fi d’ailleurs, comme on n’en peut
douter, les meilleures cantates font celles oh. ,
dans une fituât ion vive & touchante , le pnncipal
perfonnage parle lui-même , fui va ru l’expreffion de
Rouffeau le philofophe, les cantates de Metaftafe ,
qui ont le double mérite de ce langage direél Si
de cette étendue modérée , font néceftairement plus
favorables à la mufique que celles de Rouffeau
le Poète.
Prefque toutes ces cantates , qui n’étoient que
les jeux du dernier grand Poète qu’ait eu l’ Italie,
roulent fur des fujets galans, gracieux, & quelquefois
paffionnés; c’ eft toujours le Poète qui parle
ou qui fait parler un perfonnage fuppofé.
Tantôt c’eft un amant qui vient de faire à fa
nubreffe un aveu dont elle eft irritée ; il s’exeufe
auprès d’elle avec adreffe, il l ’avertit que la colère
défigure fes traits. « T u ne me crois pas ,
! v lui dit-il; regarde-toi dans cette fontaine ; eft-il