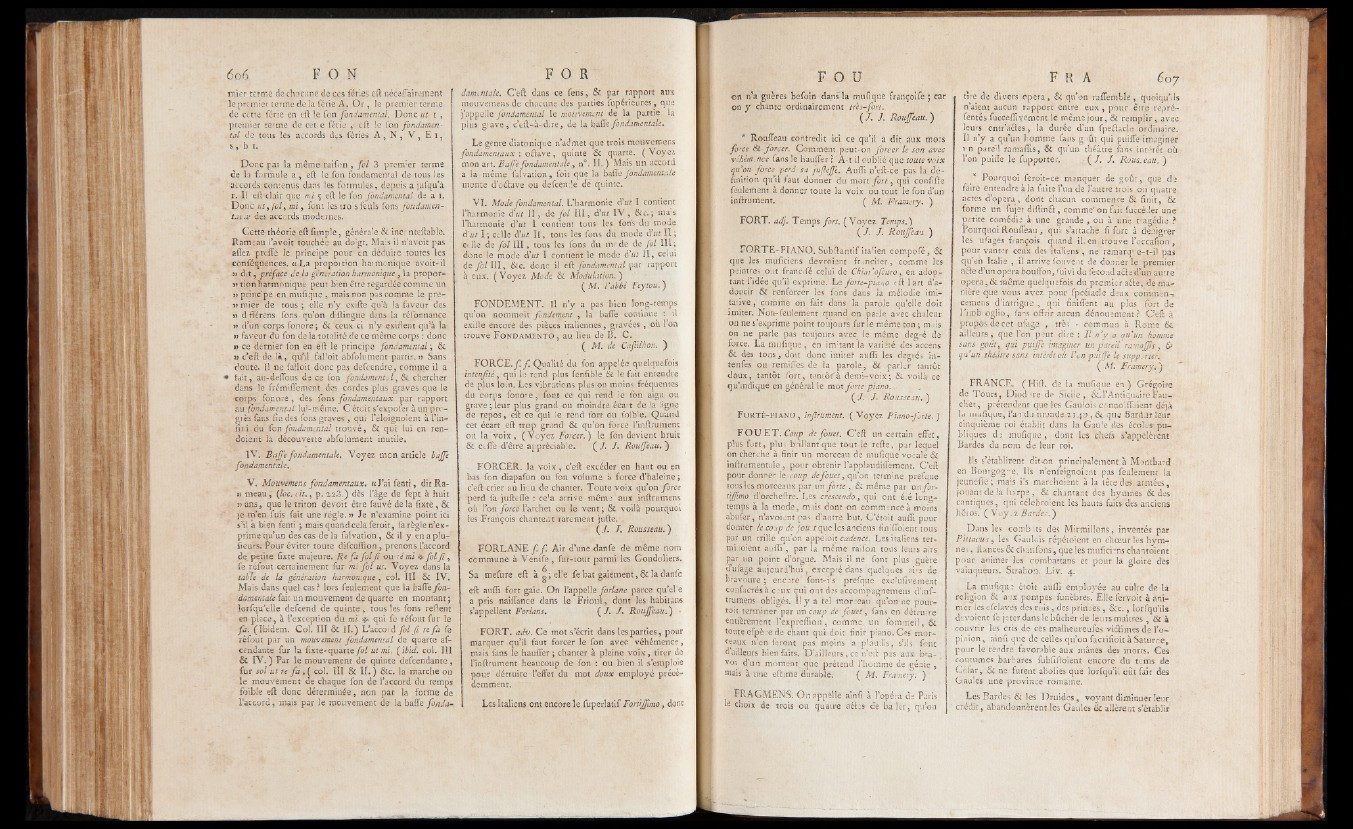
6o6 F O N
mier terme de chacune de ces'fériés eft nécefTairement
le premier terme de la lerie A. O r , le premier terme
de cette férié en eft le fon fondamental. Donc ut i ,
premier terme de cet:e férié , eft le fon fondamental
de tous les accords des fériés A , N , V , E l , .
s , b I.
Donc pat la même raifen , fol 3 premier terme
de la formule a , eft le fon fondamental de tous les
accords contenus dans les formules, depuis a jufqu’à
r. Il eft clair que mi 5 eft le fon fondamental de a 1.
Donc ut, Jolymi, font lestro stéuls fons fondamentaux
des accords modernes.
Cette- théorie eft fimple, générale & hier nteftable.
Ram; au l’a voit touchée au doigt. Mais il n’avoit pas
affez preffé le principe pour en déduire toutes les
conféquences. «La proportion hatmonique avoit-il
3; dit, préface de la génération harmonique , la propor-
33 tipn harmonique peut bien être regardée comme un
3î princ'pe en mufique, mais non pas comme le pre-
. 33 mier de tous ; elle n’y exifte qu’à la faveur des
33 d fférens fons- qu’on diftingue dans la réfonnance
33 d’un corps fonore; & ceux-ci n’y exiftent qu’à la
33 faveur du fon de la totalité de ce même corps : donc
33 ce dernier fon en eft le principe fondamental ; &
33 c’éft de là, qu’il falloit abfolument partir.>3 Sans
doute. Il ne falloit donc pas defeendre, comme il a
• fait, au-deflous de ce (on fondamental, & chercher
dans- le frémiffement des cordes plus graves que le
corpsJotîQre , des fons fondamentaux par rapport
au fondamental lui-m ême. C ’étoit s’expofer à un pre-
giès fans fin des fons graves', qui l’éloignoient à l’in-
firi du fon fondamental trouvé, & qui lui en ren-
doient la découverte abfolüment inutile.
IV. Baffe fondamentale. Voyez mon article bajfe
fondamentale,
V . Mouvemens fondamentaux. « J’ai fenti, dit Ra-
m m e a u (Idc. cil. , p. 2,28.) dès l’âge de fept à huit
» ans 3 que le triton devoir être fauve de la fixte, &
)e m’en fuis fait une règle. 33 Je n’examine point ici
s’il a bien fenti ; mais quand cela feroit, fajègle n’exprime
qu’un des cas de la falvation, & il y en a plusieurs.
Pour éviter toute difeuffion, prenons l’accord
de petite fixte majeure. Re fa fol f i ou rémi>& fol f i ,
fe réfout certainement fur ml fol ut. Voyez dans la
table de la génération harmonique , col. III & IV.
Mais dans quel cas ? lors feulement que la baffe fondamentale
fait un mouvement de quarte en montant ;
lorfqu’elle defeend de quinte, tous les fons reflent
en place, à l’exception du mi # qui fe réfout fur le
fa. (Ibidem. Col. III & II.) L’accord fo l f i re fa fe
rêfout par un mouvement fondamental de quarte af-
cendante fur la fixte-quarte fo l ut mi. ( ibid. col. III
& IV. ) Par le mouvement de quinte defeendante ,
fur sol utre f a , ( col. III & II. ) &c. la marche ou
le mouvement de chaque fon de l’accord du temps
foible eft donc déterminée, non par la forme de
l’accord, mais par le mouvement de la baffe fonda-
F O R
dqmcntale. C ’eft dans ce fens, & par rapport aux
mouvemens de chacune des parties ftipérieures, que
j’appelle fondamental le mouvement de la partie la
plus grave, c’eft-à-dire, de la haffe fondamentale.
Le genre diatonique n’admet que trois mouvemens
fondamentaux : o(Slave, quinte & quarte. (V oyez
mon art. Bajfe fondamentale^ n°. II. ) Mais un accord
a la même falvation, foit que la baffe fondamentale
monte d’oétaye ou defcende de quinte.
VI. Mode fondamental. L’harmonie d’ût I contient
l’harmonie d’ut I I , de fol III, d’ut I V , &c. ; maïs
l’harmonie d’wr I contient tous les fons du mode
d'ut I ; celle d’ut I I , tous les fons du mode d’ut II ;
et lie de fo l I I I , tous les fons du me de de yo/ 111 ;
donc le mode d’ut I contient le mode d’ut II, celui
de fol III, &c. donc il eft fondamental par rapport
à eux. (Voyez Mode & Modulation. )
( M. l’abbé Feytou.')
FONDEMENT. Il n’y a pas bien long-temps
qu’on nommoit fondement , la baffe continue : il
exifte encore des pièces italiennes, gravées , où l’on
trouve Fondamento, au lieu de B. C.
( M. de Caftilhon. )
FORCE, ƒ f . Qualité du fon appelée quelquefois
intenfité, qui le rend plus fenfible ët le fait entendre
de plus loin. I.es vibrations plus ou moins fréquentes
du corps fonore, font ce qui rend le fon aigu, ou
grave ; leur plus grand ou moindre écart de la ligne
de repos, eft.ee qui le rend fort on foible. Quand
cet écart eft trop grand & qu’on force l’inftrument
^ ou la v oix , (Voyez Forcer.') le fon devient bruit
& ceffe d’être appréciable. (.ƒ. /. Rouffeau. )
FORCER, .la v o ix , c’eft excéder en haut ou en
bas fon diapafon ou fon volume à force d’haleine ;
c’eft crier au lieu de chanter. Toute voix qu’on force
perd fa jufteffe : ce1a arrive même aux inftrumens
. où Ton force l’archet ou le vent; & voilà pourquoi
les François chantent rarement jufte..
(J . J. Rousseau.')
FORLANE f. f . Air d’une -danfe de même nom
commune à Venife , fur-tout parmi les Gondoliers.
Sa .mefure eft à g ; elle fe bat gaiement ,& la danfe
eft aufii fort gaie. On l’appelle forlane parce qu’el'e
a pris naiffance dans le Frioul, dont les habitant
s’appellent Forlans, ( /. /. Roujfeau. ) *
FORT. adv. Ce mot s’écrit dans les parties, pour
marquer qu’il faut forcer le fon avec- véhémence ,
triais, fans le hauffer; chanter à pleine voix , tirer de
l’inftrument beaucoup de fon : ou bien il s’emploie
pour détruire l’effet du mot doux employé précédemment.
I Les Italiens ont encore le fupedatif FortiJJîmo, dont
F O U
on n’a guères befoin dans"la mufique françoife ; car
on y chante ordinairement tr'es-fort.
( J. J. Roujfeau. )
* Rouffeau contredit ici ce qu’il a dît aux mors
force & forcer. Comment peut-on forcer le son avec
vèhém.nce fans le hauffer ? A-t-il oublié que toute voix
qu’on force perd sa jufiejfe. Audi n’eft-ce pas la définition
qu’il faut donner du mort fo r t, qui confifte
feulement à donner toute la voix ou tout le fon d’un
inftrument. ( M. Framery. )
FORT. adj. Temps fort. (Voyez Temps.)
( J. J. Roujfeau )
FORTE-PIANO. Subftantif italien compofé, &
que les muficiens devroient fr .nçiler, comme les
peintres ont francifé celui de Chiar’ofcuro, en adoptant
l’idée qu’il exprime.' Le forte-piano tft 1 art d’adoucir
& renforcer' les fons dans la mélodie imitative
, comme on fait dans la parole qu’elle doit
imiter. Non-feulement quand on parle avec chaleur
on ne s’exprime point toujours fur le même ton ; mais
on ne parle pas toujours avec le même deg'-é dé-
force. La mufique, en im-tant la variété des accens
& des tons 3 doit donc imiter suffi les degrés intentés
ou remiffes de la parole, & parler tantôt
doux, tantôt fort, tantôTà demi-voix; & voilà ce
qu’indique en général le mot forte piano.
( J. J. Rousseau. )
Forte- piano , tnfirument. ( Voyez Piano-forte. )
F O U E T . Coup de fouet. Cl eft. un certain effet,
plus fort, plu; brillant que toutffe refte, par lequel 1
on cherche à finir un morceau de mufique vocale &
inftru mentalepour obtenir l’applaudiffemenr. C’eft
pour donner l e coup de fouet, qu’on termine prefque
tous les morceaux par un forte , & même par wv\ fortijfimo
d orcheftre. Les crescendo, qui ont été longtemps
à la mode, mais dont on commence à moins
abufer, n’avoient pas d’autre but. C ’étoit auffi pour
donner le coup dé jou. t que les anciens finiffoient tous
par un trille qu’on appeloit cadence. Les italiens ter-
mhoient su ffi , par la même raifon tous leurs airs^
par un point d’orgue. Mais il ne font plus guère
dufage aujourd’hui, excepté dans quelques airs de
bravoure ; encore font-i's prefque exclusivement
confacrésà ceux qui ont des accompagnemens d’inf-
trumens obligés. Il y a tel morceau qu’on ne pour-
roit terminer par un coup de fouet, fans en détruire
entièrement l’expreffion, comme un fommeil, &
toute efpèce de chant qui doit finir piano. Ces morceaux
n’en feront pas, moins a-plaudis, s’ils font
d ailleurs bienfaits. D ’ailleurs, ce n’eft pas aux bravos
d’un moment que prétend l’homme de génie ,
mais à une eftime durable. f M. Framery. )
FRAGMENS. On appelle ainfi à l’opéra de Paris I
té choix de trois ou quatre aéhs de ba 1er, qu’on
F R A 607
tire de divers opéra, & qu’on raffetnble, quoiqu’ils
n’aient aucun rapport entre eux, pour être repré-
téntés fucceffiyement le même jour, & remplir , avec
leurs entr’aéles, la durée d’un fpeélacle ordinaire.
Il n’y a qu’un homme fans goût qui puiffe imaginer
un pare’d ramaffjs, & qu’un théâtre fans intérêt où
l’on puiffe le fupporter. - ( J. J . Rousseau. )
* Pourquoi feroit-ce manquer de goût, que dé
faire entendre à la fuite l’un de l’autre trois o u quatre
actes dopera, dont chacun commence & finit, &
forme un fujet diftinél, comme’ on fait fuccéder une
petite comédie à ujie grande , ou à une tragédie ?
Pourquoi Rouffeau , qui s’attache fi fort à dénigrer
les ufages françois quand il. en trouve l’eccafion ,
pour vanter ceux des italiens , ne remarque-t-il pas
qu’en Italie , il arrive fouve.it de donner le premier
àéte d’un opéra bouffon, fiuiyi du fécond a&e.d’un autre
opéra, & même quelquefois du premier aéle, de manière
que vous avez pour fpeâacle deux comment
cemens d’intrigue , qui finiffent au plus fort de
l ’imbroglio,' fans offrir aucun dénouement? C ’eft à
propos de cet ufage , très - commun à Rome &
ailleurs, que l’on peut dire : I l n’y a qu’un homme
sans goût,. qui puiffe imaginer un pareil ratnajfis, &
qu’un théâtre sans intérêt oit l ’on puiffe le supporter.
( M. Framery. )
FRANCE. (Hift. de la mufique en) Grégoire
de Tours, Diod <re de Sicile, l’AntiquaireFau-
chet, prétendent que les Gaulois connoiffoient déjà
la mufique, l’an du monde 2140 , & que Sardar leur
cinquième roi établit dans la Gaule des écoles publiques
d; mufique , dont les chefs s’appelèrent
Bardes du nom de leur roi.
Ils s’établirent dit-on principalement à Montbard
en Bourgogne. Ils n’enfeignoient pas feulement la
jeuneffe ; mais ils mardioient à la tête des armées,
jouant de la harpe, & chantant des hymnes & des
cantiques, qui célebroient les hauts faits des anciens
hëros. ( V o y . z Bardes. )
Dans les combits dès Mirmillons, inventés par
Pittacus, les Gaulois répétoient en choeur les hymnes
, fiances & chanfons, que les tnuficiens chantoient
pour animer les cornbattans et pour la gloire des
vainquéurs, Strabon. Liv. 4.
La mufique étbit auffi employée au cuire de la
religion & aux pompes funèbres. Elle fervoit à animer
les efclaves des rois, des princes, & c ., lorfqu’ils
dévoient fe jeter dans le bûcher de leurs maîtres , & à
couvrir les cris de ces malheureufes vi&imës de l’opinion,
ainfi que de celles qu’on facrifioit à Saturne,
pour le rendre favorable aux mânes des morts. Ces
coutumes barbares fubfiftoient encore du tems de
Céfar, & ne furent abolies que lorfqu’il eût fait des ^
Gaules une province romaine.
Les Bardes & les Druides , voyant diminuer leur
crédit, abandonnèrent les Gaules & allèrent s’établir