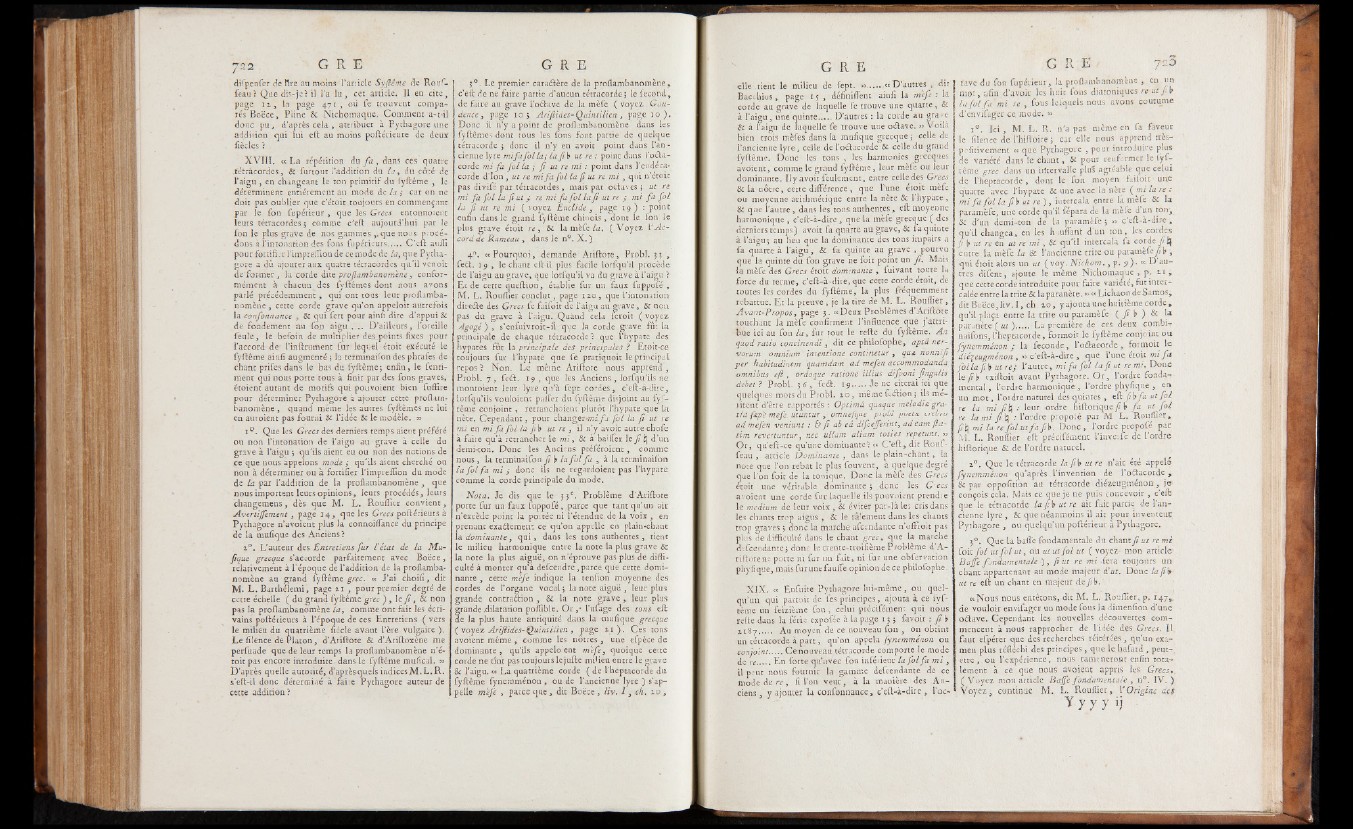
difpenfer de lire au moins 'Parsicle Syfiême de Rouf-
fe au ï Que dis-je ? il l'a lu , cet article. II en cite ,
page i z , la page 47 r , où fe trouvent comparés
Bo ë ce, Pline & Nichomaque. Comment a-t-il
donc p u , d’après cela , attribuer à Pythagore une
addition qui lui eft au moins poftérieure de deux
fiècles |
X V I I I . « La répétition du f a , dans ces quatre
.fétràcordes, & furtout l’addition du la, du côté de
l’a ig ii, en changeant le ton primitif du fyftême , le
déterminent entièrement au mode de La.; car on , ne
doit pas oublier que c’étoit. toujours en commençant
par le fon fupérieur , que les Grecs entonnoient
leurs tétracordes 5 comme c’eft aujourd’hui par le
fon le plus grave de nos gammes ,.q u e nous procédons
à l’intonation des fons fupéricurs...... C ’eft auflî
pour for ci fi.-r l’impreffion de ce mode de la, que Pythagore
a dû ajouter aux quatre tétracordes q u ’il venoit
de former , la corde dite proflambanomène, conformément
à chacun des fyftêmes dont nous avons
parlé précédemment, qui ont tous leur profhmba-
nomène, cette corde grave qu’on appeloit autrefois
la conformance , & qui fert pour ainfi dire d’appui &
de fondement au fon aigu . .. D ’ailleurs, l’oreille
feu le , le befoin de multiplier des points fixes pour
l’accord de l’inftrument fur lequel étoit exécuté le
fyftême ainfi augmenté ; la terminaifon des phrafes de
chant prifes dans le bas du fyftême; enfin, le fenti-
ment qui nous porte tous à finir par des fons graves,
étoient autant de motifs qui pouvoient bien fuffire
pour déterminer Pythagore à ajouter cette proflarn-
hanomène, quand même les autres fyftêmes ne lui
en auroient pas fourni & l’idée & le modèle. 33
i ° . Que les G rc« des derniers temps aient préféré
ou non l’intonation de l’aigu au grave à celle du
grave à l ’aigu ; qu’ils aient eu ou non des notions de
ce que nous appelons mode ; qu’ils aient cherché ou
non à déterminer ou à fortifier l’imprelfion du mode
de la par l’addition de la proflambanomène , que
nous importent leurs opinions, leurs procédés, leurs
changemens, dès que M. L . Roufiler convient,
Avertijfement, page 1 4 , que les Grecs poftérieurs à
Pythagore n’avoient plus la connoiflance du principe
de la mufique des Anciens?
z ° . L ’auteur des Entretiens fur l'état de la Mufique
grecque s’accorde parfaitement avec B oë ce,
relativement à l’époque de l’addition de la proflamba- ;
nomène au grand fyftême grec. « J’ai ch oifî, dit j
M . L . Barthélemi, page z i , pour premier degré de !
cette échelle ( du grand fyftême grec ) , 1 e f i , & non
pas la proflambanomène la, comme ont fait les écrivains
poftérieurs à l’époque de ces Entretiens ( vers
le milieu du quatrième fiècle avant l’ère vulgaire ).
L e filence de Platon , d’Ariftote & d’Ariftoxène me
perfuade que de leur temps la proflambanomène n’é-
toit pas encore introduite dans le fyftême mufical. 33
D ’après quelle autorité, d’après quels in d ic e sM .L .R .
s ’eft-il donc déterminé à faire Pythagore auteur de
cette addition 1
j j ° . Le premier cara&ère de la proflambanomène,
I c’eft de ne faire partie d’aucun tétracorde j le fécond,
de faire au grave l ’o&ave de la mèfe ( voyez Gau-
dente, page 1 0 ; Arifiides-Quintilien , page 1 0 ) .
Donc il h’y a point de proflambanomène dans les
fyftêmes dont tous les fons font partie de quelque
tétracorde ; donc il n’y en avoit point dans l’ancienne
lyre mif a f o l l a i l a fi b ut re : point dans l’octa-
corde mi f a f o l La ; f i ut re mi : point dans l’endéca-
corde d’io n , ut r e mi f a f o l l a fi ut re mi , q ui n’étoit
pas divifé par tétracordes, mais par octaves ; ut re
mi f a f o l l a f i ut y re mi f a f o l l a f i ut re y mi f a f o l
la f i ut re mi ( v o y e z Euclide , page 1 9 ) : point
enfin dans le grand fyftême chinois, dont le fon le
plus grave étoit re, & la mèfe la. .( V o y e z VAccord
de Rameau , dans le n°. X . )
40. « P ou rq u o i, demande A rifto te, Probl. 3 3
feét. if> , léchant cft-il plus facile lorfqu’il procède
de l’aigu au grave, que lorfqu’il va du grave à l’aigu ?
Et de cette queftion, établie fur un faux luppolé ,
M. L. Rouflier conclut, page 1 z o , que l’intonation
direéte des Grecs fe faifoit de l’aigu au g ra v e, & non
pas du grave à 1’aigu. jQuànd cela feroit ( voyez
Agogé) , s’enfuivroit-il "que la corde grave fût la
principale de chaque tétracorde ; que l’hypate des
hypates fût la principale des principales ? Etoit-ce
toujours fur l ’hypate que fe pratiquoit le principal
repos ? Non. L e même Ariftote nous apprend'",
Probl. 7 , feôfc. 19 , que les Anciens , lorfqu’ils ne
montoienc leur lyre qu’à fept cordes, c’eft-à-dire,
lorfqu’ils vouloienc paner du fyftême disjoint au fyftême
conjoint , retranchoient plutôt l’hypate que la
nète. Cependant, pour changervwîi/a fo l la fi ut re
mi en mi fa fo l la Ji h ut re , il n’y avoir autre chofe
à faire qu’à retrancher le mi, & à bai fier \e f i \ d ’un
demi-ton. Donc les Anciens préféroient, comme
nous, la terminaifon f i l> la fo l fa , à la terminaifon
la fo l fa mi ÿ donc ils ne regardoient pas l’hypate
comme la corde principale du mode.
Nota. Je dis que le 55e. Problème d’Ariftote
porte fur un faux fuppofé, , parce que tant qu’un air
n’excède point la portée ni l ’étendue, de la voix , en
prenant exactement ce qu’on appelle en plain-chant
la dominante, q ui , dans les tons authentes, tient
le milieu harmonique entre la note la plus grave &
la note la plus aiguë, on n'éprouve pas plus de difficulté
à monter qu’à defeendre,parce, que cette dominante
, cette mèfe indique la tenfion moyenne des
cordes de l’organe vocal ; la note a igu ë , leur plus
grande contra&ion , & la note g r a v e , leur plus
grande .dilatation poflible. O r ,* l’ufage des tons eft
de la plus haute antiquité dans la mufique grecque
(v o y e z Arifiides-Quintilien , page *1 ) . Ces tons
avoient même , comme les nôtre s, une efpèee de
dominante , qu’ils appeloient mèfe, quoique cette
corde ne tînt pas toujours le jufte mfiieu entre le grave
& l’aigu, ce La quatrième corde ( de l’heptacorde du
fyftême fynemménon , ou de l’ancienne lyre ) s’appelle
mèfe , parce q ue , dit Boë ce, liv. 1 , ch. io >
elle tient le milieu de fept. »3.......« D ’autres , dit
Bacchius, page 15 , définiflent ainfi la mèfe : la
corde au grave de laquelle fe trouve une quarte, &
à l’aigu, une quinte......D’autres : la corde au grave
& à l’aigu de laquelle fe trouve une otftave. 33 Voila
bien trois mèfes dans la mufique grecque ; celle de
l’ancienne ly re , celle de l’cxftacorde & celle du grand
fyftême. Donc les tons , les harmonies grecques
avoient, comme le grand fyftême, leur mèfe ou leur
dominante. Il y avoit feulement, entre celle des Grecs
& la nôtre, cette différence, que l’une étoit mèfe
ou moyenne arithmétique entre la nète & l’hypate ,
& que l’autre, dans les tons authentes, eft moyenne
harmonique , c’eft-à-dire, que la mèfe grecque ( des
derniers temps) avoit fa quarte au grave, & fa quinte
à l’aigu; au lieu que la dominante des tons impairs a
fa quarte à l'a ig u , & fa quinte au grave , pourvu
que la quinte du fon grave ne foit point un fi. Mais
la mèfe des Grecs étoit dominante , fuivant toute la
force du terme, c’eft-à-dire, que cette corde étoit, de
toutes les cordes du fyftême, la plus fréquemment
rebattue. E t la preuve, je la tire de M. L . Rouflier ,
Avant-Propos, page 3 . «Deux Problèmes d’Ariftote
touchant la mèfe confirment l ’ influence que j ’attribue
ici au fon la, fur tout le refte du fyftême. An
quod ratio concinendi , dit ce philofophe, apta ner-.
vorum omnium intentione continetur, que, nonnifi
per habitudinem quamdam ad mefen accommodanda
omnibus e(l, ordoque ratione illius difponi fingulis
debet ? Probl. 3 6 , fc<ft. 19...... Je ne citerai ici que
quelques mots du Probl. zo , même ferftion ; ils mentent
d 'être rapportés: Optimâ qu&que mélodie gra-
tià fepè me fi. utuntur , omnefque probi poete crebro
ad mefen veniunt : & f i ab eâ difcejferint, adeam fia-
tim revertuntur, nec ullam allant toties répétant. 33
O r , qu’eft-ce qu’une dominante? « C ’e f t , dit Rouf-
feau , article Dominante , dans le plain-chant, la
note que l’on rebat le plus Couvent, à quelque degré
que l’on foit de la tonique. Donc la mèfe des Grecs
étoit une véritable dominante ; donc les G ’ecs
avoient une corde fur laquelle ils pouvoient prend:e
le medium de leur voix , & éviter par-là les cris dans
les chants trop aigus , & le râlement dans les chants
trop graves ; donc la marche afeendante n’offroit pas
plus de difficulté dans le chant grec, que la marche
descendante ; donc le trente-troifième Problème d’A -
r i flore n-.: porte ni fur un fait, ni fut une obfervation
phyfîque, mais furunefaufie opinion de ce philofophe.
X IX . « Enfuite Pythagore lui-même, ou quelqu’un
qui partoit de fes principes, ajouta à ce fy f tême
un feizième fon , celui précifément qui nous
refte dans la férié expofée à la page 13 ; favoir : f i b
x i 87...... Au moyen de ce nouveau fon , on obtint
un tétracorde à pa rt, qu’on appela fynemménon ou
conjoint..... Cenouveau tétracorde comporte le mode
de re......En forte qu’avec fon inférieur la fo l fa mi ,
il peut nous fournir la gamme defeendante de ce
mode de re, fi l’on v eu t, à la manière des An ciens
, y ajouter la confonnançe, c’ çft-à-dire , i’oc»
Cave du fon fupérieur, la proflambanomène , en un
m o t, afin d’avoir les huit fons diatoniques re ut f
la fo l fa mi re , fous lefquels nous avons coutume
d’envifager ce, mode. »3
i ° . I c i , M . L. R. n’a pas même en fa faveur
le filence de l’hiftoire ; car elle nous apprend très-
prfitivement « que Pythagore , pour introduire plus
de variété dans le ch an t, & pour renfermer le fyftême
grec dans un intervalle plus agréable que celui
de l’heptacorde, dont le fon moyen faifoit une
quarte avec l’hypate & une avec’ la nète (mi la re :
mi fa fol la fib ut re) , intercala entre la mèfe & la
paramèfe, une corde qu’il fépara de la mèfe d un ton;,
& d’un demi-ton de la paramèfe ; » c eft-à-dire ,
qu’il changea, en les h-iuflant d un ton , les cordes
; fi b ut re en ut re mi , & qu’ il intercala la corde fi
i entre la mèfe la & l'ancienne trite ou paramèfe fi h;
| qui étoit alors un ut ( voy. Nichom., p. 9)- cc D au-
I tires difent, ajoute le même Nichomaque , p. z i ,
que cette corde introduite pour faire variété, fut intercalée
entre la trite & la paranèce. 3? cc Lichaon de Sarnos,
dit Beëce, liv. I , ch. z o , y ajouta une huitième corde,
qu’il plaça entre la trite ou paramèfe ( fi \> ) & [a
par.inète ( u t)...... La première de ces deux combinaifons,
l’heptacorde, formoit le fyftême conjoint ou
fynemménon y la fécondé, l’oda eo rde, formoit le
dié^eugménon , 33 c’eft-à-dire, que l’une, étoit mi fa
folia fi b ut rej l’ autre, mi fa fo l la f i ut re mi. Donc
le y? b exiftoit avant Pythagore. O r , l’ordre fonda-*
mental , l’ordre harmonique, l’ordre phyfîque , en
un m o t , l’ordre naturel des quintes , eft fi\>fa ut fo l
re la mi f i lj : leur ordre hiftorique fi \> fa ut fo l
re la mi f i fcj : l’ordre proposé par M L . Rouflier,
mi la re fo l ut fa fi}>. Donc , l’ordre propofé par
M. L . Rouflier eft précifément l’inveife de l’ordre
hiftorique & de l’ordre naturel.
z ° . Que le tétracorde làfi\> utre n’ait été appelé
fynemménon qu’après . l’invention de l’odacorde ,
& par oppofition au tétracorde diézeugménon , je'
conçois cela. Mais ce que je ne puis concevoir , c’eft
que le tétracorde la fi |> ut re ait fait partie de l’ancienne
lyre , & que néanmoins il air pour inv-enteuc
Pythagore , ou quelqu’un poftérieur à Pythagore.
30. Que la baflè fondamentale du chant f i ut re mi
foit fo l ut fo l ut, ou ut ut fo l ut ( voyez- mon article
Baffe fondamentale ) , fi ut re mi- fera toujours un
chant appartenant au mode majeur d'ut. Donc la fi k
ut re eft un chant en majeur de fi 1?.
«N ou s nous entêtons, dit M . L. Rouflier, p. 147,.
de vouloir envifager un mode fous la dimenfion d’une
o&ave. Cependant les nouvelles découvertes commencent
à nous rapprocher de 1 idée des Grecs. II
faut efpérèr que des recherches réitérées, qu’un examen
plus réfléchi des principes , que le hafard, peut-?,
être, ou l’expérience, nous ramèneront enfin tota^
lement à ce que nous avaient appris les Grecs,.
( V o y e z mon article Baffe fondamentale , n°. IV. )
V o y e z , continue M . L. Rouflier, l3Origine des
Y y 7 y ij