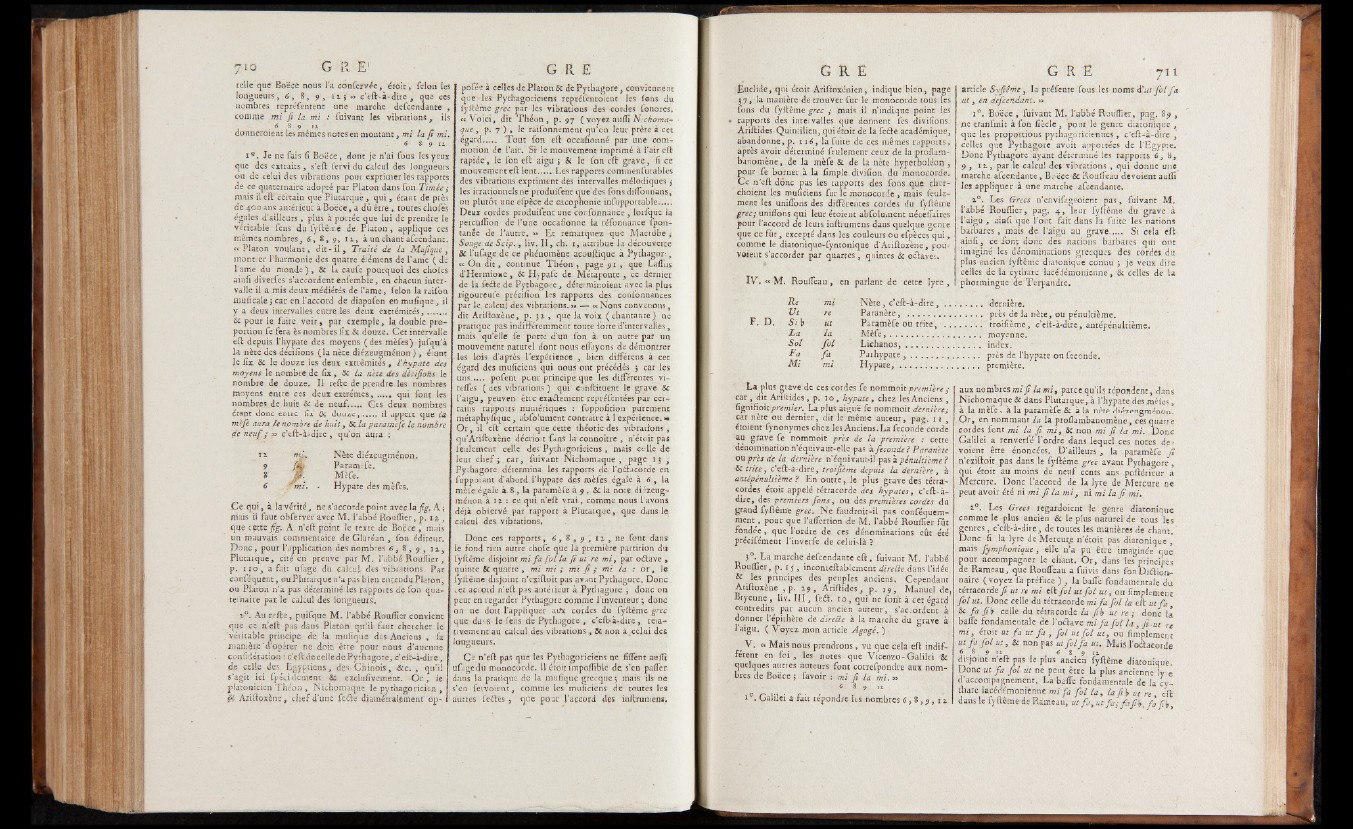
telle que Boëce nous l’a confervée, étoit, félon les
longueurs, 6 , 8', 9 , î t > » c’eft'-à-dire , que ces
nombres repréfentent une marche defeenaante ,
comme mi fi ta mi : fuivant les vibrations, ils
1 ~ 6 8 9 11
donneroient les mêmes notes en montant , mi la fi mi.
6 i 9 11
i Q. Je ne fais fi Boëce, dont je n’ài fous les yeux
que des extraits , s’eft fervi du calcul des longueurs
ou de celui des vibrations pour exprimer les rapports
de ce quaternaire adopté par Platon dans fon Tintée ; •
mais il eSfeeîtain que Plutarque , q u i, étant de près
de 400 ans antérieur à Boëce, a dû être, toutes chofe"s
égales d’ailleurs , plus à portée que lui de prendre le
véritable feus du fyftêaié de Platon, applique ces j
mêmes nombres, £, S, 9, jx , à un chant afeendant.
«Platon voulant, d i t - i l , Traité de la Mufique ,
montrer l’harmonie des quatre éièmens de lame ( de
l ame du monde ) , & la caufe pourquoi des choies
giufi diverfes s’accordent enfembie, en chacun intervalle
il a mis deux médiétés de l’ame, félon la raifon
muficalejcar en l’accord de diapafon en mufique, il
y a deux intervalles entre les deux extrémités,........
8c pour le faire voir, par exemple, la double proportion
fe fera ès nombres fix & douze. Cet intervalle
eft depuis l’hypate des moyens (des mèfes) jufqu’à
la nète des décifions (la nète diézeugménon ) , étant
le fix 8c le douze les deux extrémités , Vhypate des
moyens le nombre de fix , & la nète des décifiohs le
nombre de dpuze. I l refte. de prendre, les nombres
moyens entre ces deux extrêmes,..... qui font les
nombres.de huit & de neuf..... Ces. deux nombres
étant donc entre fix & douze...... il appert que la
méfie aura le nombre de huit, 8c.U1 paramefie le nombre
dç neuf y » ç?eft-à-dire, qu’on aura ;
n
9
8
6
ml.
# 3p.
Wmm.
Nète diézeugménon.
paranufe.
Mèfe. "
Hypate des mèfes.
Ce qui, à la vérité , ne s’accorde point avec la fig, A ;
niais Ü faut obferyer avec M . l’abbé Rouffier, p. 1% ,
que cette fig. A n’eft point le texte de Boëce, mais
un mauvais commentaire de Glaréan , fon éditeur.
Donc, pour l’application des nombres 6 , 8, 9 , ix ,
Plutarque, cite en preuve par M . l’abbé Rouffier,
p i 110 , a fait ufage du calcul des vibrations. Par
conféquent, oüPlutarquen’a pas bien enç.enduPlaton,
pu Platon n’à pas déterminé les rapports de fon qua*-
ternaire paç le calcul des longueurs.
v°. Au refte, puifqüe M . l’abbé Rouffier convient
que ce n’eft pas dans Platon: qu’il faut chercher lé
véritable principe de la. mufîqüe des Anciens , fa
manière a opérer ne doit être pour nous d’aucune
confidération ; c’eft de celle de Pythagore, c’ efh-à-dire,
de celle des. Egyptiens, des Chinois, &c. , qu’il
s’agit ici fpécidément 8c exclufîvemént. O r , le
platonicien Théon , Nichomaque le pythagoricien , |
Ariftoxène, ch e f d’une feéfe diamétralement op- i
pofée à celles de Platon 8c de Pythagore, conviennent
que les Pythagoriciens repréfentoient les fons du
fyftême grec par les vibrations des cordes fonores.
« Voici, dit Théon, p. 97 ( voyez aufli Nichoma^
que , p. 7 ) , le raifonnement qli’pn leur prête à cet
égard..... Tout fon eft occafionné par une commotion
de l’air. Si-le mouvement imprimé a l’air eft
rapide, le fon eft aigu î Si le fon eft grave, fi cc
mouvement eft lent......Les rapports commenfurables
des vibrations expriment des intervalles mélodiques3
les irrationnels ne produifent que des fons diflonnans,
ou plutôt une efpècc de cacophonie infupportable.....
Deux cordes produifent une confonnance , iorfque la
percüffïon de l’une occafionné la réfonnanee fpon-
tanëc de l’autre. » Et remarquez que Macrqbe *
Songe de Scip., liv. I I , ch. 1, attribue la découverte
8c l’ufage de ce phénomène acouftique à Pythagor-,
« On d it , continue Théon , page 91 , que Laflus
d’Hermioae, & Hypafe de Métaponte , ce dernier
de la feéte de Pythagore, dérerminpienr avec la plus
rigoureule préeifion les rapports des coûfônnances
par le,calcul des vibrations.» — «Nous convenons,
dit Àriftoxène, p. 32. , que la voix (chantante) ne
pratique pas indifféremment toute forte d’intervalies,
mais qu’elle fe porte d’un fon à. un autre par un
mouvement naturel dont nous eflayons de démontrer
les lois d’après l ’expétience , bien differens à cet
égard des mufîciens qui nous ont précédés 5 car les
uns...... pofent peur principe que les. différentes viteffes
( des vibrations ) qui conftituent le grave &
l’aigu, peuvenr être exactement repréfentées par certains
rapports numériques : fuppofition purement
métaphyfique, abfolument contraire à l expérience. «•
O r , il eft certain que cette théorie des vibrations,
qu’Ariftoxène décrioit fans la connoître , n’éteit pas
feulement celle des Pythagoriciens , mais celle de
leur ch ef >_çar, fuivant Nichomaque , page 13 ,
Pythagore détermina les rapports de l’oétaçorde en
fuppoiant d’abord l’hypate des mèfes égale à 6 , la
mêle égale à. 8 , la paramèfe à 9 , 8c la note, diézeug-
ménon à i?. : ce qui n’eft v r a i, comme nous lavons
déjà oblervé par rapport à Plutarque, que dans le
calcul des vibrations,
Donc ces rapports , 6 , 8^ 9 , i z , ne font dans
le fond rien autre chofe que la première partirion du
! fyftême disjoint mi fa fo l la f i ut re mi, par oétave ,
1 quinte 8c quarte , mi mi ; mi f i y mi la : ôr , le
! lyllêine disjoint n’exiftoit pas avant Pythagore. Donc.
! cçt accord n’eft pas antérieur à. Pythagore ; donc on
J peut en regarder Pythagprc comme l’inyenteur ; donc
! on ne doit l’appliquer at?x cordes du fÿftême grec
j que dars le feus de Pythagore , c’efbà^dire , relativement
au çalcul dçs vibrations , 8ç non à..celui des
longueurs.
Ç è n’eft pas que les Pythagoriciens ne fîfleftt auffi
ufage du monocorde. 11 éroij impoffible de s’en paffer
dans la pratique de la mufique grecque j mais ils ne
s’en fervoienc, comme les muficiens de toutes les
auties fe<ftès, que pour façcord des inftrumens,.
Eucîide^ qui étoit Ariftoxénien, indique bien, page
37, la manière de trouver fur le monocorde tous les
fons du fyftême grec y mais il n’indique point les
rapports des intervalles que donnent fes divifions,
Ariftides-Quintilicn, qui étoit de la feéfe académique,
abandonne, p. 116, la fuite de ces mêmes rapports,
après avoir déterminé feulement ceux de la proflam-
banomène, de la mèfe & de la nète hyperboléon ,
pour fe borner à la fimple divifion du monocorde.
Ce n’eft donc pas les rapports des fons que cher-
choient les muficiens furlemonocor.de, mais feulement
les unifions des différentes cordes du fyftême
grec; unifions qui leur étoient abfolument nécelîaires
pour l’accord de leurs inftrumens dans quelque genre
que ce fût, excepté dans les couleurs ou efpèccs qui ,
comme le diatonique-fyntonique d’Ariftoxène, pouvaient
s’accorder par quartes , quintes & oélaves.
IV . « M. Rondeau, en parlant de cette lyre ,
article Syfiême , la préfente fous les noms d'ut fo l fia
ut, en défieendant. »
i ° . Boëce , fuivant M. l’abbé Rouffier, pag. 89 ,
jie-tranfmit à fon fiècie, pour le genre diatonique ,
que les proportions pythagoriciennes , c’eft-a-dire ,
celles que Pythagore avoir apportées de l’Egypte.
Donc Pythagore ayant déterminé les rapports 6,8,
9 , i x , par le calcul des vibrations , qui donne une
marche afeendante, Boëce & Roulfeaü dévoient aufli
les appliquer à une marche afeendante.
x°. Les Grecs n’envifageoient pas, fuivant M.
I’abbé Rouffier, pag. 4 , leur fyftême du grave à
l ’aigu , aiufî que l’ont fait dans la fuite les nations
barbares , mais de l ’aigu au grave..... Si cela eft
airifi, ce fonç donc des nations barbares qui ont
imaginé les dénominations grecques des cordes du
plus ancien fyftême diatonique connu 5 je veux dire
celles de la cytbare lacédémohitnne, 8c celles de la
phormingue de Terpandrc.
Re mi
Ut re
S i 1» ut
La la
Sol fo l
Fa n Mi mi
N è t e , c’eft-à-dire, ...........dernière.
Paranète, .................................... près de la nète, ou pénultième.
Paramèfe ou trite, .................. troifième, c’eft-à-dire, antépénultième.
M è fe , . ......................... | .......... .. moyenne.
Lichanos, .................................... index.
Parhypate ................ près de l’hypate ou fécondé.
H y p a t e , ...................................... première.
L a plus grave de ces cordes fe nommoit première y
c a r , dit Arillides, p. 10 , hypate, chez les Anciens ,
fignifioit premier. La plus aiguë fe nommoit dernière;
car nète ou dèrnier, dit le même auteur, pag. 11 ,
étoient fynonymes chez les Anciens. La fécondé cordc
au grave fe nommoit près de la première : cette
•dénomination n’équivaut-ellepas à fécondé? Paranète
ou près de la dernière n’équivaut-il pas à pénultième ?
8c trite, c’eft-à-dire, troifième depuis la dernière, à
antépénultième? En outre, le plus grave des tétra-
cordes étoit appelé tétracorde des hypâtes, c’eft- à-
dire, des premiers fions, ou des premières cordes du
grand fyftême grec. N e faudroit-il pas conféquem-
men t, pour que l’aflertion de M . l’abbé Rouffier fût
fondée, que l’ordre de ces dénominations eût été
précifément l ’inverfe de celui-là ?
3°. La marche defeendante e f t , fuivant M . l’abbé
Rouffier, p. 15 , inconteftabiement directe dans l’idée
& les principes des peuples anciens. Cependant
Ariftoxène , p. 1 9 , A riftides , p. 1 9 , Manuel de,
Bryenne , liv. I I I , feéfc. 10 , qui ne font à cet égard
contredits par aucun ancien auteur, s’accordent à
donner l’épithète de directe à la marche du grave à
l’aigu. ( V o y e z mon article Agogé. )
f V . « Mais nous prendrons, vu que cela eft indiffèrent
en foi , les notes que V icen zo-G alilei &
quelques auties auteurs font correfpondre aux nombres
de Boëce $ favoir : mi f i la mi. »
6 .8 9 11
Galilei a fait répondre les nombres 6 , 8 , 9 , 1 1
aux nombres mi f i la mi, parce qu’ils répondent, dans
Nichomaque & dans Plutarque, à l’hypate des mèfes,
à la mèfe, à la paramèfe.& à la nète diézeugménôn.
O r , en nommant La la proflambanomène, ces quatre
cordes font mi la f i mi, 8c non mi f i la mi. Donc
Galilei a renverfé l ’ordre dans lequel ces notes dévoient
être énoncées. D ’ailleurs, la paramèfe f i
n’exiftoit pas dans le fyftême grec avant Pythagore,
qui étoit au moins de neuf cents ans poftérieur à
Mercure. Donc l’accord de la lyre de Mercure ne
peut avoir été ni mi f i la mi, ni mi la f i mi.
i ° . Les Grecs regardoient le genre diatonique
comme le plus ancien & le plus naturel de tous les
genres, c’eft-à-dire, de toutes les manières de chant.
Donc fi la lyre de Mercur.e n’étoit pas diatonique
mais fiymphonique, elle n’a pu être imaginée que
pour accompagner le cftant. O r , dans les principes
de Rameau, que Roufleau a fuivis dans fonDnftion-
naire (v o y e z fa préface) , la baffe fondamentale du
tétracorde f i ut re mi eft fo l ut fo l ut, ou Amplement
fo l ut. Donc celle du tétracorde mi fa fo l la eft Ut fia,
& fa fib celle du tétracorde la fi b ut re ; donc la
baffe fondamentale de l’od a ve mi fa fo l la , fi. ut re
mi 3 étoit ut fa ut fia , fo l ut fo l ut, ou Amplement
ut fa fo l ut, & non pas ut fo l fia ut. Mais l’o&acorde
J. A 9 11 6 8 9 12
disjoint n’eft pas le plus ancien fyftême diatonique.
Donc ut fa fo l tk ne peut être la plus ancienne I y e
d'accompagnement. La'feaffe fondamentale de la cy-
thare lacédemonienne mi fa fo l la, lafi\> ut re , eft
dans le fyftême de Rameau, ut fa , utfa;fafi\,, faßt,