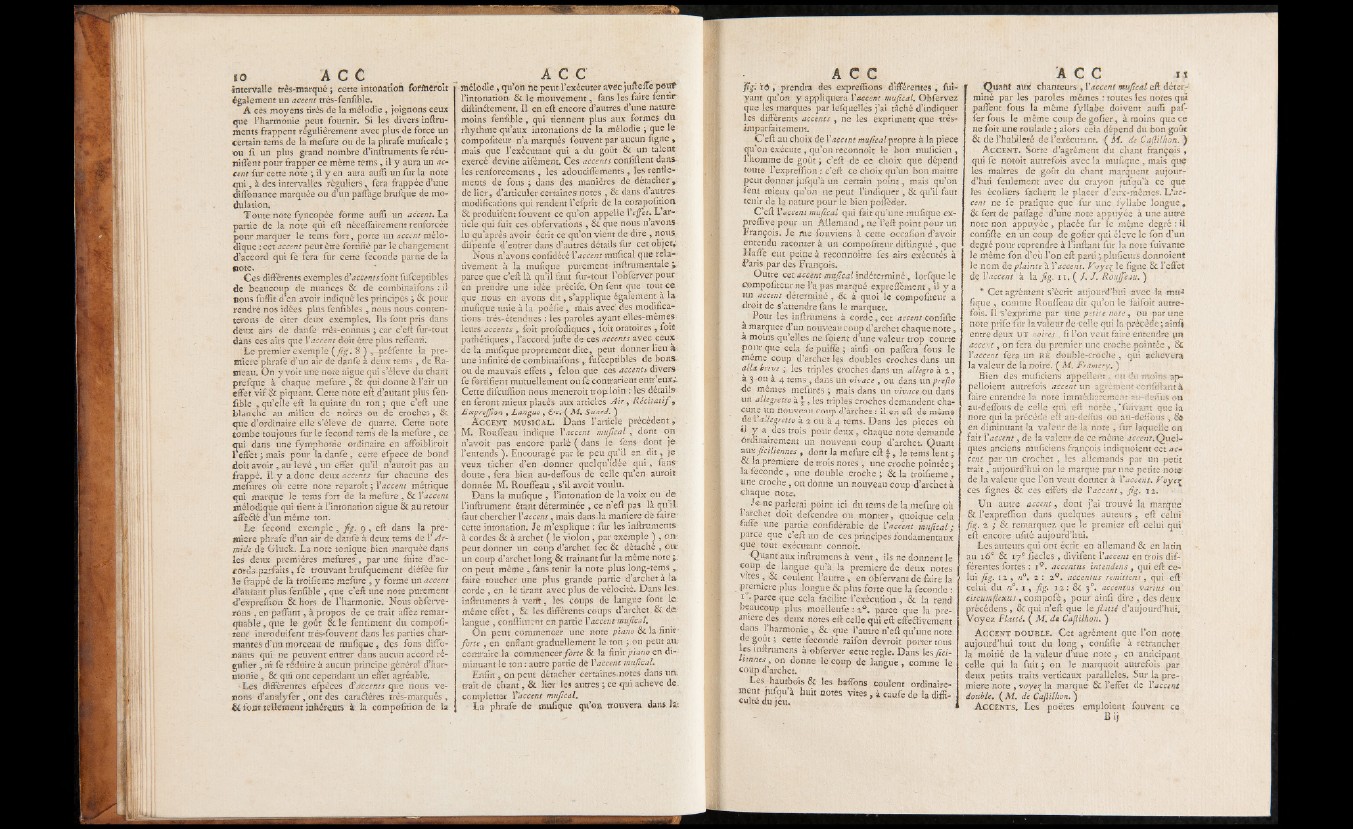
io A C C
■ intervalle très-marqué ; cette intonation fofftièroit
également un accent très-fenfible.
A ces moyens tirés de la mélodie , joignons ceux
que l’harmonie peut fournir. Si les divers inftru-
ments frappent régulièrement avec plus de force un
certain tems de la mefure ou de la phrafe mufical e ;
ou fi un plus grand nombre d’inftruments fe réunifient
pour frapper ce même tems , il y aura un accent
fur cette note il y en aura aufîi un fur la note
q u i, à des intervalles régu liers fera frappée d’une
difronanee marquée ou dun paflage brufque de modulation.
Toute note fyncopée forme aufîi un accent. La
partie de la note qui eft néceffairement renforcée
pour marquer le tems fort, porte un accent mélodique
: cet accent peut être fortifié par le changement
d’accord qui fe fera fur cette, fécondé partie de la
note.
Ces différents exemples accents font fufceptibles
de beaucoup de nuances & de combinaifons : il
nous fuffit d en avoir indiqué les principes ; & pour
rendre nos idées plus fenübles , nous nous contenterons
de citer deux exemples. Ils font pris dans
deux airs de danfe très-connus ; car e’eft fur-tout
dans Ces airs que Y accent doit être plus refrenti;
Le premier exemple {fig- 8 )-, préfente la première
phrafe d’un air de danfe à deux tems , de Rameau.
On y voit une note aigue qui s’élève du chant
prefque à chaque mefure,. 8c qui donne à l’air un
effet v if 6c piquant. Cette note eft d’autant plus fèn-
fible qu’elle eft la quinte du ton; que e’eft une
blanche au milieu de noires ou de croches, 8c
que d’ordinaire elle s’élève de quarte. Cette note
tombe toujours fur le fécond tems de la mefure , ce
qui dans une fÿmphome ordinaire en affoibliroit
F effet ; mais pour la danfe , cette efpece de bond
doit avoir au levé , un effet qu’il n’auroit pas au
frappé. II. y a. donc deux accents fur chacune des
mefures ou cette note réparent ; Y accent métrique
qui marque le tems fort de la mefure , & Y accent
mélodique qui tient: à ^intonation aigue & au retour
affeéié d’un même ton.
Le fécond exemple, fig. 9 , eft dans la premier
e phrafe d’un air de damé à deux tems de l’ Ar-
mide de Gluck. La note tonique bien marquée dans
les deux premières mefures, par une fuite d’ac-
coruS.parfaits, fe trouvant brufquement diéfée fur
le- frappé de la troifleme mefure , y forme un accent
d’autant plus fènfible , que c ’eft une note purement
d ’expreffron 8c. hors de l’harmonie. Nousobfeive-
rôns , enpaffant, à propos de ce trait affez remarquable
, que le goût ©c le fentiment du compofiteur
introduifent très-fouverrt dans les parties charmantes
d’un morceau de mufique, des fons difro-
nants qui ne peuvent entrer dans aucun accord régulier
, ni. fe réduire à aucun principe général d’harmonie
, 8c qui ont cependant un effet agréable.
Les différentes efpêces YY accents que nous venons
d’analyfer , ont des caractères très-marqués ,
& font tellement inhérents à la compofition de la
A C C
mélodie, qu’on ne peut l’exécuter avec juftefre petîf
l’intonation 8c le mouvement, fans les faire fentir
diftinfrement. Il en eft encore d’autres d’une nature,
moins fenfible, qui tiennent plus aux formes du
rhythme qu’aux intonations de la mélodie ; que le
compofiteur n’a marqués fouvent par aucun figne ,
mais que l’exécutant qui a du goût 8c un talent
exercé devine aifément. Ces accents confiftent dans-
les renforcements , les adouciffements , les renfle-?
ments de fons ; dans des manières de détacher »-
de lier, d’articuler certaines notes , 8c dans d’autres-
modifications qui rendent l’efprit dè la compofition
8c produifent fouvent ce qu’on appelle Y effet. L’article
qui fuit ces. obfervations , 8c que nous n’avons
lu qu’après avoir écrit ce qu’on vient de dire , nous,
difpenle d’entrer dans d’autres détails fur cet objet*'
Nous n’avons confidéré Y accent mufical que relativement
à la mufique purement inftrumentale ;
parce que c’eft là qu’il faut fur-tout l’obférver pour
en prendre une idée précife. Gn fent que tout ce.
que nous en avons dit§ s’applique également à la
mufique unie à la poéfie , mais avec des modifications
très-étendues : les paroles ayant elles-mêmes.
leurs accents * foit profodiques , foit oratoires , foit
pathétiques-, l’accord jiifte de ces accents avec ceux
de la mufique proprement dite, peut donner lieu à .
une infinité de combinaifons;,. fufceptibles de bons,
ou de mauvais effets , félon que ces accents divers
fe fortifient mutuellement oufe contrarient entr’euxi.
Cette difcufîion nous meneroit trop, loin :• les détails
en feront mieux placés aux articles A ir , Récitatif,
Exprejjion , Langue , &c,-{ M . Suard. )
■ Accent musical. Dans l’article précédent.,'
M. Rouffeau indique Y accent mufical , dont on
n’avoit pas encore parlé ( dans le fens- dont je
l’entends ). Encouragé par le peu qu’il en, d it, je
veux tâcher d’en -donner quelqn’idée qui , fans-
doute , fera bien au-deffous de celle qu’en auroit
donnée M. Rouffeau , s’il avoit voulu.
Dans la mufique , l’intonation de la voix ou de
l’inftniment étant déterminée , ce n’eft pas là qu’il,
faut chercher Y accent, mais dans la maniéré défaire’
cette intonation. Je m’explique : fur les infiniment»
à cordes & à archet ( le violon, par exemple ) ,012:
peut donner un coup d’archet fec 8c détaché , ou.
un coup d’archet long 8c traînant fiir la même note ;
on peut même, fans tenir la note plus long-tems ,,
faire toucher une plus grande partie 'd’archet à la
corde , en le tirant avec plus de. vélocité. Dans les.
inftruments à v en t, les coups dé langue font le:
même effet, 8c les différents coups d’archet 8c. de-
langue , çonftitu^nt en partie Y accent mufical.
On peut commencer une note piano 8c la finir
forte , en enflant graduellement le ton ;.on peut au;;
contraire la commencer forte & la finir piano en d i minuant
le ton : autre partie dè Y accent mufical.
Enfin , on peut détacher certaines,notes dans un.
trait de chant, 8c lier les autres ; ce qui achevé de.
completter Ydcctnt mufical.
La phrafe de mufique qu’on trouvera dans ! *
A C C
f l g. '16, prendra des exprefîions différentes , fuî-
yant qu’on y appliquera Y accent mufical. Obfervez
que les marques par lefquelles j’ai tâché d’indiquer
les différents accents , ne les expriment que très-
imparfaitement.
C ’eft au choix de Y accent mufical propre à la piece
qu’on exécute, qu’on reconnoît le bon muficien ,
l ’homme de goût ; c’eft de ce choix que dépend
toute l’expreflion : c’eft ce choix qu’un bon maître
jïeut donner, jufqu’à un certain point, mais qu’on
lent mieux qu’on ne peut l’indiquer , 8c qu’il faut
tenir de la nature pour le bien pofTèder.
C ’eft r 'accent mufical qui fait qu’une mufique ex-
preffive pour un Allemand, ne i’eft point pour un
François. Je me fouviens à cette occafion d’avoir
entendu raconter à un compofiteur diftingué , que
Haflè eut peine à reconnoître fes airs exécutés à
Paris par des François.
Outre cet accent mufical indéterminé, lorfque le
compofiteur ne Tu pas marqué expreffément, il y a
un accent déterminé , 8c à quoi le compofiteur a
droit de s’attendre fans le marquer.
Pour les inftriimens à corde, cet accent confifte
à marquer d’un nouveau coup d’archet chaque note,
-a moins qu’elles ne fpient d’une valeur trop courte
pour que cela fe puifïe ; ainfi on paffera fous le ;
même coup d’archet les doubles croches dans un
alla Irtve ; les triples croches dans un allegro à 2 ,
a 3 ou a 4 tems , dans un vivace , ‘ou dans un preflo
•de mêmes mefures ; mais dans un vivace ou dans
un allegretto à f-, les triples croches demandent chacune
un nouveau coup d’archet : il en eft de même
de Y allegretto à 2 ou à 4 tems. Dans les pièces oii
il y a des trois pour deux, chaque note demande
Ordinairement un nouveau coup d’archet. Quant
aux ficiliennes , dont la mefure eft f , le tems lent ;
8c ia première de trois notes , une croche pointée ;
la fécondé , une double croche ; 8c la troifieme ,
une croche, on donne un nouveau coup d’archet à
chaque note.
Je ne parlerai point ici du tems de la,mefure où
l ’archet doit defeendre ou monter, quoique cela
faffe une partie confidérabie de Y accent mufical;
parce que c’eft un de ces principes fondamentaux
que tout exécutant connoît.
Quant aux inftrumens à v ent, ils ne donnent le
coup de langue qu’à Ma première de deux notes l
Vîtes, 8c coulent l’autre, en obfervant de faire la
première plus longue 8c plus forte que la fécondé :
1 . parce que cela facilite l’exécution , 8c la rend
beaucoup plus moëlleufe : 2°. parce que la première
des deux notes eft celle qui eft effectivement
dans 1 harmonie, 8c que l’autre n’eft qu’une noté
d égo ût; cette fécondé raifon devroit porter tous
les inftrumens à obferver cette réglé. Dans les fici-
unnts, on donne le coup de langue, comme le
coup d archet.
Les hautbois 8c les bâfrons coulent ordinairement
jufqu’à huit cotes vîtes, à caufe de la difficulté
du jeu.
A C C is
Quant aux! chanteurs , Y accent mufical eft déterminé
par les paroles mêmes : toutes les notes qui
pafrent foijs la même fyllabe doivent aufîi paf-
fer fous le même coup de gofier, à moins que ce
ne foit une roulade ; alors cela dépend du bon goût
8c de l’habileté de l’exécutant. ( M. de Ca.ft.ilhon. ^
Accent. Sorte d’agrément du chant français ,
qui fe notoit autrefois avec la mufique , mais que
les maîtres de goût du chant marquent aujourd’hui
feulement avec du crayon jinqu’à ce que
l'es écoliers fâchent le placer .d’eux-mêmes. \daccent
ne fe pratique que fur une fyllabe longue,
8c fert de paffage d’une note appuyée à une autre
note non appuyée , placée fur le même degré : il
confifte en un coup de gofier qui éleve le fon d’un
degré pour reprendre à l’inftant fur la note fuivante
le même fon d’eù l’on eft parti ; plufieurs donnoient
le nom de plainte à l ’accent. Vuye^ le figne 6c l ’effet
dè Y accent à la fig. 11. ( /. /. Rouffeau. )
* Cet agrément s’écrit aujourd’hui avec la mu-
fique , comme Rouffeau dit qu’on le faifoit autrefois.
Il •s’exprime par une petite note? ou par une
note prife fur la valeur de -celle qui ia précède ; ainfi
! entre deux UT noires fi l’on veut faire entendre yn
accent, on fera du premier une croche /pointée , 8c
Y accent fera un r é double-croche, qui achèvera
la valeur de la noire. ( M. Frâmery. )
Bien des muficiens appellent, ou du moins appelaient
autrefois accent un agrément confiftant à
faire entendre la note immédiatement au-defrus ou
au-defrous de celle qui eft notée , ‘ fuivant que la
note qui la précède eft an-deffus ou au-defrous , 8$
en diminuant la valeur de la note , fur laquelle ois
fait Y accent, de la valeur de ce mèmeaccent. Quelques
anciens muficiens françois indiquoient cet accent
par un crochet , les allemands par un petit
trait, aujourd’hui on le marque par une petite note
de la valeur que l’on veut donner à Y accent. Voyer
ces lignes 8c ces effets de l’accent, fig. 12.
Un autre accent, dont j’ ai trouvé la marque
8c l’expreffion dans quelques auteurs , eft celui
fig. 2 ; 8c remarquez que le premier eft celui qui
eft encore ufité aujourd’hui.
Les auteurs qui ont écrit en allemand 8c en latin
au 16e 8c 17e fiecles , divifent Y accent en trois différentes
fortes : I9. accentus intendens, qui eft celui
fig. 12 , n°. 2 : 29. accentus rémittent, qui eft
celui du n°. 1 , fig. 12: 8c 3 0. accentus varius ou '
circumfiexus , compofé , pour ainfi dire , des deux
précédens ., 8c qui n’eft que le flatté d’aujourd’hui.
Voyez Flatté. { M. de Cafiilhon. )
A ccent double. Cet agrément que l’on note.
aujourd’hui tout du long , confifte à retrancher
la moitié de la valeur d’une note , en anticipant
celle qui la fuit ; on le marquoit autrefois par
deux petits traits verticaux parallèles. Sur la première
note , voye% niarque 6c l’effet de Y accent
double. ( M. de Cafiilhon. )
A ccents. Les poëtes emploient fouvent ce
B ij