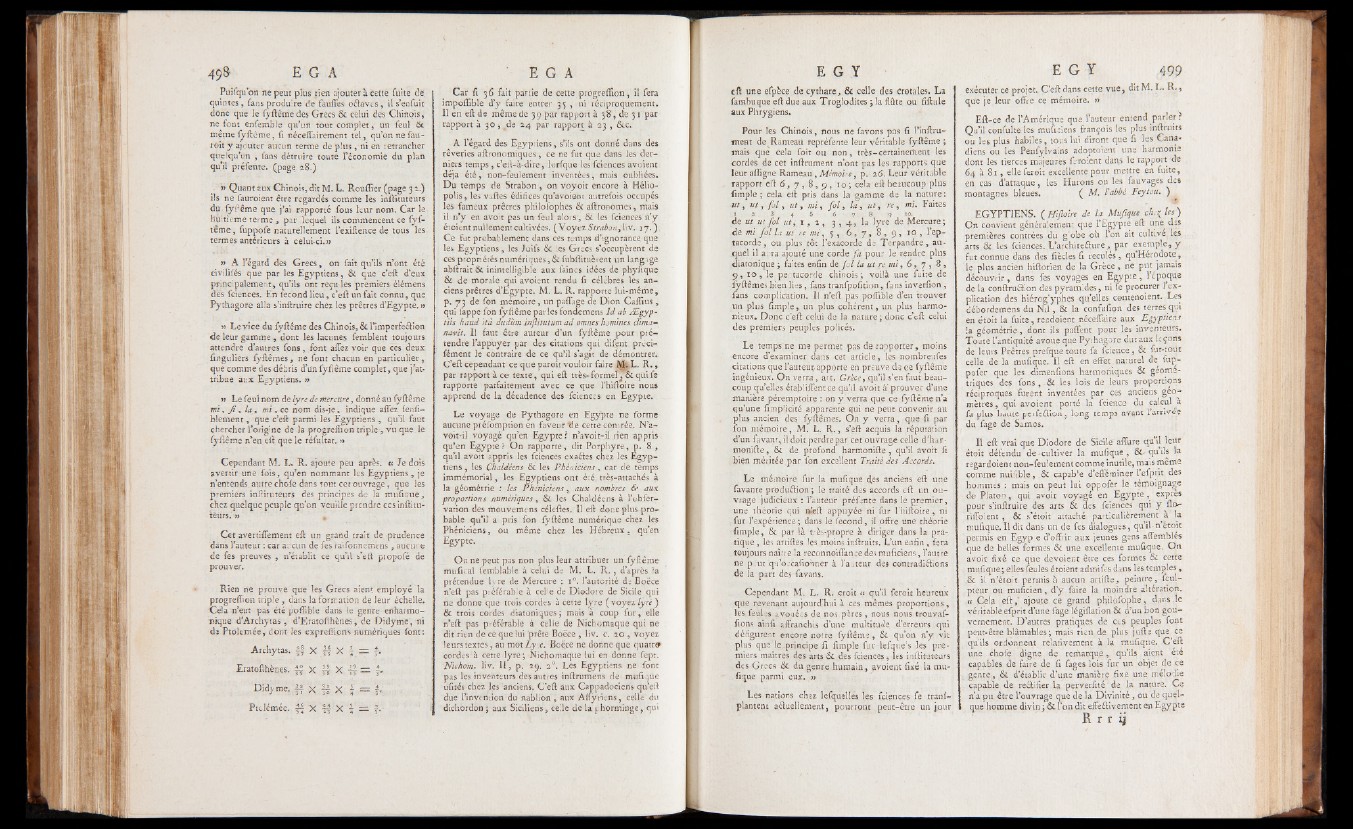
Puifqu on ne peut plus rien ajouter à cette fuite dè
quintes, fans produire de faufles o é la v e s , il s’enfuit
donc que le fyftême des Grecs & celui des Chinois *
ne font enfemble qu’un tout complet, un feul 6c
même fy ftêm e , fi néceffairement tel , qu’on ne fau-
rôit y ajouter aucun terme de plus , ni en retrancher
quelqu’un , fans détruire toute F économie du plan
qu’il préfente, (page 28.)
» Quant aux Chinois, dit M . L . Roûflier (page 3 2.)
ils ne fauroient être regardés comme les inftituteurs
du fyftême que j’ai rapporté fous leur nom. Car le
hum eme terme , par lequel ils commencent ce fy f tême
, fuppofe naturellement l’exiftence de tous les
termes antérieurs à celui-ci.»
» A l’égard des G re c s , on fait qu’ils n’ont été
eivilifés que par les Egyp tiens, & que e’eft d’eux
principalement* qu’ils ont reçu les premiers élémens
des fciences. En fécond lieu , c’eft un fait connu, que
Pythagore alla s’inftruire chez les prêtres d’Egypte. »
■» L e v ice du fyftême des Chinois, & l’imperfeâion
de leur g amme, dont les lacunes femblent toujours
attendre d’autres fo n s , font allez voir que ces deux
finguliers fyftêmes , ne font chacun en particulier,
que comme des débris d’ün fyflême complet, que j’attribue
aux Egyptiens. »
» Le feul nom de lyre de mercure, donné au fyftême
mi, f i s la , mi, ce nom dis-je, indique affez fenfi-
b lem en t, que c’eft parmi les Egyptiens , qu’il faut
chercher l’origine de la progreflion triple, vu que. le
fyftême n’en e ftq u e le réfultat.-»
Cependant M , L . R . ajoute peu après. « Je dois
av en ir une fois , qu’en nommant les Egyp tiens, je
n’entënds autre chofe dans tout cer ouvrage, que les
premiers inftituteurs des principes de la mufique,
chez quelque peuple qu’on veuille prendre ces inftitu-
tëurs .jj
C e t avertifiement eft un grand trait de prudence
dans l’auteur : car aucun de fes raifonneméns aucure
de fes preuves , n’établit ce qu’il s’eft piopofé de
prouver.
Rien rie pronve que les Grecs aient employé la
progreflion triple , dans la formation de leur échelle.
Cela n’eut pas été poflible dans le genre enharmonique
d’Archytas , d’Eratoflhènes, de D id ym e , ni
d î Ptolemée, dont les exprefîions numériques font:
Archytas. X § f X J = fv
Eratofthènes. f f X f f X i f =
Didyme. , | f X f è X f = %
Ptolemée. ^ X f f !X f : — f 1
Car fi 36 fait partie de cette progreflion, il fera
impoflïble d’y faire entrer 33 , ni réciproquement.
11 en eft de même de 39 par rapport à 38 , de 31 par
rapport à 30 * de 24 par rapport à 23 , & c .
A l’égard des Egyp tiens, s’ils ont donné dans des
rêveries aftronomiques, ce ne fut que dans les derniers
temps, c’efi-à-dire, lorfque les fciences avoient
déjà é té , non-feulement inventées, mais oubliées.
D u temps de Strabon , on v o y o it encore à Héliopolis
, les vaftes édifices qu’a voient autrefois occupés
les fameux prêtres philofophes & aftronomes, mais
il n’y en avoir pas un feul alors', & les fciences n’y
étaient nullement cultivées. (V o y e z Strabon, liv. 17. )
C e fut probablement dans ces temps d’ignorance que
les Egyptiens , les Juifs & les Grecs s’occupèrent de
ces propriétés numériques,& fubftituèretit un langage
abftrait & inintelligible aux faines idées de phyfique
& de morale qui avoient rendu fi célèbres les anciens
prêtres d’Egypte. M. L. R . rapporte lui-même,
p. 73 de fon mémoire, un paflage de Dion Caflius ,
qui fappe fon fyftême par les fondemens Id ab Ægyp-
tiis haud itâ dudum inflitutum ad omnes hommes dirtia-
navit. Il faut être auteur d ’un fyftême pour prétendre
l’appuyer par des citations qui difent préci-
fément le contraire de ce qu’il s’agit de démontrer..
C ’eft cependant ce que paroît vouloir faire L . R . ,
par rapport à ce texte, qui eft très-formeÎToe quife
rapporte parfaitement avec ce que l’hiftoire nous
apprend de la décadence des fciences en Egypte.
L e v o y a g e de Pythagore en Egypte ne forme
aucune préfomption en faveur t le cette contrée. N ’a -
voit-il voyagé qu’en Egyp te ? n’avoit-il rien appris
qu’en Egypte ? O n rapporte, dit Porphyre, p. 8 ,
qu’il avoit appris les fciences exaéies chez les E g yp tiens
, les Chaldèens &L les Phéniciens, car de temps
immémorial, les Egyptiens ont été, très-attachés à
la géométrie : les Phéniciens, aux nombres & aux.
proportions numériques, & les Chaldèens à l’obfer-
vation des mouvemens céleftes. Il eft donc plus probable
qu’il' a pris fon fyftême numérique chez les
Phéniciens, ou même chez les Hébreu x. qu’en
Egypte.
O n ne peut pas non plus leur attribuer un fyftême
mufical femblable à celui de M. L. R . , d’après ia
prétendue lyre de Mercure : i° . l’autorité d; Boëce
n’eft pas préférable à celle de Diodore de Sicile qui
ne donne que trois cordes à cette ly re ( voyez lyre )
& trois cordes diatoniques; mais à coup fu r , elle
n’ eft pas préférable à celle de Nichomaque qui ne
dit rien de ce que lui prête Boëce , liv. c. 20 , vo y e z
leurs textes, au mot Lyre. Boëce ne donne que quatre*
cordes à cetre ly r e ; Nichomaque lui en donne fept.
Nichom. liv. I l , p. 20. 20. Les Egyptiens ne font
pas les inventeurs des autres inftrumens de mufique
u fi tés chez les anciens. C ’eft aux Cappadociens qu’eft
due l’invention du nablion, aux A f lÿ r ien s , celle du
dichordon ; aux Siciliens, celle de la phorminge, qui
eft une efpèce de cy tha re, & celle des crotales. La
fambuque eft due aux Troglodites ; la flûte ou fiftule
aux Phrygiens.
Pour les Chin ois , nous ne favons pas fi Pinftru-
ment de Rameau repréfente leur véritable fyftême ;
mais que cela foit ou n on , très-certainement les
cordes de cet infiniment n’ont pas les rapports que
leur afligne Rameau , Mémoire, p. 26, Leur véritable
rapport eft 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ; cela eft beaucoup plus
fimple ; cela eft pris dans la gamme de la nature :
ut, u t , f o l , u t, mi, fo l , la , ut, re, mi. Faites
; i 2 , ; 4 5 6 - 7 ; 8.. 9 10; .
de ut ut fo l ut' 1 , 2 , 3 , 4 , la lyre de Mercure;
de mi fo l la ut re mi, 5 , 6 , 7 , 8, 9, 1 0 , l’ep-
tacorde, ou plus tôt l’exacorde de Terpandre, auquel
il aura ajouté une corde fa pour le rendre plus
diatonique ; faites enfin de Jol la ut re mi, 6 , 7 , 8 ,
9, io , le peutacorde chinois; voilà une fuite de
. fyftêmes bien lié s , fans tranfpofitjon, fans inverfion,
fans complication. Il n’eft pas poflible d’en trouver
un plus fimple, un plus cohérent, un plus harmonieux.
Donc c’eft celui de la nature; donc c’eft celui
des premiers peuples policés.
Le temps ne m? permet pas de rapporter, moins
encore d’examiner dans cet article, les nombreufes
citations que l ’auteuç apporte en preuve de ce fyftême
ingénieux. O n verra, art. Grèce, qu’il s’en faut beaucoup
qu’elles étab’iflentpe qu’il avoit a prouver d’une
manière péremptoire : on y v e r r a que ce fyftême n’a
qu’une fimpücité apparente qui ne peut convenir au
plus ancien des fyftêmes. On y v erra , que fi par
fon mémoire, M. L. R . , s’eft acquis la réputation
d’un favanr, il doit perdre par cet ouvrage celle d ’har-
monifte, & de profond harmonifte, qu’il avoit fi
bien méritée.par fon excellent Traité des Accords.
L e mémoire fur la mufique des anciens eft une
favante production ; le traité des accords eft un ouvrage
judicieux : l’auteur préfente dans le premier,
une théorie qui »Zeft appuyée ni fur l’hiftoire, ni
fur l’expérience ; dans le fécond, il offre une théorie
fimple, & par là très-propre à diriger dans la pratique
, les artiftes les moins inftruits. L’un enfin , fera
toujours naître la reconnoiffance des muficiens, l’autre
ne p;u t qu’occafiohner à fauteur des contradictions
de la part des favans.
Cependant M. L . R. croit « qu’il feroit heureux
que revenant aujourd’hui à ces mêmes proportions,
les feules avouées de nos pères , nous nous trouvaf-
fions ainfi affranchis d’une multitude d’erreurs qui
défigurent encore noire fy ftême , & qu’on n’y vît
plus que le^rincipe fi fimple fur lefque’s les premiers
maîtres des arts & , des fciences* les inftituteurs
des Grecs & du genre humain, avoient fixé la mufique
parmi eux. »
Les nations chez lefquelîes les fciences fe tran.fi-
plantent aéluellement, pourront peut-être un jour
exécuter ce projet. Ç ’eft dans cette v u e , dit M. L . R. *
que je leur offre ce mémoire. »
Eft-çe de l’Amérique que.l’auteur entend parler?
Qu ’il confulte les muficiens françois les plus inftruits
ou les plus habiles, tous lui diront que fi les Canadiens
ou les Penfylvains adoptoient une harmonie
dont les tierces majeures feroient dar\s le rapport de
64 à 8 1 , elle feroit excellente pour mettre en fuite,
en cas d attaque, les Hurons ou les fauvages des
montagnes bleues. ( M. l'abbé Feytou. )
E G Y P T IE N S . ( Hïjloire de la Mufique chéries)
O n convient généralement que l’Egypte eft une^ dss
premières contrées du g obe oh Fon ait cultive les
varts & les fciences. L’arch iteâu re, par exemple, y
fut connue dans des fiècles fi reculés, qu’Herodote,
le plus ancien hiftorien de la G r è c e , ne put jamais
décou vrir, dans fes voyages en E g y p te , l’époque
de la conftruâion des pyramides, ni fe procurer 1 explication
des hiérog’yphes qu’elles conienoient. Les
cébordetïtens du N i l , & la confufion des terres qui
en étoit la fu ite, resdoient néceffaire aux Egyptiens
la géométrie, dont ils paffent pour les inventeurs.
Toute l’antiquité avoue que Pythagore dut aux lc.çons
de leurs Prêtres prefque toute fa Içiencë, & fur-tout
celle de la mufique. Il eft en effet,naturel de fup-
pofer que les /dimenfions harmoniques & géométriques
des fons , & les lois de leurs proportions
réciproques furent inventées par ces anciens g eo y
mètres, qui avoient porté la fcience du calcul a
fa plus haute perfection, long temps avant l’arrivé'e
du fage de Samos.
I l eft vrai que Diodore de Sicile affure qu’il leur
étoit défendu de-cultiver la mufique, ôt^quils la
regardoient non-feulement comme inutile, mais meme
comme nuifible, .& capab'e d’efteminer Fefprit des
hommes : mais on peut lui oppofer le témoignage
dé Platon, qui avoit voyagé en E g y p te , exprès
pour s’inftruire des arts & des fciences qui y flo-
riffoient , & s’étoit attaché particulièrement a la
mufique.Il dit dans un de fes dialogues, qu’il n’étoit
permis en E g yp e d’offrir aux jeunes gens affemblés
que de belles formes & une excellente mufique. O n
avoit fixé ce que dévoient être ces Formes & cette
mufique,; elles feules étoient admifes dans les temples,
& il n’étoit permis à aucun artifte, peintre, fcul-
pteur ou muficien, d’y faire la moindre altération.
« Cela e f t ,’ ajoute ce grand philofophe, dans le
véritable efprit d’une fage législation & d’un bon gouvernement.
D ’autres pratiques de ces peuples font
peut-être blâmables; mais rien de plus jufte que ce
qu'ils ordonnent, relativement à la mufique. C ’eft
une chofe digne de remarqué, qu’ils aient été
capables de faire de fi fages lois fur un objet de ce
. genre, & d’établir d’une manière fixe une mélodie
capable de re&ifier la psrverfité de la nature. C e
n’a pu être l’ouvrage que de la D iv in ité , ou de quelque
homme divin; & l’on dit effe&ivement en E gyp te
R r r ij