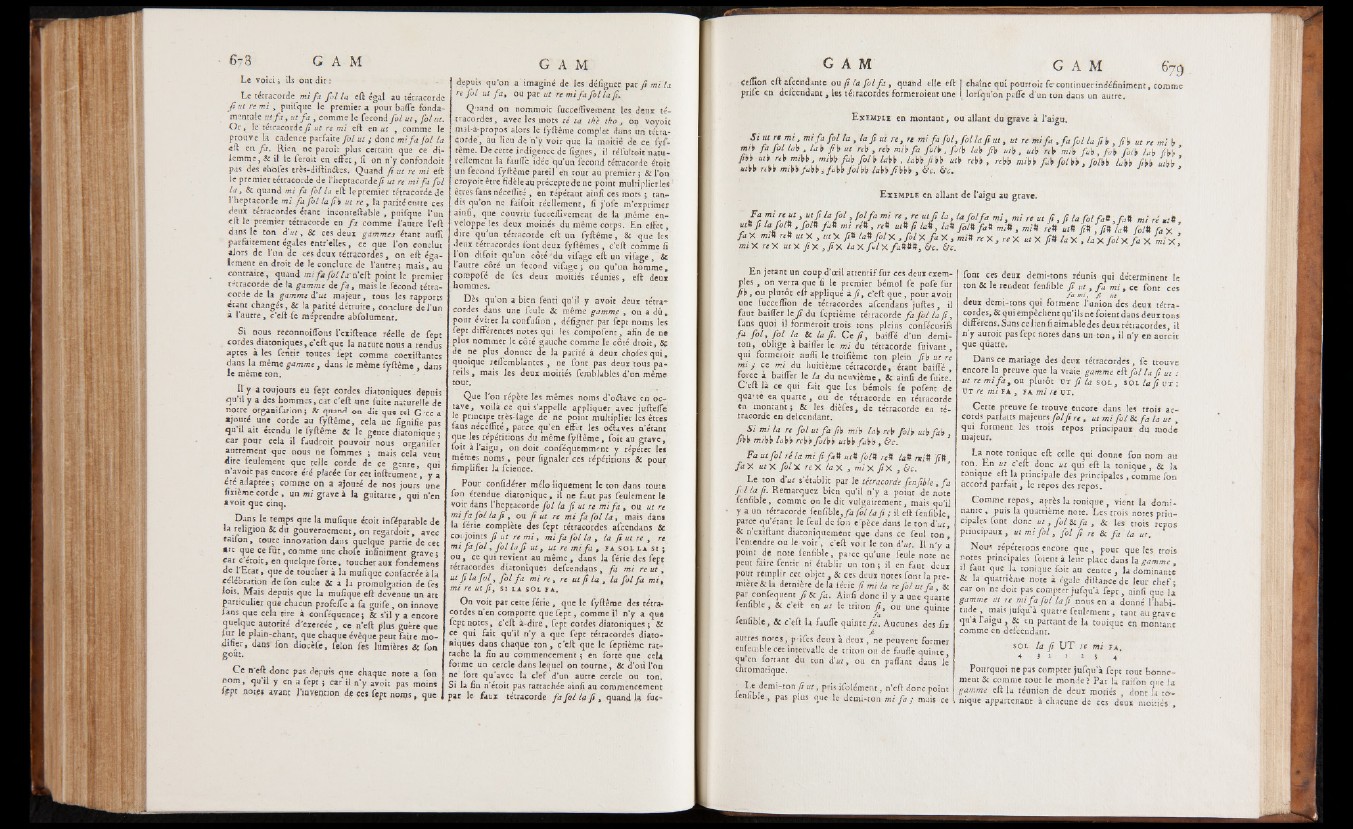
Le voicij ils ont die ;
Le tétraeorde m i f a f o l la eft égal au técracordc
f i ut re m i , puifque le premier a pour balle fondamentale
us f a , u t f a , comme le fécond f o l ut> f o l ut.
O r , le tétraeorde f i u t re m i eft en u t , comme le
prouve la cadence parfaire f o l u t y donc m i f a f o l la
eft en f a . Rien ne parole plus certain que ce dilemme,
Sc il le ferait en effet, fi on n’y confondoit
pas des aboies crès-diftin&es. Quand f i u t re m i eft
le premier tétraeorde de l'heptacordey? ut re m i f a f o l
la , Sc quand m i f a f o l la eft le premier tétraeorde de
1 heptacorde m i f a f o l la fib ut re , la parité entre çes
deux tétracordes étant inconteftable , puifque l’un
eft le premier tétraeorde en f a comme l'autre l'eft
dans le ton d u t , Sc ces deux g am m e s étant auffi
parfaitement égales entr’elles, ce que l'on conclut
alors de l’un de ces deux tétracordes, on eft également
en droit de le conclure de l’autre; mais, au
contraire, quand m i f a f o l la ' n’cft point le premier
tétraeorde de la g am m e de f a t mais le fécond tétra-
corde de la gamme d 'u t majeur, tous les rapports
étant changés, & la parité détruite, conclure del’un
à l’autre , ç’çft fe méprendre abfolumcnt,
St nous reconnoiflons l’cxiftence réelle de fept ;
. cordes diatoniques, c’eft que la nature nous a rendus
aptes à les fentir toutes fept comme coexiftantes
dans la même gamme , dans le même fyftême , dans
le même ton.
Il y a toujours eu fept cordes diatoniques depuis’
qu’il y a des hommes, car c’eft une fuite naturelle de
notre organifation; & quand on dit que tel G ec a
ajouté une corde au fyftême, cela ne lignifie pas
qu’il ait étendu le fyftême & le genre diatonique ;
car pour cela il faudroit pouvoir nous organifer
autrement que nous ne fommes ; mais cela veut
dire feulement que telle corde de ce genre, qui
n avoit pas encore éré placée fur cet inftrument, y a
été adaptée ; comme on a ajouté de nos jours une
fixième corde , un m i grave à la guitarre , qui n’en
avoit que cinq.
Dans le temps que la mufîque étoit inféparablc de
la religion & du gouvernement, on regardoit, avec
faifon, toute innovation dans quelque partie de cet
*rt que ce fû t, comme une choie infiniment grave;
çar cetoit, en quelque forte, toucher aux fondemens
} ^ca5 * *Iue touc^er à la mufique eonfacrée à la
célébration de fon culte & à la promulgation de fes
lois. Mais depuis que la mufique eft devenue un arc
particulier que chacun profelTe à la guife, on innove
fans que cela tire à conféqucnce; & s’il y a encore
quelque autorité d'exercée , ce n’eft plus guère que
fur le plain-chant, que chaque évêque peut faire modifier,
dans fon diocèfe, félon fes lumières 8ç fon
go«-
Ce n eft donc pas depuis que chaque note a fon
rom , qu il y en a fept ; car il n’y avoit pas moins
Ifpr notes avant /’invention de çes fept noins, que j
depuis qu’on a imaginé de les désigner par f i m i l a
r e f o l u t f a , ou par u t r e m i f a f o l l a fi.
Quand on nommoir fuccellivement les deux tétracordes,
avec les mots ré ta t/i e t k o , op voyoit
mai-à-propos alors le fyftême complet dans un técta-
qorde, au lieu de n’ y Voir que la moitié de ce fyftême.
De cette indigence de lignes, il réfultoic naturellement
la faulïç idée qu’un fécond tétraeorde étoit
un fécond fyftême pareil en tout au premier ; & l’ôn
croyoit êtrc fidèleau préceptedene point mulriplierles
erres fans néceflité , en répétant ainfi ces mots ; tandis
qu’on ne faifoit réellement, fi j’ofe m’exprimer
ainfi, que couvrir fuccellivement de la même enveloppe
les deux moitiés du même corps. En effet,
dire qu’un tétraeorde eft un fyftême, & que les
deux tétracordes font deux fyftêmes , c’eft comme fi
I on difoit qu’un côté 'du vifage eft un vifage, &
1 autre côté un fécond vifage; ou qu’un homme,
compofé de fes deux moitiés réunies, eft deux
hommes.
Dès qu’on a bien fenti qu’il y avoit deux tetra**
cordes dans une feule Sc même g a m m e , on a dû,
pour éviter la confufion , défigner par fept noms les
fept differentes notes qui les compofent, afin de ne
plus nommer le côté gauche comme le côté droit, Sc
de ne plus donner de la parité à deux chofesqui,
quoique relfemblantes , ne font pas deux tous pareils
, mais les deux moitiés femblables d’un même
tout.
Que l’on répète les mêmes noms d’o&ave en octave,
voilà ce qui s’appelle appliquer avec juftefle
le principe très-fage de ne point multiplier les êtres
fans nécelfité, parce qu’en effet les o&aves n’étant
que les répétitions du même fyftême, foit au grave,
foit à l’aigu, on doit conféqucmment y répéter les
mêmes noms, pour fignaler ccs répétitions & pouf
fimplifier la fcienec..
Pour confidérer méloiiquement le ton dans toute
fon étendue diatonique, il ne faut pas feulement le
voir dans 1 heptacorde f o l la. f i u t r e m i f a , ou u t r e
m i f a f o l l a f i , ou fi u t r e m i f a f o l l a , mais dans
la férié complète des fept tétracordes afeendans Sc
conjoints f i u t r e m i , m i f a f o l l a , l a f i u t r e , r e
m i f a f o l , f o l l a f i u t , u t r e m i f a , fa sol la s i ;
ou , ce qui revient au même , dans la férié des fept
tétracordes diatoniques defeend^ns, fa m i r e u t ,
u t f i l a f o l , J b l f a m i re, r e u t f i l a , l a f o l f a m i ,
m i r e u t f i t si la sol fa.
On voit par cette férié , que le (ÿftêrae des tétracordes
n’en comporte que fept, comme il n’y a que
fept notes, c’eft à-dire, fept cordes diatoniques ; Sc
ce qui fait qu’il n’y a que fept tétracordes diatoniques
dans chaque ton, c'eft que le feptième rattache
la fin au commencement ; en forte que cela
fo une un cercle dans lequel on tourne, & d’où l’on
ne fort qu'avec la clef d’un autre cercle ou ton.
Si la fin n’étoit pas rattachée ainfi au commencement
p?r le faux tétraeorde fa f o l l # f i , quand U fu$-
Éelîjon eft r.fcendintc o u f la fo l f a , quand elle eft I chaîne qui pourroit fecontinuer indéfiniment, comme
prile en defçendanc, les t&racotdcs formeroient une [ lorsqu'on pafte d’un ton dans un autre.
E x e m p l i e n m o n t a n t , o u a l l a n t d u g r a v e a 1’a ig u ,
Jig Wm la > la f i u‘ r‘ , r t m i f a f o l , f o l la f ia t , ut re m i f a , f a f o l la f i b , f i b a c r e m i b ,
m ib f a f o l l a b , la b ƒ b u t rcb , reb m ib f a f o l b , f o l b la\> f i b u , b , m b r ib m ib f a b , fo b fo ib la b ftbb
fib b 'U tb r tb m i b b . m ,b b f a b f o l b l a b b , la b b . f ib b u ib n b b , rebb m ib b f a b f o l b b , fo lb b la b b M u tb b ’
* tb b r tb b m ib b ./u b b ,• / e b b f o l b b ( a b b ƒ b b b , b e . 6 ’c . ■ 1 *
E x em p l e e n a ll a n t d e 1’a ig u a u g r a v e .
f f . 7 ' ‘ r ' f 9 9 I W m 9 " i 7 f / W s & m t W . 9 1 f i . f i 1° fo l fa » , fat! ml r i ut»,
rnU fi la fol» . fol» fait m re» ref ut»f, la» , la» fol» fa» mi» , mi» re» m» fi» , f i » U fol» fa X
f a x mt» re» m X I H R fi» la» fo l X . fo l X f i x , mi» r e X .r e X utX fi» l aX, laX f o l x f a x m ix
m,X rex m x f i x , f i x la x folX fa»»», Sc. be. J J J * ' X '
En jetant un coup d’oeil attentif fur ccs deux exemples
, on verra que fi le premier bémol fe pofe fur
/ b , ou plutôt eft appliqué à fi> c’eft que , pour avoir
une fucccffion de tétracordes afeendans juftes, il
faut baiffer le f i du feptième tétraeorde fa fo l la f i ,
fans quoi il formeroit trois tons pleins confécurifs
fa fo l , fo l la Sc la fi. Ce f i t bailTé d’un demi-
ton, oblige a baifler le mi du tétraeorde fuivant,
qui formeroit auffi le troifième ton plein f i b ut re
mi y ce mi du huitième tétraeorde, étant baille ,
force a baiffer le la du neuvième, & ainfi de fuite.
C eft là ce qui fait que les bémols fe pofent de
qua?té en quarte, ou de tétraeorde en tétraeorde
en montant; & les dièfes, de tétraeorde en té-
tracorde en defeendant.
Si mi la re fo l ut fa fi|> la ^ reb falb utb fab
fibb mibb Ubb rebb folbb utbb fabb, &c.
Fa ut fo l ré la mi f i fait ut* fa it re* la* mi* fi* ,
f a * utX f o l * r e * la * , miX fiX , &c.
Le ton d’ut s'établit par le tétraeorde fenfible , fa
f l la fi. Remarquez bien qu’il n’y a point de note
fenfible, comme on le dit vulgairement, mais qu’il
y a un tétraeorde fenfible, fa folia f i ; il eft fenfible,
parce qu’étant le fcul de fon espèce dans le ton d’ar,
Sc n exiftant diatoniquement que dans ce feul ton
l’entendre ou le voir, c’eft vo:r le ton d’ut. Il n’y a
point de note lènfible, parce qu’une feule note ne
peut faire fentir ni établir un ton ; il en faut deux
pour remplir cet objet, & ces deux notes font la première
& la dernière de la l érie f i mi la re fo l ut f a , Si
par confequent f i Sc fa. Ainfi donc il y a une quarte
fenfible, & c’eft en ut le triton f i y ou une quinte
fenfible, & c’eft la fauffe quinte fa. Aucunes des fix
autres dots, pdfes deux à deux , ne peuvent former
enlemblecet intervalle de triton ou de faufi'e quinte,
qu en forrant du ton d’ut, ou en paflant dans le
chromatique.
' ^.e demi-tony?ut, pris ifolémcnt, n’eft donc point I
lenfible, pas plus que le demi-ton mi fa y mais ce !
font ces deux demi-tons réunis qui déterminent le
ton & le rendent fenfible f i u t y f a m i , ce font ces
. f a mi, f i u t
deux demi-tons qui forment l'union des deux tétracordes,
Sc qui empêchent qu’ils ne foient dans deux tons
differens. Sans ce lien fi aimable des deux tétracordes, i l
n’y auroit pas fept notes dans un ton, il n’y en aurcic
que quatre.
Dans ce mariage des deux tétracordes, fe trouve
encore la preuve que la vraie gamme eft f o l la f i ut :
u t re m i f a y ou plutôt ut f i la so l , s o l la f i ut :
ut re m i fa , fa m i re ut.
Cette preuve fe trouve encore dans les trois accords
parfaits majeurs f o l f i r e , ut m i f o l Sc f a la u t ,
qui forment les trois repos principaux du mode
majeur.
La note tonique eft celle qui donne fon nom au
ton. En u t c’eft donc u t qui eft la tonique, & la
tonique eft la principale des principales , comme fon
accord parfait, le repos des repos.
Comme repos, après la tonique , vient la dominante
, puis la quatrième note. Les trois notes principales
font donc ut 3 f a i Sc f a , Sc les trois repos
principaux, u t m i f o l , f o l f i re Sc f a la u t.
Nous répéterons encore que, pour que les trois
rotes principales foient à leur place dans la g am m e ,
il faut que la tonique foit au centre , la dominante
& la quatrième note à égale diftance de leur chef;
car on ne doit pas compter jufqu’à fep t, ainfi que la
gamme Ut re m i f a f o l la f i nous en a donné l’habi-
tude , mais jufqu’à quatre feulement, tant au »rave
qu à I aigu , & en partant de la tonique en montant
comme en defeendant.
sol la f i U T re m i fa.
4 } Z i z i 4
Ponrquoi ne pas compter jufqu a fept tout bonnement
Sc comme tout le monde? Par la raifon que la
gamme eft lu réunion de deux motiés , dont la ter-
nique appartenant à chacune de ccs deux moitiés ,