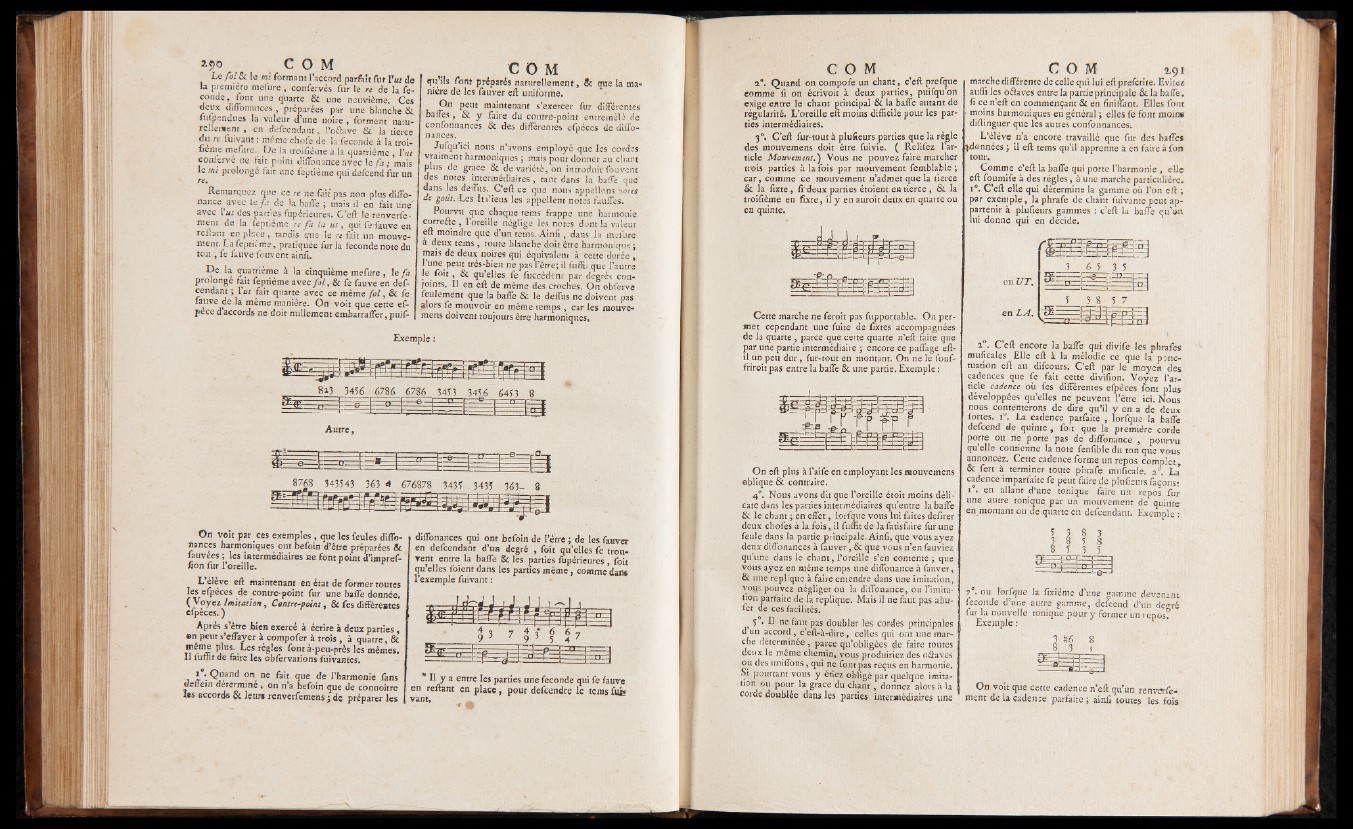
2 Ç o C O M
Le fo l Sc le mi formant l’accord parfait fut l’ai de
la première mefure, confervés fur le re de la fécondé,
font une quarte & une neuvième. Ces
deux diffonances, préparées par une blanche &,
îuqiendues la valeur d’une noire, forment naturellement
, en defcendant, l’oélave & la tierce
du re fuivant : même chofe de la fécondé à la troisième
mefure. De la troifièine à la quatrième , Y ut
confervé ne fait point diflbnance avec le fa ; mais
le mi prolongé fait une feptième qui defcend fur un
re.
Remarquez que ce re ne fait* pas non plus diflbnance
avec le fa de la baffe ; mais il en fait üner
avec la r des parties fupérieures. C ’eft lerenverfe- !
ment de la feptième re fa la u t , qui fe-fauve en
reliant en place, tandis que le re fait un mouvement,
t a feptième, pratiquée fur la fécondé note du
ton -, fe fauve fou vent ainfi.
De la quatrième à la cinquième mefure, le fa
prolonge fait feptieme avec f o l , 8c fe fauve en defcendant
; Yut fait quarte avec ce même f o l , & fe
fauve de la meme manière. On voit que cette ef-
pece daccords ne doit nullement embarralfer,puif-
€ o M
quMs font préparés naturellement, 8c que la ma*
nière de les fauver eft uniforme.
On peut maintenant s’exercer fur différentes
baffes , & y faire du contre-point entremêlé de
confonnances & des différentes efpèces de diffo-
nances.
Jufqu ici nous n’avons employé que les cordes
vraiment harmoniques ; mais pour donner au chant
plus de grâce & de variété, on introduit fou vent
des notes intermédiaires, tant dans la baffe que'
i fes deffus. C’eft ce que nous appelions notes
de goût. Les Italiens les appellent notes fauffes.
Pourvu que chaque feras frappe une harmonie
correéle , 1 oreille néglige les notes dont la valeur
efl: moindre que d’un tems. A in fi, dans la induré
a deux tems , toute blanche doit être harmonique ;
mais de deux noires qui équivalent à cette durée ,
1 une peut très-bien ne pas l’être; il fuffii que l’autre
le fo i t , & qu’elles fe fuccèdent par degrés conjoints.
Il en eft de même des croches. On obferve
feulement que la balle & le deffus ne doivent pas
$lors fe mouvoir en même temps , car les mouve-
mens doivent toujours êtrç harmoniques*
Exemple :
8*3 3456 6786 6786 3453 345_6 6453 8
Autre,
_8768 343543 363 4 676878 3435 3435 363- 8
On Voit par ces exemples, que les feules diffo-
nances harmoniques ont befoin d’être préparées &
fauvées ; les intermédiaires ne font point d’impref-
lion fur l ’oreille.
L ’élève eft maintenant en état de former toutes
les efpeces de contre-point fur une bafte donnée.
(V o y e z Imitation, Contre-point, & fes différentes
efpèces. )
Après s’être bien exercé à écrire à deux parties,
•n peut s’effayer à compofer à trois , à quatre, &
S & 3 P1“ - .Les régies font à-peu-près les mêmes.
Il itimt de faire les obfervations fuivantes.
. rr * Q.u,anc* ? n, ne ^a‘t - que de l’harmonie fans
deffein détermine, on n’a befoin que de connoître i
ïes accords & lçum renvcrfemens ; de préparer les |
diflonances qui ont befoin de l’être ; de les fauver
en defcendant d’un degré , foit qu’elles fe trouvent
entre la baffe & les parties fupérieures, foit
qu’elles foient dans les parties même, comme dans
l ’exemple fuivant :
¥ Il y a entre les parties une fécondé qui fe fauve
en reliant en place, pour defcendre le tems fui?
vant.
C O M
a®. Quand on compofe un chant, c’eft prefque
comme fi on écrivoit à deux parties, puifquon
exige entre le chant principal & la baffe autant de
régularité. L’oreille eft moins difficile pour les parties
intermédiaires.
3°. C ’eft fur-tout à plufieurs parties que la règle
des mouvemens doit être fuivie. ( Relifez l’article
Mouvement.) Vous ne pouvez faire marcher
trois parties à la fois par mouvement femblable ;
car, comme ce mouvement n’admet que la tierce
& la fixte, frdeux parties étoient en tierce , & la
troifième en fixte, il y en auroit deux en quarte ou
en quinte.
Cette marche ne feroit pas fupportable. On permet
cependant une fuite de fixtes accompagnées
de la quarte , parce que cette quarte n’eft faite que
par une partie intermédiaire ; encore ce paffage eft-
il un peu dur, fur-tout en montant. On ne le fouf-
friroitpas entre la baffe & une partie. Exemple :
On eft plus à l’aife en employant les mouvemens
oblique & contraire.
4°. Nous avons dit que l’oreille étoit moins délicate
dans les parties intermédiaires qu’entre la baffe
8c le chant ; en effet, lorfque vous lui faites defirer
deux chofes à la fois, il fuffit de la fatisfaire fur une
feule dans la partie principale. Ainfi, que vous ayez
deux diflonances à fauver, & que vous n’en fauviez
qu’une dans le chant, l’oreille s’en contente ; que
vous ayez en même temps une diflbnance à fauver,
& une répliqué à faire entendre dans une imitation,
vous pouvez négliger oh la diflbnance, ou l’imitation
parfaite de la répliqué. Mais il ne faut pas abu-
fer de ces facilités.
5 . Il ne faut pas doubler les cordes principales
d un accord , c’eft-à-dire, celles qui ont une marche
déterminée, parce qu’obligées de faire toutes
deux le meme chemin, vous produiriez des o&aves
ou des unifions, qui ne. font pas reçus en harmonie.
Si pourtant vous y étiez obligé par quelque imitation
ou pour la grâce du chant, donnez alors à la
corde doublée dans les parties intermédiaires une
C O M 191
marche différente de celle qui lui eftprefcrite. Evitez
aufli les oélaves entre la partie principale & la baffe,
fi ce n’eft en commençant & en finiflant. Elles font
< moins harmoniques en général ; elles fe font moine
diftinguer que les autres confonnances.
L’élève n’a encore travaillé que fur des baffes
fdonnées ; il eft tems qu’il apprenne à en faire à fon
tour.
Comme c’eft la baffe qui porte l’harmonie, elle
eft foumife à des règles, à une marche particulière.
i°. C ’eft elle qui détermine la gamme où l’on eft ;
par exemple, la phrafe de chant fuivante peut appartenir
à plufieurs gammes : c’eft la baffe qu’on
lui donne qui en décide.
en UT.
en LA .
Si
1
3 6 5 3 5
5 7
S
î° . C ’eft encore la baffe qui divife les phrafes
muficales. Elle eft à la mélodie ce que la ponctuation
eft au difcours. C ’eft par le moyen des
cadences que fe fait cette divifion. Voyez l’article
cadence où fes différentes efpèces font plus
développées qu’elles ne peuvent l’être ici. Nous
nous contenterons de dire qu’il y en a de deux
fortes. i°. La cadence parfaite , lorfque la baffe
defcend de quinte , foit que la première corde
porte ou ne porte pas de diflbnance , pourvu
qu’elle contienne la note fenfible du ton que vous
annoncez. Cette cadence forme un repos complet,
& fert à terminer toute phrafe muficale. 2”. La
cadence imparfaite fe peut faire de plufieurs façons:
i°. en allant d’une torique faire un repos fur
une autre tonique par un mouvement de quinte
en montant ou de quarte en defcendant. Exemple :
j° . ou lorfque la fixième d’une gamme devenant
fécondé d’une autre gamme, d éfend d’un degré
fur la nouvelle tonique pour y former un repos.
Exemple :
On volt que cette cadence n’eft qu’un renverfe-'
ment de la çadense parfaite ; ainfi toutes les fois