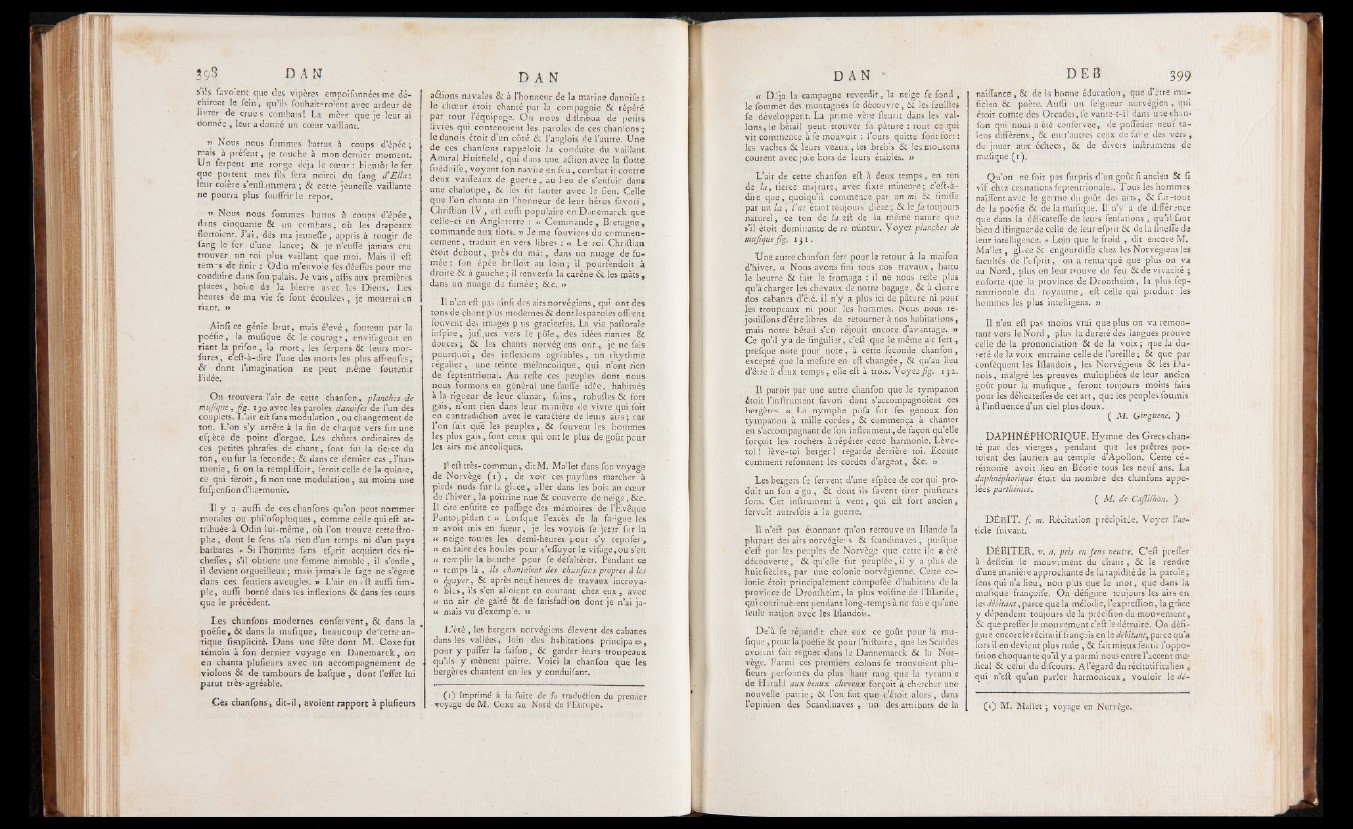
3 9 ^ D A N
s ils favoient que des vipères empoifonnées me déchirent
le fein, qu’ils fouhait?ro;ent avec ardeur dé
livrer^ de crues combats! La mère que je leur ai
donnée , leur a donné un coeur vaillant.
» Nous nous fommes battus à coups d’épée ;
mais à préfent, je touche à mon dernier moment.
Un ferpent me ronge déjà le coeur : bientôt le fer
que portent mes fils fera noirci du fang d'Ella :
leur colere s’enflammera; & cette jeuneffe vaillante
ne pourra plus fouffrir le repos.
ï» Nous nous fommes battus à coups d’épée,
dans cinquante & un combats, où les drapeaux
flottoient. J’a i, dès ma .jeuneffe, appris à rougir de
fang le fer d’une lance; & je n’euffe jamais cru
trouver un roi plus vaillant que moi. Mais il eft
tem~s de finir : Qdm m’envoie fes déefles pour me
conduire dans fon palais. Je vais, aflis aux premières
places, boire de la bierre avec fes Dieux. Les
heures de ma vie fe font écoulées, je mourrai en
riant. »
Ainfi ce génie brut, mais é’evé , vfotitenu par la
poéfie, la mufique & le courage, envifageoit en
riant la prifon, la mort, les ferpens & leurs môr-
fures, c’eft-à-dire l’une des morts les plus afFreufês,
& dont l’imagination ne peut même foutenir
l’idée.
On trouvera l’air de cette chanfon, planches de
mufique, fig. 130 avec les paroles danoifes de l’un des
couplets. L ’air eft far.* modulation , ou changement de
ton. L’on s’y arrête à la fin de chaque vers fur une
efpèce de point d’orgue. Les chûtes ordinaires de
ces petites phrafes de chant, font fut la tierce du
ton, ou fur la fécondé; & dans cè dernier cas , l’harmonie,
fi on la rempliffcit, feroit celle de la quinte,
ce qui feroit, fi non une modulation , au moins une
fufpenfion d’harmonie.
Il y a auffi de ces chanfons qu’on peut nommer
morales ou phi’ofophiques , comme celle qui eft attribuée
à Odin lui-même, où l’on trouve cette ftro-
phe, dont le fens n’a rien d’un temps ni d’un pays
barbares * Si l’homme fans efprit acquiert des ri-
Cheffes, s’il obtient une femme aimable , il s’enfle,
il devient orgueilleux; mais jama:s le fage ne s’égare
dans ces fentiers aveugles. » L’air en eft aufli Ample
, auffi borné dans tes inflexions & dans fes tours
que le précédent.
Les chanfons modernes confeivent, & dans la
poéfie, & dans la mufique, beaucoup de^cette antique
fimpiicité. Dans une fête dont M. Coxe fut
témoin à fon dernier voyage en Danemarck, on
en chanta plufieurs avec un accompagnement de
violons & dç tambours de bafque , dont l’effet lui
parut très-agréable.
Ces chanfpns, d it- il, avoient rapport à plufieurs
D A N
aélions navales & à l’honneur de la marine danoife :
le choeur étoit chanté par la compagnie & répété
par tout l’équipage. On nous diilribua de petits
livres qui contenoient les paroles de ces chanfons :
le danois étoit d’un côté & l’anglois de l’autre. Une
de ces chanfons rappeloit la conduite du vaillant
Amiral Hui-tfield, qui dans une aélion avec la flotte
fuedoife, voyant fon navire en feu, combatrit contre
deux vaiiïeaux de guerre, au lieu de s’enfuir dans
une chaloupe, & les fit fauter avec le fen. Celle
que l’on chanta en l’honneur de leur héros favori ,
Chrifti an IV , eft auffi populaire en Danemarck que
ceile-ci en Angleterre : « Commande , Bretagne,
commande aux flots. » Je me fouviens du commencement
, traduit en vers libres : « Le roi Chriftian
étoit debout, près du mât, dans un nuage de fumée
: fon épée bnlloit au loin ; il pourfendoit à
droite & à gauche ; il renverfa la carène & les mâts,
dans un nuage de fumée; &c. »
Il n'en eft pas ainfi des airs norvégiens, qui ont des
tons de chant plus modernes & dont les paroles offrent
fouvent des images p us gracieufes. La vie paftorale
infpire, jufques vers le pôle, des idées riantes &
douces; & les chants norvégiens on t, je ne fais
pourquoi, des inflexions agréables, un rhythme
régulier, une teinte mélancolique, qui n’ont rien
de feptentrional. Au refte ces peuples dont nous
nous formons en général une fauffe idée, habitués
à la rigueur de leur climat, fains , robuftes & fort
gais, n’ont rien dans leur minière de vivre qui foit
en contradiérion avec le caraéïère de leurs airs; car
l’on fait que les peuples, & fouvent les hommes
les plus gais, font ceux qui ont le plus de goût pour
les airs mélancoliques.
Il eft très-commun, ditM. Ma!let dans fon voyage
de Norvège (1 ) , de voir ces payfans marcher à
pieds nuds fur la glace, aller dans les bois au coeur
de l’hiver , la poitrine nue & couverte de neige, &c.
Il cite enfuite ce paffage des mémoires de l’Evêque
Pontoppidan « Lorfqne l’excès de la fatigue les
» avoit mis en fueur, je les voyois fe jet2r fur la
« neige toutes les demi-heures pour s’y repofer,
a en faire des houles peur s’effuyer le vifage,ou s’en
u remplir la bouche pour fe défaltérer. Pendant ce
« temps là , ils chantaient des chanfons propres à les
« égayer, & après neuf heures de travaux incroya-
« blés, ils s’en aboient en courant chez eux, avec
« un air de gàité & de fatisfaéfion dont je n’ai ja-
« mais vu d’exemp'e. »
L’été , les bergers norvégiens élevent des cabanes
dans les vallées, loin des habitations principa es,
pour y paffer la faifon, & garder leurs troupeaux
qu'ils y mènent paître. Voici la chanfon que les
bergères chantent en les y conduifant.
(1) Imprimé à la fuite de fa traduction du premier
voyage cfe M. Coxe au Nord de PEurope.
D A N *
« Déjà la campagne reverdit, la neige fe fond ,
le fommet des montagnes fe découvre, & les feuilles
fe développent. La prime vère fleurit dans les vallons,
le bétail peut trouver fa pâture ; t-out ce qui
vit commence à fe mouvoir : l’ours quitte font fort:
les vaches & leurs veaux, les brebis & les moutons
courent avec joie hors de leurs étables. »
L’air de cette chanfon eft à deux temps, en ton
de la, tierce majeure, avec fixte mineure; c’eft-à-
dire que, quoiqu’il commence par un mi &. fîniffe
par un la j l'ut étant toujours dièze; &. le fa toujours
naturel, ce ton de la eft de la même nature que
s’il étoit dominante de re mineur. Voyez plançhes de
mufique fig. 13 1.
Une autre chanfon fert pour le retour à la maifon
d’hiver, « Nous avons fini tous nos travaux, battu
le beurre & fait le fromage : il ne nous refte plus
qu’a charger les chevaux de notre bagage, & à clorre
rîos cabanes d’été. 11 n’y a plus ici de pâture ni pour
les troupeaux ni pour les hommes. Nous nous réjouirions
d’être libres de retourner à nos habitations,
mais notre bétail s’en réjouit encore d’avantage. >»
Ce qu’il y a de fingulier, c’eft que le même air fert,
prefque note pour note, à cette fécondé chanfon,
excepté que la mefure en eft changée, & qu’au lieu
d’être à diux temps, elle eft à trois. Voyez fig. 13 z.
Il paroit par une autre chanfon que le tympanon
étoit l’inftrument favori dont s’accompagnoient ces
bergères. « La nymphe pofa fur fes genoux fon
tympanon à mille cordes, & commença à chanter
en s’accompagnant de fon infiniment, de façon qu’elle
forçoit les rochers à répéter cette harmonie. Lève-
toi! lève-toi berger! regarde derrière toi. Ecoute
comment refonnent les cordes d’argent, &c. »
Les bexgers fe fervent d’une efpèce de cor qui produit
un fon a’gu , & dont ils favent tirer plufieurs
fons. Cet inftrument à vent, qui eft fort ancien,
fervoit autrefois à la guerre.
Il n’eft pas étonnant qu’on retrouve en Iflande la
plupart des airs norvégiers & feandinaves, puifque
c’eft par les peuples de Norvège que cette île a été
découverte, & qu’elle fut peuplée, il y a plus de
huitriècles, par une colonie norvégienne. Cette colonie
étoit principalement compofée d’habitans de la
province de Drontheim, la plus voifine de l'Elan de,
quiconti uièrent pendant long-temps à ne faite qu’une
feulé natijon avec les Mandois.
Delà fe répandit chez eux ce goût pour la mufique
, pour la poéfie & pour l’hiftoire, que les Scaldes
avoient fait regner dans le Dannemarck & la Norvège.
Parmi ces premiers colons fe trouvoient plufieurs
perfônnes._du plus haut rang que la tyrannie
de Ha raid aux beaux cheveux forçoit à chercher une
nouvelle patrie; & l’on fait que c’étoit alors, dans
l’opinion des Scandinaves , un des att: ibuts de la
D E 3 ^ 399
n ai fiance, & de la bonne éducation, que d’être mu-
ficien & poète. Auffi un feigneur norvégien, qui
étoit comte des Orcades, fe vante-1—il dans une chm-
fon qui nous a été confervée, de pofféder neur ta-
îens différens, & entr’autres ceux de faire des vers ,
de jouer aux éch-eCs, & de divers inftrumens de
mufique (1 ). -
Qu’on ne foit pas furpris d’un goût fi ancien & fi
vif chsz ces nations feptentrionales. Tous les hommes
najffent avec le germe du goût des arts, & far-tout
de la poéfie & de la mufique. Il n’y a de différence
que dans la délicatefie de leurs fenlàtions , qu’il faut
bien d ftinguerde celle de leur eCprit & de la fineffe de
leur intelligence. « Lqin que le froid , dit encore M.
MaUet, gloce &. engourdifle chez les Norvégiens les
facultés de i’efprii, on a rema-qué que plus on va
au Nord, plus on leur trouve de feu & de vivacité ;
enforte que la province de Drontheim, la plus fep-
tentrionale du royaume, eft celle qui produit les
hommes les plus intelligens. »
Il n’en eft pas moins vrai que plus on va remontant
vers le Nord , plus la dureté des langues prouve
celle de la prononciation & de la voix ; que la dureté
de la voix entraine celle de l’oreille ; & que par
conféquent les Iflandois, les Norvégiens & les Danois
, malgré les preuves multipliées de leur ancien
goût pour la mufique , feront toujours moins faits
pour les délicateffes de cet art, que les peuples fournis
à l’influen,ced’un ciel plus doux.
( M. Ginguené. )
DAPHNÉPHORIQUE. Hymne des Grecs chanté
par des vierges, pendant que les prêtres por-
toient des lauriers au temple d’Apollon. Cette cérémonie
avoit fieu en Béotie tous les neuf ans. La
daphnèphorique étoit du nombre des chanfons appelées
parthènies.
( M. de Cafiïlhon. )
DÉBIT, f. m. Récitation précipitée. Voyez l'article
fuivant.
DÉBITER, v. a. pris en jens neutre. C’eft prefier
à defiein le mouvement du chant, & le rendre
d’une manière approchante de la rapidité de la parole;
fens qui n’a lieu, non plus que le mot, que dans la
mufique françoife. On défigure toujours les airs en
les débitant, parce que la mélodie, I’expreffion, la grâce
y dépendent toujours delà précifiondu mouvement,
& que prefier le mouvement c’eft le détruire. On défigure
encore le récitatif français en le débitant, parce qu’a
lors il en devient plus rude , & fait mieux fentir l’oppo-
fition choquante qu’il y a parmi nous entre l’accent mu-
fical & celui du difeours. A l’égard du récitatif italien ,
qui n’eft qu’un parler harmonieux, vouloir le dé-
(0 M. Mallet ; voyage en Norvège.