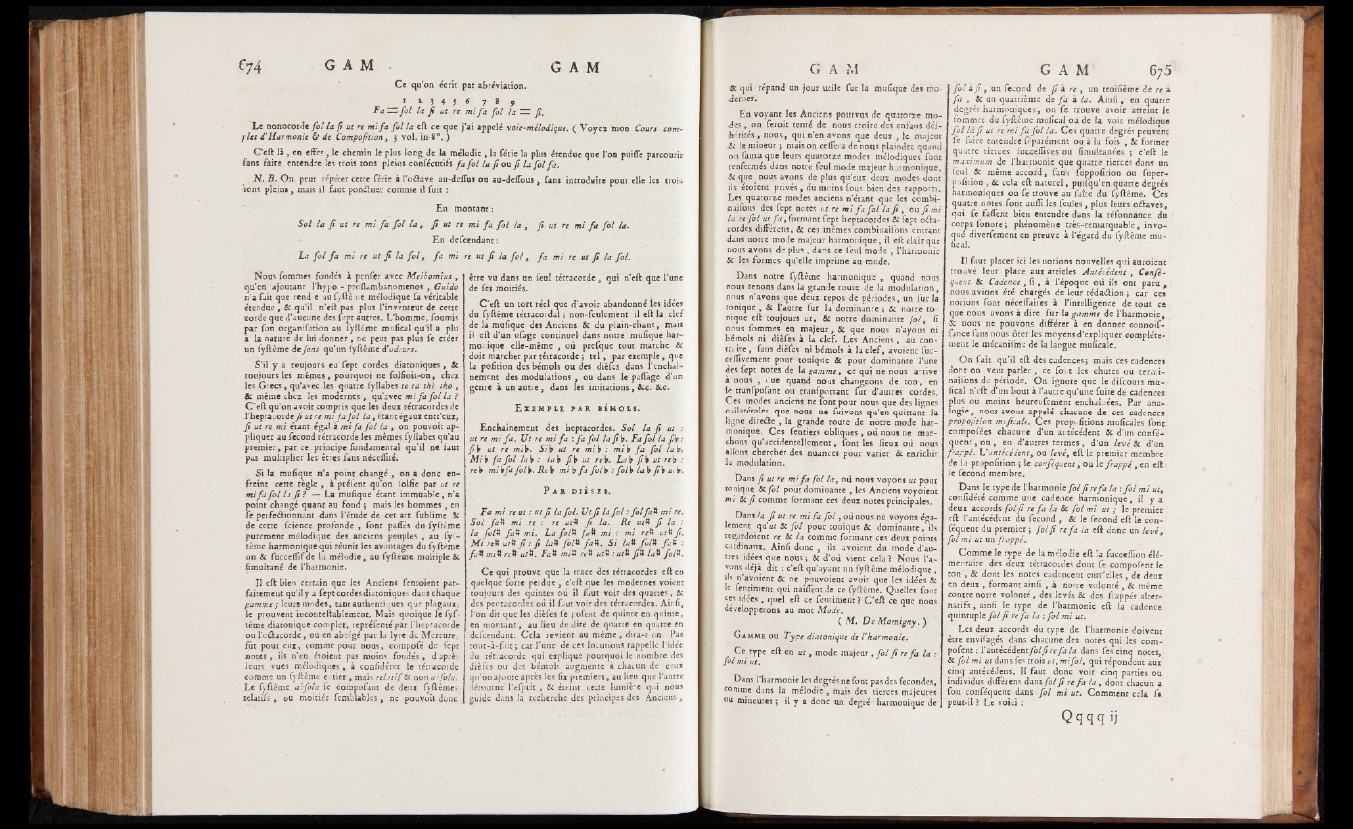
Ce qu'on ^crü pat abréviation.
I a ; 4 î « 7 8 p
— fo l la f i ut re mi fa fo l la ~ f i.
Le nonocorfîe fo l la f i ut re ml fa f o l la eft ce que j'ai appelé voie-mélodique. (_ Voyez mon Coure com-
jh t d'Harmonie & de Compofition , 3 vol. in-8°. )
C eft U , en effer , le chemin le plus long de la mélodie , la férié la plus étendue que l’on puifTe parcourir
fans faire entendre les trois tons pleins confécutifs fa fo l la f i ou f i la fo l fa .
N . B. On peut répéter cette férié à l’oéhve au-deflùs ou au-deflous , fans introduire pour elle les trois
sons pleins y mais il faut ponétuer comme il fuit ;
En montant :
S o l la f i ut re mi f a f o l l a , f i ut re mi fa f o l la , f i ut re mi fa fo l la.
En descendant:
La f o l f a mi re ut f i la f o l , fa mi re ut f i la f o l , f a mi re ut f i la fo l.
Nous fommes fondés à penfer avec Meibomius ,
qiï’ en ajoutant l'hypo - preflambanomenos , Gui do
n’a fait que rend e au fyftême mélodique fa véritable
étendue, & qu’il n’eft pas plus l’inventeur de cette
torde que d'aucune des fept autres. L’homme, fournis
par fon organifation au îyftême mufical qu'il a plu
à la nature de lui donner , re peut pas plus fe créer
Un fyftême de fons qu’un (yftêmc à*odeurs.
S’il y a ceujours eu fept cordes diatoniques , Sx
toujours les mêmes, pourquoi ne foifîoit-on, chez
les Grecs, qu’avec les quatre fyllabes te ta the tho ,
& même chez les modernes , qu’avec mi fa fo l la ?
C ’eft qu’on avoit compris que les deux tétracordcs de
l’heptacorde f i ut re mi fa fo l la , étant égaux entr’eux,
f i ut re mi étant égal à mi fa fo l la , on poavoit appliquer
au fécond rétracorde les mêmes fyllabes qu’au
premier, par ce principe fondamental qu’il ne faut
pas mukiplier les êtres fans néceffité.
Si la mufique n’a point changé , ona donc enfreint
cette règle , à préfent qu’on folfic par ut re
mi fa fo l la f i ? — La mufique étant immuable, n’a
point changé quant au fond ; mais les hommes 3 en
fe perfe&ionnant dans l’étude de cet art fublime 5c
de cette fcience profonde , font paffés du fyftême
purement mélodique des anciens peuples , au fyi-
tême harmonique qui réunit les avantages du fyftême
un & fucccfTifde la mélodie , au fyftême multiple Sx
fimuitané de l’harmonie.
Il eft bien certain que les Anciens fentoient parfaitement
qu’il y a fept cordes diatoniques dans chaque
gamme ; leurs modes, tant authentiques que plagaux,
le prouvent inconteftablemcnt. Mais quoique le fy ftême
diatonique complet, repréfenté par l’hcpracorde
ou l’c&acorde, ou en abrégé par la lyre Ht Mercure,
fut pour eux, comme pour nous, compofé de fept
notes , ils n’en étoient pas moins fondés , d après
leurs vues mélodiques, à confidérer le cétracorde
comme un fyftême entier, mais relatif Sx no na'yfoiu.
Le fyftême abfolu fe corapofant de deux fyftêmes.
relatifs, ou moitiés femblables, ne pouvoit donc
être vu dans un feul ce'rracorde 3 qui n’eft que l’une
de fes moitiés.
C'eft un tort réel que d’avoir abandonné les idées
du fyftême tétracoidal ; non-feulement il eft la clef
de la mufique des Anciens & du plain-chant, mais
il eft d’un ufage continuel dans notre mufique harmonique
elle-même , où prefque tout marche &
doit marcher par tétracordc 3 t e l , par exemple, que
la pofition des bémols ou des dièfes dans l’enchaînement
des modulations , ou dans le paffage d’un
genre à un autre, dans les imitations, &e. Sic.
E xemple par bémol s.
Enchaînement des heptacordes. Sol la f i ut :
ut re mi fa . Ut re mi fa : fa fo l la fi)}. Fa fo l la fiV:
fiV ut re mi b. Sih ut re mi b : mi)} fa fo l la fe-
Mi)} fa fo l la)} : la b fib ut re)}. La)} fi)} ut re 1» :
re)} mi\fa folb. Re b mi V fa fol)} : fol)> la b fi)} ui 1k
P ar di s s e s .
Fa mi re ut : ut f i la fo l. Ut f i la f o l : fo lfa ü mi re*
So l f a § mi re : re uf# f i la. Re ut% f i la :
la fo in fa ti mi. La fo in fan mi : mi ren , utn f i .
M i rCn utn f i : f , ian fo in f an. s i un fo in fa n s
fa n min ren utn. Fan min ren u& :u A fin la^ fo in .
Ce qui prouve que la trace des tétracordcs eft en
quelque forte perdue 3 c’eft que les modernes voient
toujours des quintes où il faut voir des quartes, Si
des pcntacordes où il faut voir des tétracordes. Ainfi,
l'on dit que les dièfes fe pofent de quinte en quinte,
en montant, au lieu de dire de quarte en quarte en
defeendant. Cela revient au même, dira-t-on. Pas
rour-à-fàit j car l ’une de ces locutions rappelle l'idée
du tétracordc qui explique pourquoi le nombre des
dièfes ou des bémols augmente à chacun de ceux
qu’on ajoute après les fix premiers, au lieu que l'autre
détourneT-efprit , & éteint cette lumiè"e qui nous
guide dans la recherche des principes des Anciens,
‘St qui répand un jour utile fur la mufique des mo-
<dernes.
En voyant les Anciens pourvus de quatorze mondes
, on feroit tenré de nous croire des çnfans déf-
héricés , nous, qui n’en avons que deux , le majeur
& le mineur 3 maison cefiera de nous plaindre quand
on faura que leurs quatorze modes mélodiques font
renfermés dans notre feul mode majeur harmonique,
Si que nous avons de plus qu’eux deux modes dont
ils étoient privés , du moins fous bien des rapports.
Les quatorze modes anciens n’étant que les combi-
inaifons des fept notes ut re mi fa fo l la f i , ou f i mi
la re fo l ut fa , formant fept heptacordes Sx fept oéh-
cordes difFérens, & ces mêmes combinaifons entrant
dans notre mode majeur harmonique, il eft clair que
nous avons de plus , dans ce leul mode , l’harmonie
Sx les formes qu’elle imprime au mode.
Dans notre fyftême harmonique , quand nous
nous tenons dans la grande route de la modulation,
nous n’avons que deux repos de périodes, un fur la
tonique , & l’autre fur U dominante i S i notre tonique
eft toujours u t , & notre dominante f o l , fi
nous fommes en majeur, & que nous n’ayons ni
bémols ni dièfes à la clef. Les Anciens, au contre
ire , fans dièfes ni bémols à la clef, avoient fuc-
cefiîvement pour-tonique & pour dominante l’une
des fept notes de U gamme, ce qui ne nous arrive
a nous , 1 ue quand nous changeons de ton, en
le tranfpofant ou tranfportant fur d’autres cordes.
Ces modes anciens ne font pour nous que des lignes
■ collatérales que nous ne fuivons qu’en quittant la
ligne dire&e , la grande route de notre mode harmonique.
Ces fentiers obliques , où nous ne marchons
qu’accidentellement, font les lieux où nous
allons chercher des nuances pour varier Si enrichir
la modulation.
Dans fi ut re mi fa fo l la , où nous voyons ut pour
tonique Sx. fo l pour dominante , les Anciens voyoient
mi Sx f i comme formant ces deux notes principales.
Dans la f i ut re mi fa f o l , où nous né voyons également
qu’ut & fo l pour tonique & dominante, ils
regardoient re Sx la comme formant ces deux points
cardinaux. Ainfi donc , ils avoient du mode d'autres
idées que nous 3 & d’où vient cela ? Nous l’ayons
déjà dit : c’eft qu’ayant un fyftême mélodique ,
ils n'avoient & ne pouvoient avoir que les idées &
le fentiment.qui naiflentde ce fyftême. Quelles font
ces idées , quel eft ce fenriment ? C ’eft ce que nous
développerons au mot Mode.
( M. De Momigny. )
G amme ou Type diatonique de l'harmonie.
Ce type eft en ut , mode majeur, f o l f i re fa la :
fo l mi ut.
Dans l’harmonie les degrés ne font pas des fécondés,,
comme dans la mélodie , mais des tierces majeures
mineures ; il y a donc un degré harmonique de'
! fo l ày?, un fécond ^ j; ■> re , un troifième de re à
fa , & un quatrième de fa à La. Ainfi , en quatre
degrés harmoniques, on fe rrouve avoir atteint le
fommet du fyftême mufical ou de la voie mélodique
fo l là f i ut re mi fa fo l la. Ces quatre degrés peuvent
fe faire entendre féparément ou à la fois , 5c former
quatre tierces fuccefiives ou fimulcanées 3 c ’eft le
maximum de l’harmonie que quatre tierces dans un
feul 5c même accord, fans fuppofition ou fuper-
pofition , 5c cela eft naturel, puifqu’en quatre degrés
harmoniques on fe trouve au faîte du fyftême. Ces
quatre notes font aufli les feules, plus leurs oéfaves,
qui fe faffent bien entendre dans la réfonnance du 1
corps fonore3 phénomène très-remarquab/c, invoqué
diverfement en preuve à l’égard du fyftême mu-
ucal.
Il faut placer ici les uotions nouvelles qui auroient
trouvé leur place aux articles Antécédent , Confé-
quent Sx Cadence , fi , à l’époque où ils ont paru ,
nous avions été chargés de leur réda&ion 3 car ces
notions font néccflfaires à l’intelligence de tout ce
que nous avons à dire fur la gamme de l’harmonie,
Sx nous ne pouvons différer à en donner connoif-
fance fans nous ôter les moyens d'expliquer complètement
le mécanifme de la langue muficale.
On fait qu’il eft des cadences3 mais ces cadences
dont on veut parler, ce font les chutes ou termi-
naifons de période. On ignore que le difeours mu- •
fical n’eft d’un bout à l’autre qu’une fuite de cadences
plus ou moins heurcuCernent enchaînées. Par analogie
, nous avons appelé chacune de ces cadences
propofition mificale. Ces propi.fitions muficalcs font-
compofées chacune d’un ar.te'cédent 5c d’un confé-
quent, ou , en d’autres termes , d’un levé Sx d’un
frappé. L’antécéient3 ou levé, eft le premier membre
de la propofition 3 le conféquent, ou le frappé, en eft -
le fécond membre.
Dans le type de l’harmonie fo l f i re fa la :fo l mi ut,
confidéré comme une cadence harmonique, il y a
deux accords fo l f i re fa la Sx fo l mi ut ; le premier
eft l’antécédent du fécond , & le fécond eft le conféquent
du premier 3 fo l f i re fa la eft donc un levé,
fo l mi ut un frappé.
Comme le type de la mélodie eft îa fucceflîon élémentaire
des deux tétracordes dont fe compofent le
ton , Sx dont les notes cadencenr entr’elles , de deux
en deux , formant ainfi , à notre volonté , & même
contre notre volonté, des levés Sx des frappés alternatifs
, ainfi le type de l’harmonie eft la cadence
quintuple fo l f i re fa la: fo l mi ut.
Les deux accords du type de l’harmonie doivent
être envifagés dans chacune des notes qui les cosn-
pofent : l’antécédent fo l fi re fa la dans fes cinq notes,
Sx fol mi ut dans fes trois ut, mi fo l, qui répondent aux
cinq antécédens. II faut donc voir cinq parties ou
individus difFérens dans fo l f i re fa la , dont chacun a
fon conféquent dans fo l mi ut. Comment cela ff
peut-il} Le voici ;
Q q q q ij