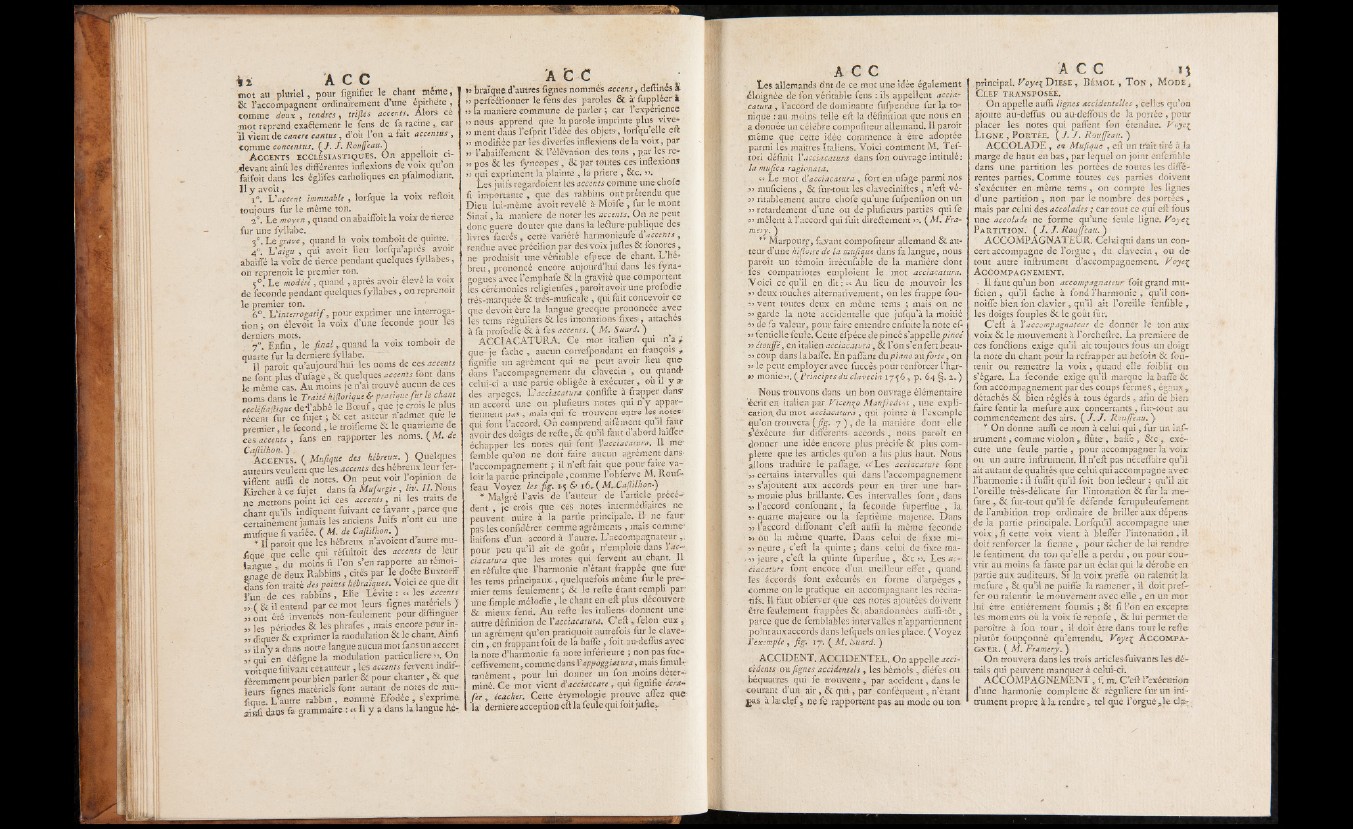
r* a c c
'mot au pluriel, pour lignifier le chant meme,
Sc l’accompagnent ordinairement d’une epithéte ,
comme doux , tendres * trifiés accents* Alors cé
•mot reprend, exaélement le lens de fa racine ear
il vient de cancre camus , d’ou l’on a fait accentus ,
Cpmme concentus. (ƒ . / . Rouffeau.} ,
A ccents ecclésiastiques. On appelloit ^ci-
devant ainli les différentes inflexions de voix qu on
faifoit dans les êglifes catholiques en pfalmodiant.
Il y avoit, ^ . .
i°. Vaccent immuable , torique la voix reftoit
toujours fur le même ton.
2,°. Le moyen , quand on abaiffoit la voix de tierce
fur une fyllabe. _
3°. Le grave, quand la voix tomboit de quinte.
4°. Vaigu , qui avoit lieu lorfqu’apiês avoir
abailfé la-voix de tierce pendant quelques fyllabes-,
on reprenoit le premier ton. . , , ,
5°. L e modéré , quand , aptes avoir éleve la voix
de fécondé pendant quelques fyllabes, on reprenoit
le premier ton. % - 1
6°. L'interrogatif, pour exprimer une interrogation
on élevoit la voix d’une fécondé pour les
derniers mots. , ... ,
7°. Enfin, le final ,. quand la voix tomboit de
quarte fur la. derniere fyllabe.
11 paroît qu’aujourd’hui les noms de ces accents
ne font plus d’ufage, & quelques accents font dans
le même cas. Au moins, je n’ai trouvé aucun de ces
noms dans le Traité hiftorique & pratique fur U chant
ecclèfiafiique de'l’abbé le Boe u f, que, je crois le plus
récent fur ce fujet ; & cet auteur n’admet que le
premier, le fécond ,1e troifieme & le quatrième de
ces accents , fans en rapporter les noms. ( M. de
A ccents. Mujîque des hebreux. jj Quelques
auteurs veulent que les .accents des hebreux leur fer-
viffent auffi de notes. On peut voir l’opinion de
Kircher- à ce fujet dans fa Mufurgie, liv. 11. Nous
ne mettons point ici ces accents, ni les traits de
chant qu’ils indiquent fuivant ce l'avant, parce que
certainement jamais les anciens Juifs n ont eu une
mufique fi variée. ( M. de Cafiilhon. jj
* Il paroît que les hébreux, n’avoient d autre musqué
que celle qui réfultoit des accents de leur
langue » du moins fi l’on s’en rapporte au témoignage
de deux Rabbins , cités par fe dofte Buxtorff
dans fon traité des points hébraïques. Voici ce que dit
l ’un de ces rabbins, Elle Lévite: « le s accents
„ Y & il entend par ce mot leurs fignes matenels J
ont été inventés non-feulement pour diftmguer
„ les périodes & les phrafes , mais encore pour in- ,
srdlquer & exprimer la modulation & le chant. Ainli
5Î iln’ÿ a dans notre langue aucun mot fans un accent ;
sr qui en détigne la modulation particuliere jb, On
vcntque fuivant cet auteur , les accents fervent indifféremment
pour bien parler & pour chanter ,& que
leurs fignes matériels font autant de notes de musqué.
L’ autre rabbin , nommé Efodée , s’exprime
sinCi dans fa grammaire.: ut Il y a dans la:langue hé-
A t C
93 braïque d’autres lignes nommés accent, deflmés &
>j perfeêlionner le fens des paroles & à' fuppléer à
îj la maniéré commune de parler ; car l'expérience
n nous apprend que la parole imprime plus vive*
» ment dans l’efprit l’idée des objets, lorlqu’elle eft
modifiée par les diverfes inflexions de la voix, par
»j-1-’abattement & l’élévation des tons , par les re-
s~3'pos & les fyneopes', & par toutes ces inflexions
i> qui expriment la plainte , la priere , &c. 33.
Les juifs regardoient les accents comme une choie
fi importante , que des rabbins ont prétendu que
Dieu lui-même avoit révélé » Moïfe , fur le mont
Sinaï, la maniéré de noter les accents. On ne peut
donc guerè douter que dans, la leélure-publique des
livres facrês , cette variété harmonieüfe à'accents ,
rendue avec précifion par des voix juftes & fonores,
ne produisît une véritable efpece de chant. L hé-3
breu, prononcé encore aujourd’hui dans lès fyna-
gogues avec l’emphafe & la gravité que- comportent
les cérémonies religieufes, paroît avoir une profodie
très-marquée & très-mufical'e , qui lait concevoir ce
que devoit être la langue grecque prononcée avec
les tems réguliers & les intonations fixes- , attachés
à fa profodie & à fes accents. ( M. S nord. )
A CC IA CA TU R A. €e mot italien qui n’a l
que’ je fâche , aucun cprrefpondant en françois „
fignifie un agrément qui ne peut avoir lieu que
dans l’accompagnement du clavecin , ou quand*
celui-ci a une partie obligée à exécuter, où il y a*
des arpégés. W acciacatura confifte a frapper dans*
un accord une ou plufieurs notes qui n’y appartiennent
pas g mais qui fe trouvent eijtre les notes
qui font l’accord. O11 comprend aifément qu’il faut
avoir des doigts de refte qu’il faut d’abord laitier
échapper- les notes qui font Vacciacatura. IL me
femble qu’on ne doit faire aucun agrément dans-
l’accompagnementil n’ell fait que pour faire valoir
la partie principale, comme l’obfeïve M. Rouf*
lêau Voyez les fig. 1*5 & i6.fM^Cafiilhon-')
* Malgré l’avis de l’auteur de l’article précédent
, je crois que ces notes intermédiaires ne
peuvent: nuire à la partie principale.- Il ne faut*
pas les confidérer comme agréments , mais comme*
. liaifons d’un accord à l’autre. L ’accompagnateur ,,
pour peu qu’il ait de g oû t, n’emploie dans 1 ’acciacatura
que les notes qui fervent au chant. Il
en réfulte que l’harmonie n’étant frappée que fu r
les tems principaux-, quelquefois même fur le premier
tems feulement ; & le relie étant rempli par-
une fimple mélodie, le chant en ellplus découvert-
& mieux fenti. Au relie les italiens; donnent une-
autre définition de Vacciacatura. C e l l , félon eux ,
un agrément qu’on pratiquoit autrefois fur le clavecin
,.en frappant foit de la bafle , foit au-deffus avec
la note d’harmonie fa note inférieure ; non pas Vue*
cetiivement, comme dans V appoggiatura, mais fimulr
tanément-, pour lui donner un fon moins déterminé.
Ce mot vient iïacciaccare , qui fignifie écraser
Jj écacher. Cette étymologie, prouve affez que
la derniere acception ell la feule qui foit jufie^
A C C
Tes allemands tint de ce mot une idée également
éloignée de fon véritable fens : ils appellent acciacatura
, l’accord de dominante fufpendue fur la to->
nique : au moins telle ell la définition que nous en
a donnée un céièbre compofiteur allemand. 11 paroît
même que cette idée commence à être adoptée
parmi les maîtres Italiens. Voici comment M. Tef-
tori définit Vacciacatura clans fon ouvrage intitulé :
la mufica ragionata.
« Le mot d'acciacatura, fort en ufage parmi nos
33 muficiens , & fùr-tout les claveciniftes , n’ell vé-
33 ritablement autre chofe qu’une fufpenlion ou un
33 retardement d’une ou de plufieurs parties qui fe
93 mêlent à l’accord qui fuit direélement 33. {M. Fra-
mery '. )
** Marpourgj favant compofiteur allemand & auteur
d’une hifioire de la mufique dans fa langue, nous
paroît un témoin irrécufable de la manière dont
fes compatriotes emploient le mot acciacatura.
y oici ce qu’il en dit : a Au lieu de mouvoir les
33 deux touches alternativement, on les frappe fou-
33 vent toutes deux en même tems ; mais on ne
33 garde la note accidentelle que jufqu’à la moitié
93 de fa valeur, pour faire entendre enfuite la note ef-
33 fentielle feule. Cette elpèce de pincé s’appelle pincé
33 étouffe, en italien acciacatura, oc l’on s’en fert beau-
33 coup dans la bâtie. En paffant du piano au forte, on
33 le peut employer avec fuccès pour renforcer l’h^ur-
ti monie 33. (^Principes du clavecin. 17 <6 , p. 64 §. 2..)
Nous trouvons dans un bon ouvrage élémentaire
écrit en italien par Vïcen^o Manfredim , une explication
du mot acciacatura, qui jointe à l’exemple
qu’on trouvera ( ƒ£. 7 ) , de la manière dont elle
s’exécute fur différents accords , nous paroît en
donner une idée encore plus précife & plus comp
lè te que les articles qu’on a lus plus haut. Nous
allons traduire le paffage. c«' Les acciacature font
>5 certains intervalles qui dans l’accompagnement
33 s’ajoutent aux accords pour en tirer une har-
33 monie plus brillante. Ces intervalles fon t, dans
33 l’accord confonant, la fécondé fuperflue , la
33 quarte majeure ou la feptième majeure. Dans
33 l’accord diffonant c’efr auffi la même fécondé
»> ou la même quarte. Dans celui de fixte miss
nçure, c’eff la quinte ; dans celui de fixte ma-
> 33 jçure , c’efl: la quinte fuperflue , &c 33. Les acciacature
font encore d’un meilleur effet, quand
les accords font exécutés en forme d’arpèges r
comme on le pratique en accompagnant les récitatifs.
Il faut obferver que ces notes ajoutées doivent
être fèulement frappées abandonnées auffi-tôt,.
parce que de femblables intervalles n’appartiennent
point aux accords dans lefquels on les place. ( Voyez
Vexemple , fig. 17. ( M. Suard. )
, ACCIDENT. ACCIDENTEL. On appelleacci-
crdents ou fignes accidentels , les bémols , dièfes ou
béquarres qui fe trouvent, par accident, dans le
courant d’un air , & qui , par conféquent, n’étant
j>as à la: clef 3 ne fe rapportent pas au mode ou ton
a c c 1î
principal. ^oye[ D iese , Bémol , T on , Mo d e ,
Clef transposée.
On appelle auffi lignes accidentelles , celles qu’on
ajoute au-deffus ou au-deffous de la portée , pour
placer les notes qui paffent fon étendue. Foyc{
Ligne , Portée. ( J. J. Rouffeau. )
A C CO L A D E , en Mufique , ell un trait tiré à la
marge de haut en bas, par lequel on joint enfemble
dans une partition les portées de toutes les différentes
parties. Comme toutes ces parties doivent
s’exécuter en même tems, on compte les lignes
d’une partition , non par le nombre des portées ,
mais par celui des accolades ; car tout ce qui ell fous
une accolade ne forme qu’une feule ligne. Voye£
Pa rt it ion .' ( J. J. Rouffeau. )
ACCOMPAGNATEUR. Celui qui dans un concert
accompagne de l’o rgue, du clavecin, ou de
tout autre infiniment d’accompagnement. Foyeç
A ccompagnement.
- Il faut qu’un bon accompagnateur foit grand mu-
ficien , qu’il fâche à fond l’harmonie , qu’il con-
noiffe bien fon clavier , qu’il ait l’oreille fenfible ,
les doigts fouples & le goût fur.
C ’efl: à Vaccompagnateur de donner le ton aux
voix & le-mouvement à l’orcheflre. La première de
ces fondions exige qu’il ait toujours fous un doigt
la note du chant pour la refrapper au befltin & fou-
renir ou remettre la v o ix , quand elle foiblit ou
s’égare. La fécondé exige qu’il marque la baffe &
fon accompagnement par des coups fermes, égaux y
détachés & bien réglés à tous égards , afin de bien
faire fentir la mefure aux concertants , fur-tout au
commencement des airs. ( /. J. Rou ffeau. )•
* On donne auffi ce nom à celui q u i, fur un infiniment
, comme violon y flûte, baffe , & c , exécute
une feule partie , pour accompagner la voix
ou un autre infiniment. I l n’efl pas néceffaire qu’il
ait autant de qualités que celui qui accompagne avec
l’harmonie : il fuffit qu’il foit bon leéleur ; qu’il ait
l’oreille très-délicate fur l’intonation & fur la mefure
, & fur-tout qu’il fe défende fcrapuleufement
de l’ambition trop ordinaire de briller aux dépens
de la partie principale. Lorfqu’il accompagne une
voix , fi cette voix vient à bleffer l’intonation , il
doit renforcer la tienne , pour tacher de lui rendre
le fentiment du ton qu’elle a perdu , ou pour couvrir
au moins fa faute par un éclat qui la dérobe en
partie aux auditeurs. Si la voix preffe ou ralentit la
mefure , & qu’il ne puiffe la ramener, il doitrpref-
fer ou ralentir le mouvement avec elle , en un mot
lui être entièrement fournis ; & ti l’on en excepte
les moments où la voix fe repofe , & lui permet de
paraître à fon tour , il doit être dans tout le refie:
plutôt foupqonné qu’entendu. Voye^ A ccompagner.
( M. Framery. ’)
On trouvera dans les trois articles fiuvants les détails
qui peuvent manquer à celui-çr.
ACCOMPAGNEMENT,. f. m. C rèfi l’exécution
d’une harmonie complette & régulière fur un instrument
propre à la rendre > tel (ÿie l’o rg u é ,le .d ^