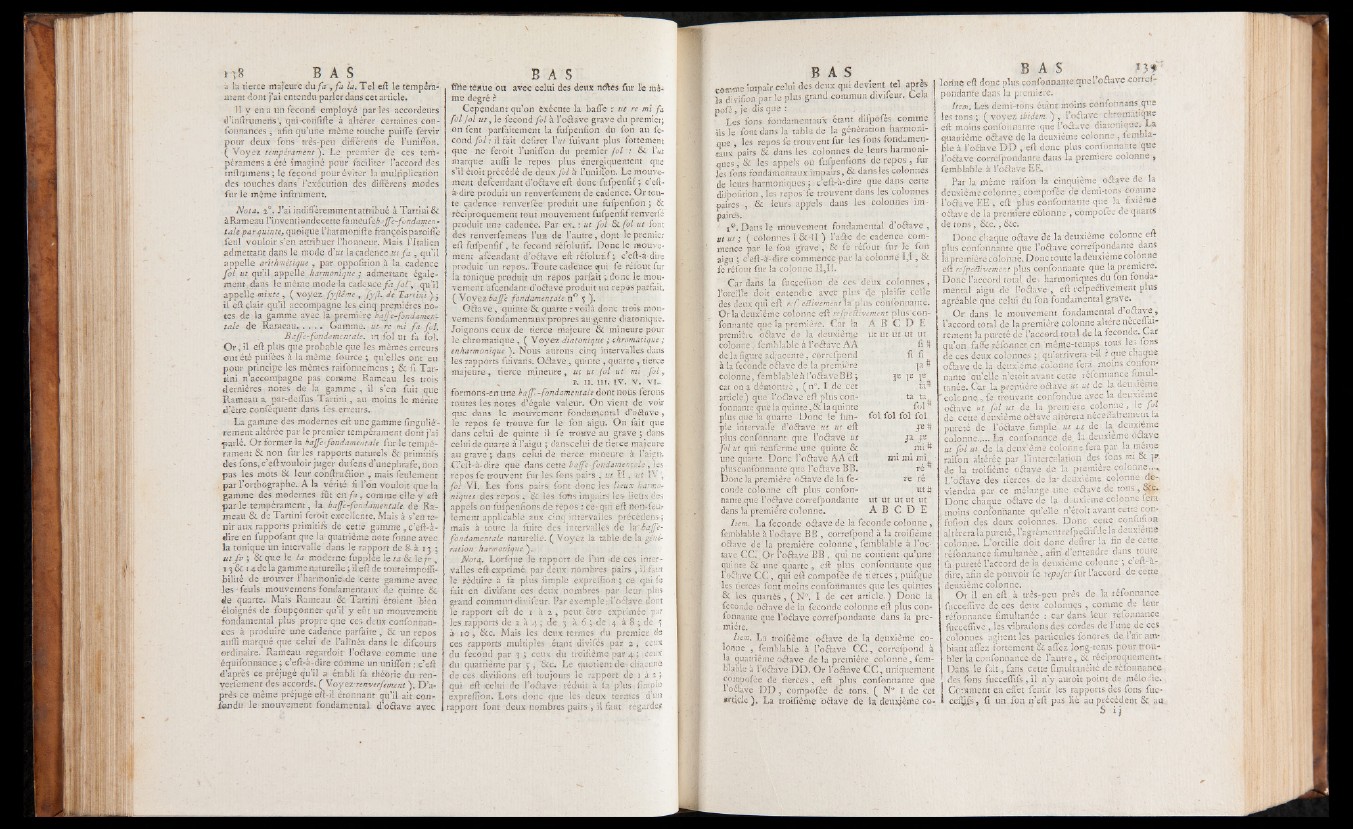
r^S? B A S
à la tierce majeure du fa , fa la. Te l eff le tempérament
dont j’ai entend u parler dans cet article.
11 y en a un fécond employé par les accordeurs
d’inftrumeris ', qui-corififte à altérer certaines con-
fonnances j afin qu’une même touche piaffe fervir
pour deux fons très-peu différeras de l’uniffon.
( V o y e z tempérament Le premier de ces. tem-
péramens à été imaginé pour faciliter l’accord des
inftrnmens ; le fécond pour éviter la multiplication
des touches dans l’exécution des différens modes
fur le même infiniment.
Nota.. a0. J’ai indifféremment attribué à Tartini &
àRameau l’inventiondecette faméu feÆ./j/'’-fondamentale
'par quinte, quoique l’harmoniffe François paroiffe
.feul vouloir s’en attribuer l’honneur. Mais l ’Italien
admettant dans le mode d'ut la cadence ut fa .. qu’il
appelle arithmétique ÿ par oppofition à la cadence
fo l ut qu’il appelle harmonique ; admettant également,
dans le même mode la cadence fa fal~y qu’il
appelle mixte , ( voyez. fyjlême r fyfl- de Tartini
il efi clair qu’il accompagne les cinq premières notes
de la gamme avec là-première bafje-fondamen-
tale de Rameau... . . . Gamme, ut- re mi fa fol.
Baffs-fondamentale. ut fol ut fa fol.
O r , il efi plus que probable que lès mêmes erreurs
ont été puifées à la même fource ; qu’elles ont eu
pour principe les mêmes raifonnemens & fi, Tartini
n’accompagne pas comme Rameau les trois
dernières notes de la gamme , il s’en fuit que
Rameau a par-deffus Tartini, au moins le mérite
d’être çonféquent dans fes-erreurs..
La gamine des modernes efi une gamme finguîié-
rement altérée par le premier tempérament dont j’ai
parlé. Or former la b ajfe-fondamentale fur le tempé-
rament & non fur les rapports naturels & primitifs
des fons, c’eft vouloir juger dufens d’unephrafe, non
pas les mots & leur confiruâioi? , mais feulement
. par l’orthographe. A la vérité fi l’on vouloit que la
gamme des modernes fut en fa , comme elle y efi
par le tempérament, la baffe-fondamentalea de. Rameau
& de Tartini feroit excellente. Mais à s’en tenir
aux rapports primitifs de eetté gamme , c’eft-à-
dire en fuppofant que la quatrième note fonne avec
là tonique un intervalle dans le rapport de 8-à 13 ;
ut j v ; & que le la moderne fupplée le ta & le ,
13 & 14 de la gamme naturelle ; il.efi de touteimpcflï-
bilité de trouver 1’barmoniede cette gamme avec
les feuls mouvernens fondamentaux de quinte &
de quarte. Mais Rameau & Tartini étoient bien
éloignés de foupçonner qu’il y ent un mouvement
fondamental plus propre que ces-deux confonnan-
ces à produire une cadence parfaite , & un repos
aufli marqué que celui de l’alinéa dans le difcours
ordinaire. Rameau regardoif Foâave comme une
équifonnance ; c’eft-à-dire comme un uniffon-: c’ efi
d’après ce préjugé qu’il a établi fa théorie du renversement
des accords-( V oyez-reriverfement ). D ’a- :
près ce même préjugé efi-il étonnant qu’il ait cou- ,
fondu-le: mouvement fondamental d’oâave avec j
B A S
fifie té n u e o u a v e c c e lu i des d e u x n d te s fu r l!e mêm
e d e g ré ü
Cependant qu’on ëxécnte la baffe : ut re mi fa
fo l jo l ut, le fécond fol à Foâave grave du premier;
on fent parfaitement la fufpenfion du fon aù fécond
fo l ;il fait defirer Y ut fuivant plus fortement
que ne feroit l’uni ffon du premier / o l .• & Y ut
marque aufli le repos plus énergiquement que
s’il étoit précédé de deux fol à Fùmffon. Le mouvement
defcewdànt d’oâave efi doncfufpenfif ; c’eft-
à-dirë produit un renverfement de cadence. Or toute
cadence renverfée- produit une fufpenfion ; &
réciproquement tout mouvement fufpenfif renverfé
produit une cadente. Par ex..: ut fol Scfçl ut font
des rënverfemens l’un de l’autre , dopt le premier
efi fufpenfif y le fécond réfolutif.- Donc le mouvement
afeendant d’oâave eft réfolutif; c’eft-à- dire,
produit un repos.. Toute cadence qui fe réfout fur
la tonique produit un repos parfait ; donc le. mouvement
afeendant d’oâave produit un repos parfait,
(Voyez b ajfe fondamentale n° 5 ).
Oâave, quinte & quarte r voilà donc trois mon-
vemens fondamentaux propres au-genre diatonique.
Joignons ceux de tierce majeure & mineure pour
le chromatique , ( Voyez diatonique ; chromatique ;
enharmonique ). Nous aurons cinq intervalles dans
les rapports fuivaris. O âave, quinte , quarte , tierce
majeure, tierce mineure, ut ut fol ut mi fo l r
?.. II. III. IV. V. VIformons
en une bajfi -fondamentale dont nous ferons
toutes les notes d’égale valeur. On vient de voir
que dans le mouvement fondamental d’oâave
le repos fe trouve fur le fon aigu. On fait que
dans celui de quinte il fe trouve au grave ; dans
celui de quarte à l’aigu dans celui de tierce majeure
au grave ‘T dans celui de tierce mineure à l’aigu.
C’efi-à-dire que dans cette b ajfe-fondamentale ,.les
repos fe trouvent fur ies fons paivs , ut H , ut IV ,
fol VI. Les fons pairs- font doncles lieux harmoniques
des repos., 8c les fons impairs les lieux des
appels oufufpenfions de repos : ce* qui efi non-feulement
applicable aux cinq intervalles précédent;
mais à toute la fuite des intervalles de ht"bajfe-
fondamentale naturelle. ( Voyez la table de la génération
harmonique )„.
Notûy. Lorfque le rapport de l’un de ces intervalles
efi exprimé, par deux nombres pairs , il faut
le réduire à fà plus fimplè expreflion ; ce qui fe
: fait- en divifant ces deux nombres par leur plus
grand commuridivifeur. Par exemple :,l’oââve dont
le rapport efi de 1 à 2 , peut-être exprimée par
les rapports de 2 . à 4 ; dé . 3 à 6 ;-de .4 à 8 ; de 5
à- 1 0 , 8cc. Mais lès deux termes du premier , de
ces rapports multiples étant divifés par 2 $ ceux
du fécond par 3 ; ceux du troifième par 4 ; ceux
du quatrième par y , '8cc. Le quotient de. : chacune
de ces diyifions efi toujours le rapport de 1 à 2 ;
qui efi .celui de Foâave réduit à fa plus . Ample
expreflion. Lors donc que les deux termes ' d’un
rapport font deux nombres pairs , il faut regarde*
b a s
cseMne impair celui des deux qui devient tel après
la divifion par le plus grand commun diviieur. Cela
pofé, je dis que : -
■ Les fons fondamentaux étant difpôfés comme
ils le font dans la table de la génération harmonique,
les repos fe trouvent fur les fous fondamentaux
pairs 8e dans les colonnes de leurs harmoniques,
& ' les appels ou fufpenfions de repos , fur
les fons fondamentaux impairs, 8e dans les colonnes
de leurs harmoniques ; c’eft-a-dire que dans cette
difpofition , les repos'fe trouvent dans les colonnes
paires ,. 8c leurs appels dans les colonnes impaires.
i°. Dans le mouvement fondamental d’oâave,
ut ut ; ( colonnes I 8c *11 ) l’aâe de cadence commence
par le fon gravé, 8e fe réfout fur le fori
aigu ; c’ëfi-à-dire commence par la colonne 1,1, &
fe réfqut fur la colonne II,IL
Car dans la âiccelEon de ces deux, colonnes ,
l ’oreille doit entendre aÿqt plus fie plaifir celle
des deux qui efi ref eElivemènt lapSus confonnante.
Or la deuxième colonne efi refpeàivement plus'con-
fonnante que la premièfe. Car la A B C D E
première, oélave de la deuxième ut ut ut ut ut
colonne,Temblabié à f oâave A A ' fi #
de la figure adjacente, çorrefpond ' fi fi
à la fécondé oéîavê de la première ' fa ff
colonne, femblable à l’odave BB ;
car on a démontré , ( n°. I de cet
article”) que Tofîave efi plus confonnante
que la quinte, & la quinte
plus que la quarte -Donc fe Ample
intervalle d’ôétave ut ut efi
plus cbnfonnant que l’ofiave ut
fol ut qui renferme une quinte &
une quarte. Donc Fo&ave A A é fi
plusconfonnante que Foâave BB.
Donc la première oâave de la fécondé
colonne efi plus confon-
nante que l’oâave correfpondante
dans la première colonne. 7
F Ie Ie .
ta#
ta ta,
. fol*
fol fol fol fol
JE#
**mi ff
mi mi mi
re* n#
re ré
ut#
hem. La fécondé oâave de la fécondé colonne , '
femblable à l’oâave BB , çorrefpond à la troifième, .
oâave de la première colonne, femblable à l’oc-' ;
tave ÇC.’. Or l’oâave BB , qui ne contient qu’une
quinte & une quarte , efi plus confondante que
l’oâave C C , qui efi compoiée de tierces ; puifque
les tierces font moins conformantes que les quintes
Sc les quartés , ( N°. I de cet article. ) Donc la
fécondé oâave de la fécondé colonne efi plus confonnante
que Foâave correfpondante dans la première.
Item. La troifième oâave de la deuxième colonne
, femblable. .à l’oâave C C , çorrefpond à
la quatrième oâave de la première, colonne, femblable
à Foâave DD. Or Foâave C C , uniquement
coinpofée de tierces , efi plus confonnante que
Foâave D D , compofée de tons. ( N° I de cet
«rtide ). La troifième Oâave de la deuxième co-
B A S 13*
lorine efi donc plus confonnante que Foâave -corref-
poiidante dans la première.
hem. Les demi-tons étant moins confonnans,que
le stons; (v o y e z ibidem'), l’oâave chromatique
efi moins confohuante que l’oâave diatonique. La
quatrième oâave de la deuxième colonne , femblable
à Foâave D D , efi donc plus confonnante'que
Foâave correfpondante dans la première colonne ,
femblable à Foâave EE.
Par la même raifon la cinquième oâave de la
deuxième colonne', compofée de demi-tons comme
l’oâave EE , efi plus confonnante que la fixièrué
oâave de la première colonne , compofée de quarts
de tons , &c., &c.
Donc chaque oâave de la deuxieme colonne efi
plus confonnante que l’oâave correfpondante dans
la première colonne. Donc toute la deuxième colonne
efi refpeàivemcnt plus confonnante que la première.
Donc l’accord total des harmoniques du fon fondamental
aigu de Foâave-, efi refpeâiv.ement plus
agréable que celui du fon fondamental grave.
Or dans le mouvement fondamental d o âaye,
l’accord total de la première colonne altère neceffai-
rement la pureté de l’accord total de la fécondé. Car
qu’on faffe .réfonner en même-temps tous les tons
de ces deux colonnes ; qu’arrivera t-il ? que chaque,
oâave de,la deuxlème'colqnne fera moins conlon-
nante qu’elle 11’étoit avant cette réfonnance nmui-
tanée. Car la première oâave ür. ut de la deuxieme
colonne, fe trouvant confondue.avéc la deuxième
oâave ut fol ut de la première colonne, le fo l
de. cette deuxième oâave altérera néceffairement la
pureté de Foâave fimple'- ut ut de la^ deuxième
colonne..... La confonance de. la deuxieme oâave
ut fol ut de la deurème colonne fera par la meme
raifon altérée par l’intercalation des fons mi.oc p.
de la troifième oâaye de là première colonne...,,
L’oâave des tierces de la-deuxième colonne deviendra
par ce mélange une oâave de tons , qcc.
Donc chaque oâave de la deuxieme colonne fera
moins confonnante qu’elle n’étoit avant cette con-
fufioh des deux colonnes. Donc cette conftinon
altérera la pureté, l’agrément refpeâifde la deuxième
colonne. L’oreille doit donc defirer la fin de cette
réfonnance Simultanée, afin d’entendre dans ^ toute
fa-pureté l’accord delà deuxième colonne ; c’efi-à-
dire, afin de pouvoir fe repofer fur l’accord de cette
i deuxieme colonne.
Or il en efi à très-peu près de la réfonnance.
cceffiye de ces deux colonnçs , comme de leur
ifonnance fimultanée : Car dans leur réfonnance
iccefiîve, les vibrations des cordes de l’i-iue de ces
ffon nés agitent les particules fenores de Fàir am-
iant affez fortement & aflez long-tems pour trou-
ler la confonnance de l’autre, 8c réciproquement.
)ans le fait, fans cette fiipultanéité de réfonnance
es fons fucceflifs , il n’y auroit point de méloc'ie. .
Comment en effet fentir les rapports des fons fuc