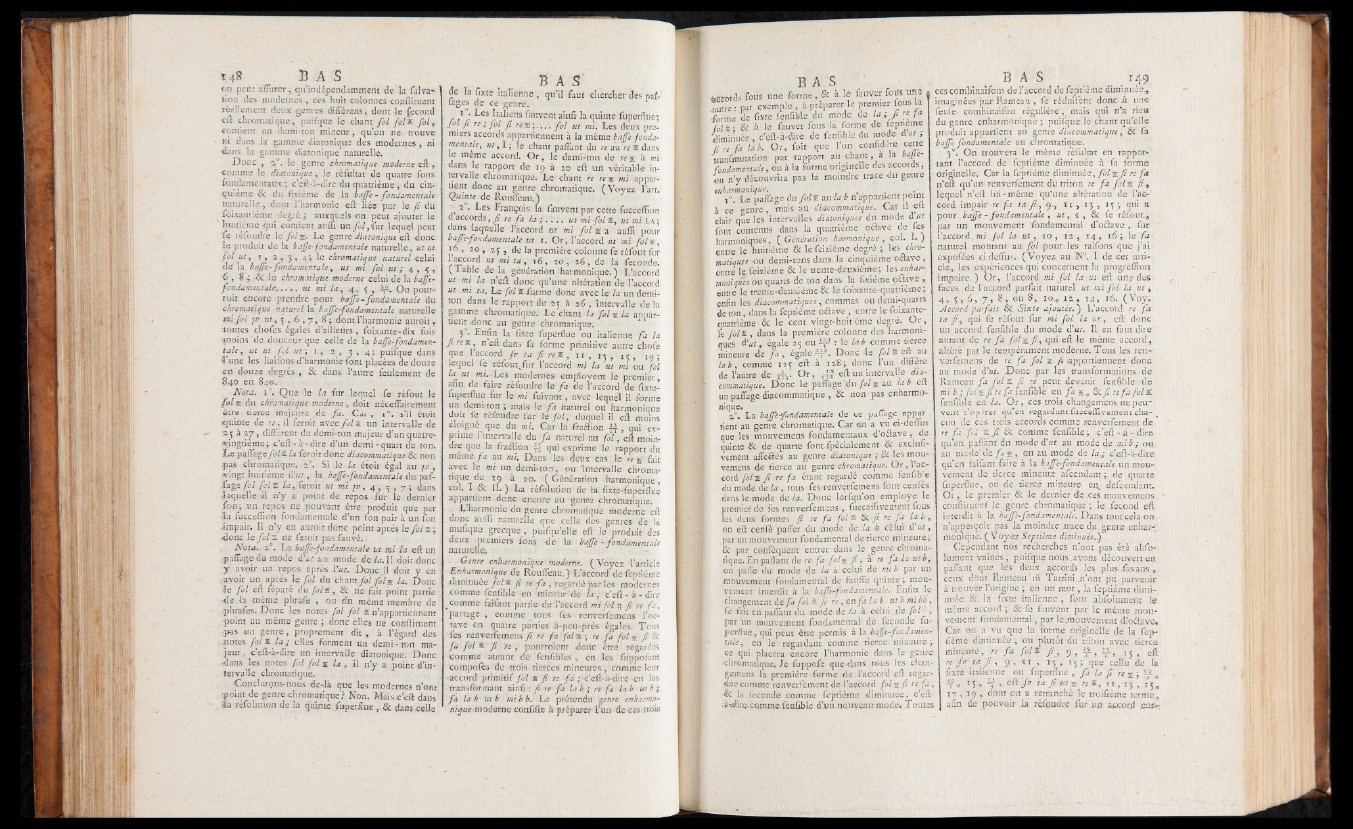
peut afflu e r ,. qu’ indépendamment de la fa i va»
fck>n des modernes , ces huit colonnes condiment
réellement deux genres différens, -dont -le fécond
eft chromatique, puifque le chant fo l f o l s fol.,
contient un demi-ton mineur, qu’on ne, trouve
ni dans la' gamme diatonique des mode rnes , ni
-dans la gamme diatonique naturelle. ,
D o n c , a0, le genre chromatique moderne e f t ,
com m e le diatonique, le refeltat de quatre fons
fondamentaux.; c’eft-à-dire du quatrième, du cinquième
& du fixieme de la baffe - fondamentale
naturelle , dont l ’harmonie eft liée par le fi du
foixantième degré ; auxquels on peut ajouter le
huitième qui contient aufti un fo l, fut lequel peut
fe réfoudre le fo l s- L e genre diatonique eft donc
le produit de la baffe-fondamentale n aturelle, ut ut
fo l ut, i , a , 3 , 4 ; le chromatique naturel*celui
-de la baffe-fondamentale, ut mi fo l ut ; 4 , 5 ,
, 8 ; '& l e chromatique moderne .celui de la baffe-
fondamentale, . . . . . -ut mi la., 4 , 5 , O n pourvoit
encore prendre pour baffle-fondamentale du
chromatique naturel la baffle-fondamentale naturelle
mi fo l fo ut, 5 , 6 » 7, 8 ; dont l ’harmonie au ro it ,
tou te s chofes égaies d’ailleurs , foixante-dix fois
an oins de douceur que celle de la baffe-fondamentale,
ut ut fo l u t 1 , 2 , 3 , 4 ; puifque dans
Tune les liaifons-d’harmonie font placées de douze
en douze degrés., & dans l’autre feulement de
#40 en 84©..
Nota. i° . Q u e le la fur lequel fe réfout le
f o l s du chromatique moderne, doit néceffairement
•être tierce majeure de fa . C a r , i ° . s’il étoit
quinte de ri , il feroit avec fo ls, un intervalle de
'25 à 2 7 , différent du demi-ton majeur d’un quatre
vingtième ; c’eft - àr-dire d’un demi - quart de ton.
L e paffage fo l s la feroit donc diacommatique-Sc non
.pas chromatique. 20. Si l e la étoit égal au ja ,
-vingt huitième d’«t., la baffle-fondamentale du paf-
fa g e fo l f o l s fe , feroit ut mi qv, 4 , 5., 7,; dans
laq u e lle i l n’y a point de repos, fur le dernier
f o n ; un repos ne pou van t être produit que par
l a fucceffion fondamentale d’un Ion pair à un fan
imp air. Il r f y en auroit donc point après 1 e fo l s:;
iâonc le fo l s ne feroit pasifaiivé.
Nota~ 20. La baffle-fondamentale ut -mi ta eft un
:paffage du mode d é t a i l tnode de fe. I l doit-donc
y avoir un repos après Y ut. D o n c j l doit y en
-avoir un après le fo l du chant fol fols. la. Donc
3 e fo l eft fépare du f o l s , & ne fait point partie
-de la même phrafe , ou du même membre de
phrafes. D o n c le s notes- fo l fol s n’appartiennent
. -point au même genre ; donc elles ne conftituent
p a s un g en re , proprement dit , à l’égard des
p o te s f o l s la ; elles forment un d em i- to n majeur
, c’eft-à-dire un intervalle diatonique. D on c
«dans les notes fo l fo l s la , i l n’y a poin t d’interva
lle chromatique.
‘Conclurons-nous de-îa que les modernes n’ont
p o in t de genre-chromatique? Non. Mais-c’eft dans
La iréfolxitlon .de la quinte fu p e râ u e , & dans c e lle
^xte italienne , qu’il faut chercher des paf.
lages de ce genre.
r } r ^ CS ^ta 'ens Auvent ainfi la quinte fuperflue;
fo l f i re; fol f i r e s ; . , ., fo l ut mi. Les deux premiers
accords appartiennent à la même baffle-fondamentale,
ut, I ; le chant paffant du re au re s dans
le même accord. O r , le demi-ton de re s à mi
dans le rapport de 19 à 20 eft un véritable intervalle
chromatique. L e chant re re s mi appartient
donc au genre chromatique. (V o y e z l’art.
Quinte de Rouffeau.)
2 • Les François la fauvent par cette fucceffion
d a c co rd s ,./ re fa la ; . . . . ut mi-fol S, ut mi LA;
dans ‘laquelle l ’accord ut mi fo l s a auffi pour
baffle-fondamentale ut 1. O r , l’accord ut mi f o l s ,
10 , 2 0 , 25 , de la première colonne fe réfout fur
1 accord ut mi ta , 1 6 , 20^ 26 , de la feconde.
(T a b le de la génération harmonique.) L ’accord
ut mi la n’eft donc qu’une altération de l’accord
ùt mi ta. L e fol s ferme donc avec le la un demi-
ton dans le rapport de 25 à 26 , intervalle de la
gamme chromatique. Le chant la fo l s fe appartient
d o n c au genre chromatique.
30. Enfin la fitte fuperflue ou italienne fa la
f i re s , n e f t dans fa forme primitive autre chofe
que l’accord f v t a f i re S } 11 , 1 3 , 1 5 , 1 0 ;
fequel le refout^fur l’accord mi la ut mi ou fol
la. ut mi. Les modernes employant le premier,
afin de faire réfoudre le fa de l’accord de fixte-
luperflue fur le mi fu iv an t , a-vet lequel il forme
un demi-ton ; mais le fa naturel ou harmonique
doit fe refoudre fur le f o l , duquel il efi moins
éloigné que du mi. Car la fraftion — , qui exprime
l ’intervalle du fa naturel au f o l , efi moindre
que la fra&lon f | qui exprime le rapport du
même fa ^u mi. Dans les deux cas le re s- fait
avec le mi un demi-ton, ou Intervalle chromatique
de 19 à 2-0. ( Génération harmonique,
col. I & IL ) L a réfolution de la fixte-fnperflue
appartient donc encore au genre chromatique.
L harmonie du genre chromatique moderne efi
donc auffi naturelle que ce lle des genres de la
mufique g re cq u e , puifqu’elle eft le produit des
deux premiers fons de la baffle - fondamentale
naturelle.
Genre enharmonique moderne. (V o y e z l ’article
Enharmonique de Rbuffeaii, ) L ’accord de feptième
•diminuée f o l s f i /<?ƒ>,'regardé par les modernes
comme fenfible en -mineur de f e , c’e f t - à-clrre
-comme faisant partie deTaccord mi fet $ f i re fa.,
partage , comme tous fes • renverfemens’ l'octave
en quatre parties à-peu-près égales. Tous
fe s renverfemens f i ré fa f o l s ; re fa fo l s f i &
f o f o l s f i re , pourraient -donc être regardés
comme autant de fenfibles , en les fuppofant
compofés de -trois tierces mineures, comme leur
accord primitif f o l s f i re f a ; c’eft-à-dire e n les
transformant ainfi : (i re fa la b ; re fa la b ut b ;
fa la b ut b mi b b. L e prétendu ■ genre etihârmo-
ni$ue moderne confiffe à préparer l’un -de ces‘trois
Mcorcls fous une forme, & à le fauver fous une
mure : par exemple , ^préparer le prenuer fous la
forme de fixte fenfihle du mode de la , f i re f
fo l* . & à le fauver fous la forme de feptieme
diminuée., c’efl-à-dire de fenfible du mode d ut |
T r i fa Ùb. O r , foit .que l’on confidère cette
tranfmmafion par rapport au chant, y t la bajle-
fondamcntale, ou à la forme originelle des accords,
ion n’y découvrira pas la moindre trace du genre
enharmonique. .
i°. Le paffage du f o l s au la b n appartient point
à ce genre, mais au diacommatique. Car il eft
clair que les intervalles diatoniques du mode d ut
font, contenus dans la quatrième oélave de fes
harmoniques, ( Génération harmonique , col. 1. )
entre le huitième & le feizième degré ; Us chromatiques
-ou demi-tons dans -la cinquième octave ,
entre fe feizième & le trente-deuxième; les enharmoniques
ou quarts-de ton dans là fixième oftave ,
entré le trente-deuxième & le -foixâme-quatrième ;
enfin les diâcommatiques, commas ou demi-quarts
de ton, dans la feptième oétave, entre le foixante-
quatrième & le cent vingt-huit-ème degré. Or ,
le f o l s , dans la première colonne des harmoniques
&ut, égale 25 ou i f 5 : le lab comme tierce
mineure de f a , égale if-8. Donc 4e fo l# e^ . au
lab, comme 125 eft à 128; donc l’un diffère
de l’autre de’ ï|-8. O r , f f f eft un intervalle dia-
commatique. Donc le paffage ‘du fol m au lab eft
un paffage diacommatique , 3k aion pas enharmonique.
2°. La baffle-fondamentale de ce paffage appartient
au genre chromatique. Car on a vu ci-deffus
que les mouvemens fondamentaux d’oétave, de
quinte & de quarte font-fpécialement & exclufi-
vement affeétés au genre diatonique ; 3k les mouvemens
de tierce au genre chromatique. O r , l’accordfo
l s f i re fa étant regardé comme fenfib’e
du mode de f e , tous fes renverfemens font cenfés
dans le mode de la. Donc lorfqu’on employé le
premier de fes renverfemens , fuccefllvèment fous
les deux formes f i re fa f o i s 8c f i re fo la b ,
©n eft ceflfé paffer du -mode de fe, a. celui d u t ,
par un mouvement fondamental de tierce mineure-;
& par conféquent entrer dans le genre chromatique.
En paffant de re fa fols, f i 9 â. re fa la ut b,
on paffe du mode de fe à celui de mi b par un
mouvement fondamental >de fait fie quinte-; mouvement
interdit à la baffle-fondamentale. Enfin le
changement de fa fol S f i re , en fa la b ut b mibb
fe fait en paffant du mode de la .à. celui de fol ■'
par un mouvement fondamental de feconde fuperflue.,
qui peut être permis à la baffe-fondamentale
, en le regardant comme tierce mineure ;
ce qui placera encore l’harmonie dans le genre
; chromatique. Je fuppofe que-efans tous les chan-
gemens -la première forme de l’accord eft regardée
comme renverfement de l’accord fo l s fi re fa ,
& la feconde comme feptième diminuée, c’éft-
B A S t 4 9
ces combinaifons de l’accord de feptième diminuée.,
imaginées par Rameau , fe réduifent donc .à une
feule- combinaifon régulière, mais qui n’a rien
du genre enharmonique ; puifque le chant qu’elle
produit appartient au genre diacommatique, & fe
baffle fondamentale au chromatique.
*3°. O n trouvera le même réfultat en rapportant
l’accord de feptième diminuée à fa forme
originelle. Car la feptième diminuée, fo l s f i re fa
n’eft qu’ un renverfement du triton re fa fo l s /m
lequel n’eft lui-même qu’une altération de l’accord
impair .re fa ta fi., 9,, 1 1 , 1 3 , 1 5 ; qui a
pour baffle - fondamentale , u t, 1 , & fe réfout
par un mouvement fondamental d’o&ave , fur
l’a c co rd , mi f o l la u t , 1 0 , 12 x 1 4 , 1 6 ; le fa
naturel montant au fo l -pour les raifons que j ’ai
expofées c id e ffu s . (V o y e z au N°. I de cet artic
le , les expériences qui concernent là progrëflîon
inmaire. ) O r , l’accord mi fo l la ut eft une des
faces de Tacçord parfait naturel ut mi fo l la u t ,
4 ,, 5 , 6 , 7 , 8, ou 8 , 10^ 1 2 , 14, 16. ( V o y .
Accord parfait & Sixte ajoutée. ) L ’acco'rd re fa
ta f i , qui fe réfout fur mi fo l la u t , eft donc
un accord fenfible du mode d'ut. Il en faut dire
autant.de re fa fo l s f i 9 qui eft l e même ac cord ,
altéré par le .tempérament moderne. T o u s les renverfemens
de re fa fo l s fi appartiennent donc
au mode d’fct. D o n c par les transformations de
Rameau fa f o l s f i re peut .devenir fenfible- de
mi b ; foi s f ir e fa fenfible en fa 8c.fi refo fo l S
fenfiblé en -la. O r , ces trois changemens ne peu”
vent s’opérer qu’en regardant fucceffivement cha- <
cun de ces trois accords comme renverfement de
re fa fol s f i & comme fenfible ; -c’eft - à - dire
qii’en paffant du mode d’ ut au mode de mi b ; ou
au mode 'd e f i s , au au mode de la; c’eft-à-dire
qu’en faifant faire à la baffle-fondamentale .un mouvement
de tierce mineure afeendant ; de • quarte
fuperflue, ou de tiercé mineure ei\ defeendant.
O r , le premier & -le dernier d e ,ces mouvemens_
conftituent le genre chromatique'; le fécond eft
interdit-à la baffle-fondamentale. Dans tout cela on
n’apperçoit pas la moindre trace, du. genre enharmonique.
(V o y e z Septième diminuée.)
Cependant nOs recherches n.’ont pas été abfi>
lument vaines , p.uifque nous-,avons découvert en
paflant que lés deux accords le s plus favans ,
ceux; dont Rameau Tu Tartini .n’ont pu parvenir
à trouver l’origine ; en un mot , la feptième diminuée
& la fixte- italienne , -font abfoiument le
même accord ; & fe feuvent par le même mouvement
fondamental , par le .mouvement .dkxftave»
Car on a vu que la forme originelle de la feptième
diminuée, ou plutôt du triton avec tierce
mineure, re f a f o l s f i , .9 , i l - 11^ 1 ^ 5 eft ire f v ta f i , - 9 , 1 - 3 , 15 ; que celle .de fa
fixte italienne ou fuperflue, fa la f i r e s ,
^ ^ 1 5 . , , é f t f v ta fi-ut s reX, 1 1 , 1 3 , i 5ï»
17 , ,19 , dont on a retranché le troifième terme^
afin die pouvoir ,1a .refendre fe r .un. accord jcob