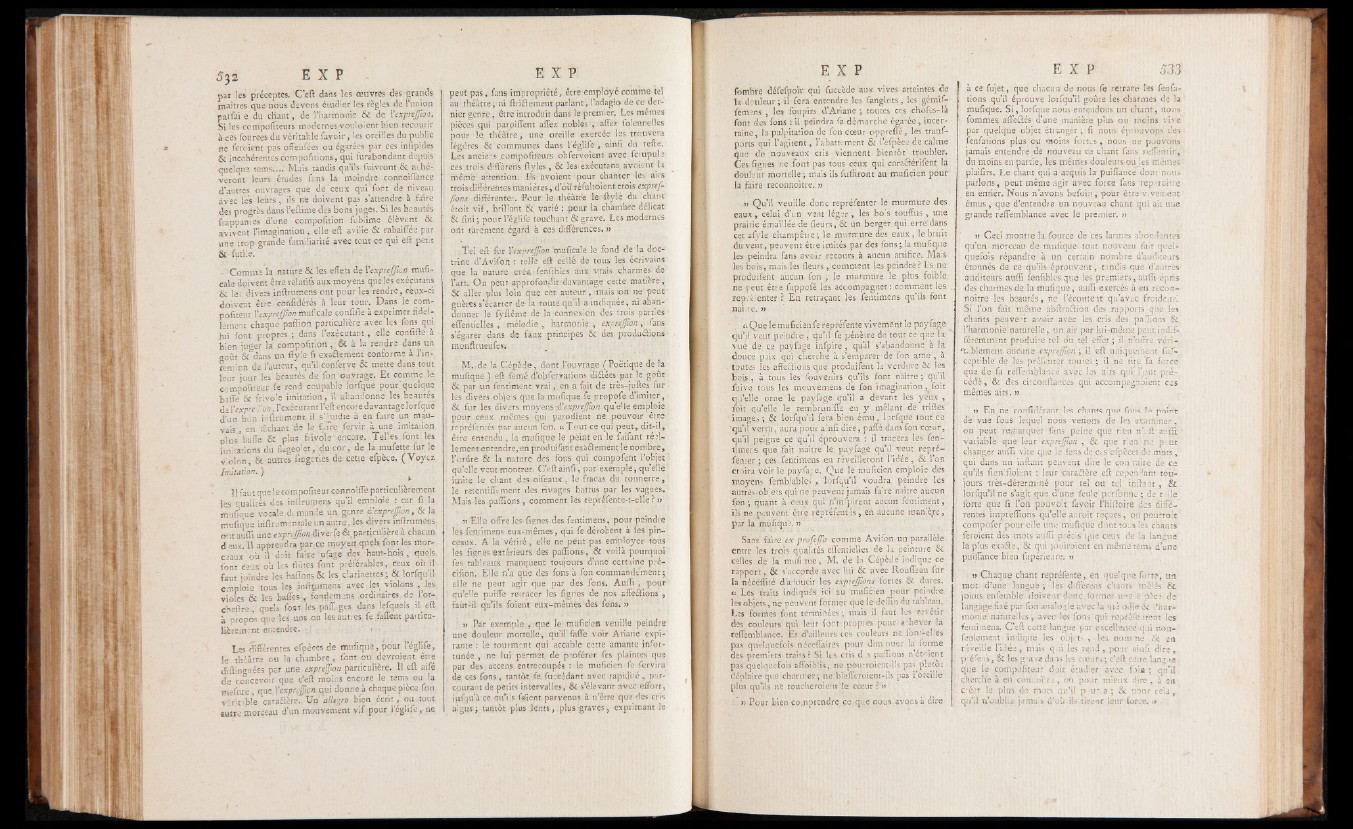
par les préceptes. C ’eft dans les oeuvrés des grands
maîtres que nous devons étudier les règles de l’union
parfai e du ch ant, de l’harmonie 8e de Yexprejfion.
Si.les compofiteurs modernes^vouloient bien recourir
à ces fources du véritable favoir , les oreilles du public
ne feroient pas offenfées ou égarées par ces infipides
& incohérentes comportions, qui furabond'ent depuis
quelque tems.... Mais tandis qu’ils-fuivront & achèveront
leurs- études fs ns là moindre .conhoiffance
d’autres ouvrages que de ceux qui font de niveau
avec les leurs, ils rie doivent pas s’attendre à faire
des progrès dansTeftime des bons juges.’ Si les beautés
frappantes d’une compofition fublîme élèvent &
avivent l’ imagination, elle eft avilie & rabaiffee par
une trop grande familiarité avec tout ce qui eft petit
& futile.
- "Comme la nature & les effets de Yexpreffim mufi-
cale doivent être relatifs aux moyens que les. exécutans
& le; divers inftrumens ont pour les rendre, ceux-ci
doivent être conftdérés à leur tour. Dans le com-
pofiteur Yexprefjlon muficale confifte à exprimer fid'el-
lsment chaque paffion particulière avec les fons qui
lui font propres ; dans l’exécutant, elle confifte à
bien juger la compofition , & à la rendre dans un
oout & oans un ftyle fi ex-a&ement conforme à l’in tention
de l’auteur, qu’ilconferve & mette dans tout
leur jour les beautés de fon ouvrage. E t comme le
ccmpofiteür fe rend coupable lorfque pour'quelque
bafle & frivole imitation, il abandonne les beautés
de Yexpre'J.on, l’exécutant l’eft encore davantage lorfque
d’un bon inftrinûent il s’étudie à en faire un mauvais
en tachant de le faire fervir à une imitation
plus" baffe- 8c plus frivo le ' encore. T elle s font 'les
imitations du flageolet/ du c o r , de la mufette fur le
v io lo n , 6c autres ftogeries de cette efpèce. (V o y e z
Imitation. )
11 faut que le compofiteurconnoiffe particulièrement
les qualités des inftrumens qu’il emploie ; car f i la
mufique vocale demande u a genre d’exprefion, & la.
mufique mftrumentalemn autre, les. divers inftrumens
ontauffi une expfejJwn àiverÏQ& particulière à chacun
d eux. 11 apprendra pàrLqe moyen quels, font les morceaux
où il doit faire ufage ;des haut-bois , quels,
font ceux où les flûtes font préférables, ceux où il
faut joindre les baffons & les. clarinettes ; & îorfqu’il
emploie tous les inftçutnéns . avec les violons ^les,
violes & les baffes fondement «ordinaires de l’or-,
cheftre,, quels, foat. les-pàffrges daps lefquels i l eft,
à propos que les uns,ou les autres, fe faffent particulièrement
entendre. _ J
Les différentes efpèces de mufique, pour l’églife,
le théâtre ou la chambre, font ou devroient être
diftinguées par une exprejjïon particulière. Il eft aifé
de concevoir que c’eft moins encore le tems ou- la
mefure, que Yexprçjjicn qui donne à chaque pièce fon
véritable cara&ère. Un' allegro bien éc r it, ou tout
autre morceau d’un mouvement v i f pour J’ég li(e, ne
peut pa s, fans impropriété, être employé.comme tel
au théâtre / ni ftri&ement parlant; l’adagio de ce dernier
genre, être introduit danf le premier. Les mêmes
pièces qui parpiffent affez nobles , affez folennelles
pour le théâtre, uné oreille exercée les trouvera
légères & communes dans leg li’fe , ainfi du refte.
Les ancie'5 .compofiteurs obfervoient avec fciupula
ces trois diftérehs ftyles , 6c les* exécutans, avoient la
même attention. Ils àvoient pour chanter les airs
troisdifférentes manières, d’oifréfultoienttrois expref-
fions différente.'. Pour le théâtre leoft-ylè du chant
étoit v i f , brillant & varié : pouf la.chambre délicat
8c fini; pour l’églife touchant 8c grave. Les modernes
ont rarement égard à ces différences. »
T e l eft fur Yexprejfion muficalele fond de la doctrine
d’Avifoft': telle eft .celle de tous; les écrivains
que la nature Gréa • fenftbles aux virais charmes de
l’art. O n peut approfondir davantage cette matière’,
Ôc aller -plus loin que. cet auteur , mais ;oiî neJ peut
guères s’écarter de-la route qu il a indiquée, ni abandonner
le fÿftême de la connexion des trois parties
efîentielles , mélodie , harmonie., exprejjïon , fans,
s’égarer dans de faux .principes & des produ&ions1
monftrueufest
M. de la G épèd e, dont l’ouvrage { Poétique de la
mufique ) eft femé d’obfervations diétées par le gOut
6c par un fentiment v ra i, en a fait de très-juftes fur
les divers objets que la mufique le propofe d’imiter,
8c .fur les. divers moyensr$ exprejjïon qu’elle emploie,
pour ceux mêmes qui paroiffent ne .pouvoir .être
représentés par aucun fon. « T o u t ce qui p e u td i t - i l ,
être entendu, la mufique le peint en le faifant réellement
entendre, en produifant exà&ement le nombre,
l’ordre & la nature des fons qui compoferit l’objet ’
qu’elle veut montrer. C ’eft ainfi, par exemple, qu’ellé
imite le chant des oifeaux , le fracas du tonnerre,
le retentifft ment des rivages battus par les vagues.
Mais les pallions, comment les repréfente-t-ellè ? »
, » Elle offre les fignes des fentimens, pour peindre
les fentimens'eux-mêmes, qui fe dérobent à fes pinceaux.
A la v érité, elle ne peut pas enfployer tous
les fignes extérieurs des paflions-, 8c voilà pourquoi
fes tableaux manquent toujours d’une certaine pré-
cifton. Elle n a que des fons à fon commandement ;
elle ne peut agir que par des fons. A u f l i , popr
: qu’elle puiffe retracer les fignes de nos affeéHôns ,
faût/il qu’ils fôient eiix-mêmès des fdris. »
a Pâr exemple , que le 1 muficien veuille peindre
une-douleur mortelle -, qu’i l faffe voir Ariane expirante
: le tourment qui accable cette amante infortunée
, ne lui permet, de proférer fes plaintes que
par des ac.cens entrecoupés : le muficien fe fervira
de ces fons , tantôt; ffei fuccédant avec rapidité , parcourant
de petits intervalles-, & s’élevant avec effort,
jufqu’à çe qu’ils fdient parvenus à n’être que des cris
aigus ; tantôt plus .lents, plus graves, exprimant le
fombre défefpoir qui fuccède aux vives atteintes de
la douleur ; il-fera entendre les fanglots., les gémif-
femens , les foupirs d’Ariane ; toutes, ces ehofes-là
font des fons : il peindra fa démarcjie égarée, incër-
taine, ,1a palpitation de fon coeur opprefle, les tranf-
pprts qui l’agitent, l’abattement 6c l’efpèce de calme
que de nouveaux cris viennent bientôt troubler.
Ces fignes ne font pas tous ceux qui çaraâérifent la
douleur mortelle; mais ils fuffiront au muficien pour
la faire reconnoître..»
» Qu ’il veuille donc repréfenter le murmure des
e a u x , celui d’un vent lé g e r , les bois touffus , Une
prairie émaillée de fleurs, 6c un berger qui erre'dans
cet afyle champêtre; le murmure des eaux, le bruit
du v ent, peuvent être imités par des fons ; la mufique
les peindra fans avoir recours à aucun artifice. Mais
les bois, mais les fleurs , comment les peindre? Ils.ne
prodüifent aucun fon .; le murmure le plus.- fqib.le
n e peut être ftippofé les accompagner : comment les
représenter ? En retraçant les fentimens qu’ils font
naî;re. »
• , a Qu e le muficien fe représente v ivement le payfage
qu’il veut peindre , qu’il fè pénètre de tout ce que la
vue de. cé payfage infpire , qtwl s’abandonne a la
douce paix qui cherche à s’emparer-de fon ame , à
toutes les affeéliôns que prodüifent la verdure 8c les
boisi, à tous les’ fouv.enirs qu’ ils font naître;- qu’il
fuive. tous les mouvemens de fon imagination , foit
qu’elle orne le payfage qu’il a devant les yeux ,
foit qu’elle le remhrunifle en y mêlant de triftes
images 6c lorfqu’iî fera bien ému , lorfque tout ce
qu’il verra, aura pour ainfi dire, pafté-danS fon coeur,
qu’il peigne ce qu’il éprouvera : il tracera les fèn-
timers que fait naître le payfage qu’il veut repré-
fenter ; ces fentimens en réveilleront l’id ée, 8c l’on
croira voir lè pàyfa: e. Qu e le muficien emploie des
moyens femblablès , lorfqu’il voudra peindre les
autres-pb’ets qui ne peuvent jamais faire naître aucun
fon ; quant à ceux qui ri’ infpirent aucun fentiment,
ils ne peuvent être rep'réientés, en aucune manière,
par la mufique. »
Sans" faire ex profejfo comme Avifon un-parallèle,
entre les trois q y alités effentielles ■ de la peinture 8c
celles de la mufique, M. de ln Cépède indique ce
rapport, 8c s’accorde avec lui 8c avec Roufféau fur
la nécéffité d ’a iducir les exprejfions fortes 8c dures.
a Les traits 'indiqués ici au muficien pour peindre
les objets, ne peuvent former que le deffîn du tableau.
Les formes font terminées; mais il, faut les revêtir
des couleurs qui leùr font propres pour arhever la
reffemblance. E t d’ailleurs ces couleurs ne fonr-elles
pas quelquefois néceftaires pour dimnner la forme
des premiers traits ? Si les cris d .s paflions. n’étoient
pas quelquefois affoiblis, ne pourroient-ils pas plutôt
déplaire que charmer; ne blefieroient-ils pas l’oreille
plus qu’ils ne toucheroient le coeur ? »
■ s? Pour bien comprendre ce que nous avons à dire
à ce fuje t, que chacun de nous fe retrace les fenfa-
tions qu’il éprouve lorfqu’il goûte les charmes de la
mufique. S i , lorfque nous entendons un ch ant, nous
fommes, affeélés d’une manière plus ou moins vive
par quelque objet étranger ; fi nous éprouvons des
fenfations plus ou moins fortes , nous ne pouvons
jamais entendre ^dé nouveau ce chant fans reftentir,
du moins en partie, les mêmes douleurs o u je s mêmes
plaifirs. L e chant qui a acquis la puiiïance dont nous
parlons, peut même agir avec force fans repcroître■
. en entier. Nous n ’avons b e fo in , pour être vivement
émus, que d’enteridre un nouveau chant qui ait une
1 grande reffemblance avec le premier, jj
» Ceci montre la fource de ces larmes abondantes
qu’un morceau de mufique tout nouveau fait quelquefois
répandre à un certain nombre d’auditeurs
étonnés de ce qu’ils éprouvent, tandis que d’autres
, auditeurs aufli fenfibles que les premiers, aufli-épris
des charmes de la mufique, aufli exercés à en recon-
noître les beautés, rie l’écoutent qu’avec froideuri
Si l’on fait 'même abftraâion des rapports que les
chants peuvent avoir avec les cris des paillons &
l’harmonie naturelle , un air par lui-même peut indifféremment
produire tel ou tel effet ; il ri’oiTre véritablement
aucune exprejjïon ; il eft uniquement fnf-
' ceptible' de les préfemer toutes ; il ne tire fa force
que. de-fa réffemblance avec les a'rs qui l’ont préc
é d é , & des circonftances qui accompagnoient ces
mêmes airs, jj
jj En ne'confidérant les chants que fous le point
de vue fous lequel nous venons de les examiner,
i on peut remarquèr fans peine que rien n’eft aufli
; variable que leur exprejfiori , & que rien ne peut
: changer aufli vite que le fens de ces efpèces de mots, •
qui dans un inftarit peuvent dire le con.raire de ce
qu’ils ftgnifioient : leur caraclère eft cependant toujours
très-déterminé pour tel ou tel inftânr , &
lorfqu’il ne s’agit que d’une feule perfonne ; de telle
fortè que fi l’on pouvblt favoir Fhiftoire des différentes
imprefiions qu’elle auroit reçues, on pourroit
compofer pour elle line mufique dont tous les chants
feroient dès mots aufli précis'que ceux de la langue
là plus exaâ'e, & qui jôuiroient en même tems d’une
puiffance bien fupérieure. »
jj Chaque chant repréfente, en quelque forte, un
mot d’une langue ; les differens chants mêlés 8c
joints enfemble doivent donc former une e pèce de
langage^fixé par fon analogie avec la nié odie & /harmonie1
naturelles ,■ avec les fons qui repréfe lient les
fentimens. C ’eft certe langue par excellence qui non-
feulement indique les objet». , les nomme & en
réveille l’idée , mais qui les rend , pour ainfi d ire ,
'préfeos, 8c les g -ave dans les coeur, ; c’efl cette langue
que le .composteur doit étudier avec foi» ; qu’il
cherche à en corinoî're, ou pour mieux d ire , à en
créer le plus de mots qu’il p n i r .a ; 8i polir ce la ,
qu’il n’oublie jamais d’où fis tirenf leur force. » -