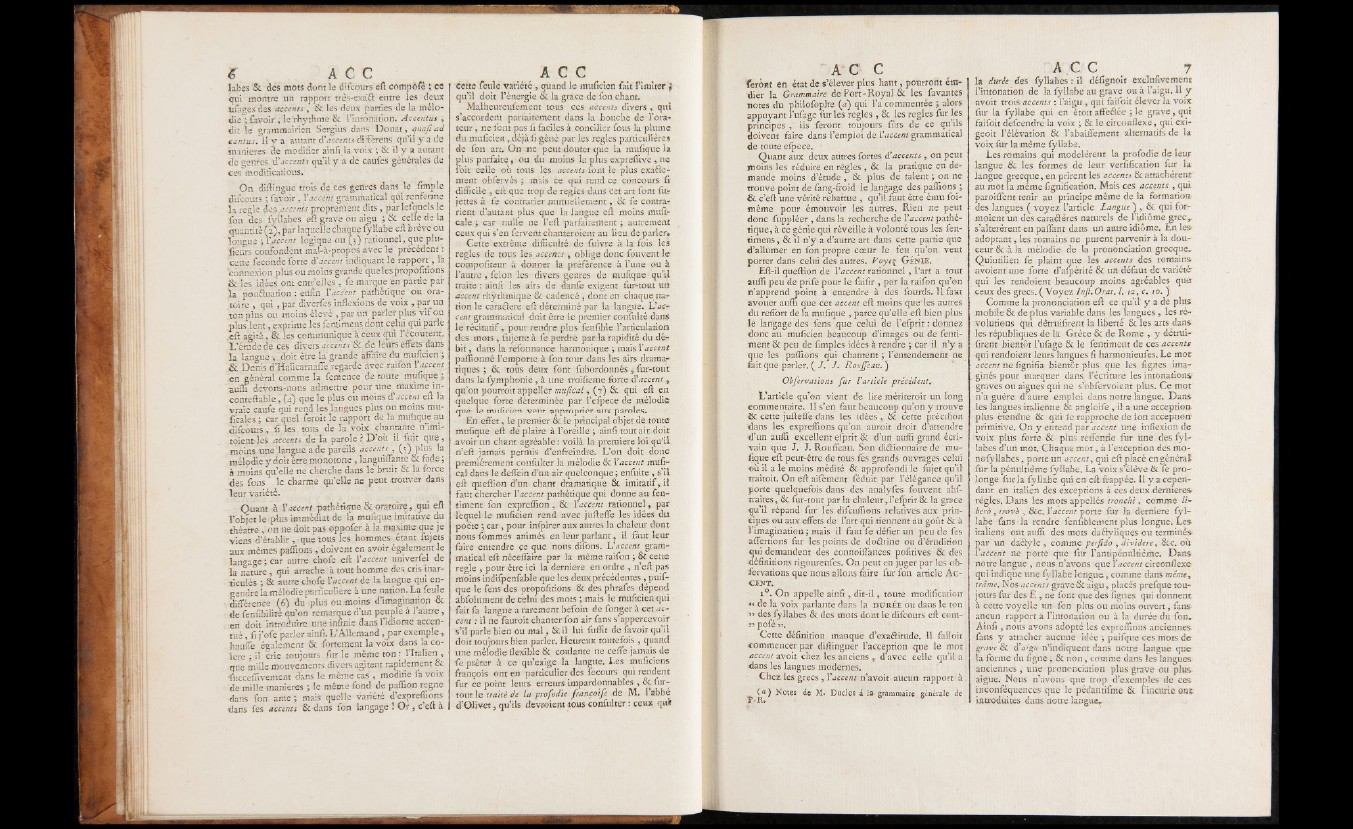
éT A C C
labes & des mots dont le difcçrars eft eompèfê ; ce
bui montre un rapport très-exàél entre les deux
-tuâmes des accents-, & les deux parties de la mélodie^
favoirVle rhythme & 1’intonàtiôn. Àccentus ,
dit le grammairien Sergius dans Donat, quafi ad
camus, il y a autant d'accents cSfférens qu’il y a de
manières de modifier ainfi la voix ; & il y a autant
de genres d'accents qu’il y a de caufes générales de
ces modifications.
On distingue trois de ces genres dans le fimple
dlfcours ; favoir. Y accent grammatical qui renferme
la réglé des [accents proprement dits, par lefquels le
ion des fyîîabes eft grave ou aigu ; & celle de la
quantité (2), par laquelle chaque fyllabè eft brève ou
longue ; Ypccent logique ou (3) rationnel, que plusieurs
confondent mal-à-propos avec le précédent :
cette fécondé forte d'accent indiquant le rapport, là
connexion plus ou moins grande queles propoftions
& les idées ont entr’elles , fe marque en partie par
la pon&uation : enfin Y accent pathétique ou oratoire
, qui » par divèrfes inflexions de voix , par un
ton pins ou moins élevé , par un parler plus v i f ou
plus,lent, exprime les fentimens. dont celui qui parle
.eft agité, & les communique à ceux qui l’écoutent.
L ’étude de ces divers accents & de leurs effets dans
la langue 4.,doit être la grande àfiaîre dia muficien;
& Denis d’Halicarnafie regarde avec raifon Y accent
en général comme la fersence de toute mufique ;
■ aum devons-nous admettre pour Une ^maxime in-
conteftable, (4) que le plus ou moins cfaccent eft la
vraie caufe qui rend les langues plus pu moins musicales
; car quel feroit le rapport de la miifique au
difcours, fi' les tons de la voix chantante n’irm-
toient’lcs accents de la parole r D ’pii il fttit que,
moins une ^langue a de pareils accents , (3) plus la
mélodie y doit être monotone , langiiîffante & fade ;
à moins qu’elle ne cherche dans le bruit & la force
des fons le charme qu’elle ne peut trouver dans
leur variété.
Quant à Y accent pathétique & oratoire, qui eft
l ’objet le plus immédiat de la mufique imitatiye du
théâtre on ne doit pas oppofer à la maxime que je
viens d’établir , que tous les hommes étant fujets
aux mêmes paflions , doivent en avoir également le
langage ; car autre choie eft Y accent univerfel de
la nature, qui arrache à tout homme des cris inarticulés
; & autre chofe Yaccentdo la langue qui engendre
la mélodie particulière à une nation. La feule
différence (6) du plus Ou moins d’imagination &
de fenfibilite qu’on remarque d’un peuple a 1 autre,
en doit introduire .une infinie dans l’idiome accentué
, fi j’ofe parler ainfi. L ’Allemand, par exemple ,
hauffe également & fortement la voix dans La colère
; il crie toujours fur le même ton : l’Italien ,
que mille mouvements divers agitent rapidement &
fucceffivement dans le même cas , modifie fa voix
de mille maniérés ; le même fond de paffion régné
dans fon ame ; mais quelle variété d’expreffions
dans fies accents & dans fon langage ! O r , c eft à
A C C
cette feule variété , quand le muficien fait l'imiter }
qu’il doit l’énergie & la grâce de fon chant.
Malheureufement tous ces accents divers , qui
s’accordent parfaitement dans la bouche de Fora*
teur, ne font pas fi faciles à concilier fous la plume
du muficien, déjà fi gêné par les réglés particulières
de fon art. On ne peut douter que la mufique la
plus parfaite , ou du moins la plus exprefiive , ne
lbit celle oh tous les accents font le plus exactement
obfervés ; mais ce qui rend ce concours fi
difficile , eft que trop de réglés dans cet art font fur
jettes a le contrarier mutuellement, & fe contra?
rient d’autant plus que la langue eft moins mufir
cale ; car nulle ne l’eft parfaitement ; autrement
ceux qui s’en fervent chanteroient au lieu de parler*
■: Cette extrême difficulté , de fuivre à la fois les
réglés de tous les accents ÿ oblige donc fouvent le
compofiteur à donner la préférence à l’une ou à
l’autre , félon les divers genres de mufique • qu’il
traite : ainfi les airs de danfo exigent fur-tout uni
accent rhythmique & cadencé , dont en chaque nation
le caraélere eft déterminé par la langue. L'accent
grammatical doit être le premier confulté dans
le récitatif, pour rendre plus fenfible l’articulation
des mots , fujette à fe perdré par la rapidité du débit
, dans la refonnance harmonique ; mais Y accent
paffionné l’emporte à fon tour dans les airs dramatiques
; & tous deux font fubordonnés , fur-tout
dans la fymphonie , à une troifieme forte a accent 9
qu’on pourroit appeller mufcal, (7) & qui eft en
quelque forte déterminée par Fefpece de mélodie
que le muficien veut approprier aux paroles.
En effet, le premier & le principal objet dé toute
mufique eft de plaire à l’oreille ; ainfi tout air doit
avoir un chant agréable : voilà la première loi qu’il
n’eft jamais permis d’enfreindre. L’on doit donc
premièrement confiilter la mélodie & Y accent müfi-
cal dans le deffein d’un air quelconque ; enfuite , s’il
eft queftioil d’un chant dramatique & imitatif, il
faut chercher Y accent pathétique qui donne au fen-
timent fon expreffion, & Y accent rationnel, par
•lequel le muficien rend avec jufteffe les idées dis
poète ; car, pour infpirer aux autres la chaleur dont
nous fournies animés en leur parlant * il faut leur
faire entendre çe que nous difons. L'accent grammatical
eft nécêffaire par la même raifon ; & cette
réglé , pour être ici la dêrniere en ordre , n’eft pas
moins indifpènfable que les deux précédentes, puisque
le fenS des propofitions & des phrafes dépend
abfolument de celui des mots ; mais le muficien qui
fait fa langue a rarement befoin de fonger à cet accent
: il ne fauroit chanter fon air fans s’appercevoif
s’il parle bien ou m a l, & il lui fuffit de lavoir qu’il
doit toujours bien parler. Heureux toutefoisquand
une mélodie flexible & coulante ne celle jamais de
fe prêter à ce qu’exige la langue. Les muficiens
françois ont en particulier des fecours qui rendent
fur ce point leurs erreurs impardonnables , & fur-
tout le traité de la profodie françoife de M. l’abbé
d’O liv e t, qu’ils devaient tous confiilter : ceux qifif
AC c
feront en état de s’élever plus haut, pourront étudier
la Grammaire de Port-Royal & les favantes
notes du philofopke (a) qui l’a commentée ; alors
appuyant Fufage fur les réglés , & les réglés fur lès
principes ils feront toujours fors de ce qu’ils
doivent faire dans l’emploi de Y accent grammatical
de toute efpece.
Quant aux deux autres fortes d’accents, on peut
moins les réduire en règles , & la pratique en demande
moins d’étude, & plus de talent ; on ne
trouve point de fang-froid le langage des paflions ;
& c’eft une vérité rebattue , qu’il faut être ému foi-
même pour émouvoir les autres. Rien ne peut
donc fuppléer , dans la recherche de Y accent pathétique,
à ce génie qui réveille à volonté tous les fentimens
, & il n’y a d’autre art dans cette partie que
d’allumer en fon propre coeur le feu qu’on vent
porter dans celui des autres. Poye^ Génie.
Eft-il queftion de Y accent rationnel, l’art a tout
auffi peu de prifie pour le faifir , par la raifon qu’on
n’apprend point à entendre à des fourds. 11 faut
avouer aum que cet accent eft moins que-les autres
du reffort de la mufique , parce qu’elle eft bien plus
le langage des fens que celui de Fefprit : donnez
donc au muficien beaucoup d’images ou de fenti-
ment & peu de fimples idées à rendre ; car il n’y a
que les paflions qui chantent ; l’entendement ne
fâit que parler. ( J. J. Roujfeau. )
Obfervations fur Varticle précédente
L’article qu’on vient de lire mériteroir un long
commentaire. Il s’en faut beaucoup qu’on y trouve
& cette jufteffe dans les idées , & cette précifion
dans les expreffions qu’on auroit droit d’attendre
d’un auffi excellent eiprit & d’un auffi grand écrivain
que J. J. Roufleau. Son dictionnaire de mufique
eft peut-être de tous fés grands ouvrages celui
©il il a le moins médité & approfondi le fujet qu’il-
traitoit. On eft aifément féduit par l’élégance qu’il
porte quelquefois dans des analyfes fouvent abf-
traites, & fur-tout par la chaleur, Fefprit & la grâce
qu’il répand fur les difcuffions relatives aux principes
ou aux effets de Fart qui tiennent au goût & à
l’imagination ; mais il faut fe défier, un peu de fes
affertions foir les points de doârine ou d’érudition
qui demandent des connoiffances pofitives & des
définitions rigourenfes. On peut en juger par les obfervations
que nous allons faire fur fon article A c cent.
i °. On appelle ainfi , dit-il, toute modification'
de la voix parlante dans la durée ou dans le ton
sî des fyllabes & des mots dont le difcours eft com-
w pofè ».
Cette définition manque d’exa&itude. Il falloit
commencer par distinguer l’acception que le mot
accent avoit chez les anciens , d avec celle qu’il a
dans les langues modernes.
Chez les grecs ,■ Y accent n’avoit aucun rapport à
(<*•) Noies
de M. Dudçs à la grammaiie générale de
ÎMU
A C C 7
la durée des fyllabes : il défignoit exclusivement
l’intonation de la fyllabe au grave ou à l’aigu. Il y
avoit trois accents : l’aigu , qui faifoit élever la voix
fur la fyllabe qui en étoit affeélée ; le grave, qui
faifoit defcendre la voix ; & le circonflexe, qui exi-
geoit l’élévation & l’abaiffement alternatifs de la
voix fur la même fyllabe.
Les romains qui modelèrent la profodie de leur
langue & les formes de leur verfification fur la
langue grecque, en prirent les accents & attachèrent
au mot la même fignification. Mais ces accents , qui
paroiffent tenir au principe même de la formation
des langues ( voyez l’article Langue ) , & qui for-
moient un des caractères naturels de l’idiome grec
s’altérèrent en paffant dans un autre idiome. En les-
adoptant, les romains ne purent parvenir à la douceur
& à la mélodie dé la prononciation grecque«^
Quiiitiiien fe plaint que les accents des romains
avoient une forte d’afpérité & un défaut de variété-
qui les rendoient beaucoup moins agréables que-
ceux des grecs. (V o y e z Infl.Orat. I. /s, c. 10. )
Comme la prononciation eft ce qu’il' y a de plus
mobile & de plus variable dans les langues , les révolutions
qui dêtruifirent la liberté & les arts dans
les républiques de la Grèce & de Rome , y détrui--
firent bientôt Fufage & le fentiment de ces accents
qui rendoient leurs langues fi harmonieufes. Le mot
accent ne fignifia bientôt plus que les figues imaginés
pour marquer dans Fécriture les intonations?
graves ou aigues qui ne s’ebfervolent plus. Ce mot
n’a guère d’autre emploi dans notre langue. Dans
les langues italienne & angloife , il- a une acception
plus étendue & qui fe rapproche de fon acception
primitive. On y entend par accent une inflexion de
voix plus forte & plus reffentie fur une des fy llabes
d’un mot. Chaque m ot, à l’exception des mo-
nofy llabes, porte un accent, qui eft placé en générât
fur la pénultième fyllabe. La voix s’élève & fe prolonge
fur la fyllabe qui en eft frappée. Il y a cependant
en italien des exceptions à ces deux demieres-
règles. Dans les mots appeliés tronchi, comme /i-
bero , trovb > &c. Y accent porte fur la derniere fy llabe
fans la rendre fenfiblement plus longue. Les-
italiens ont auffi des mots daâyiiques ou terminés«
par un dàéfyle , comme perfido , dividere, &c. ou
Y accent ne porte que fur l’antipénultièrîie. Dans
notre langue , nous n’avons que Y accent circonflexe
qui indique une fyllabe longue, comme dans même,
trame. Nos accents grave & aigu, placés prefque toujours
fur des E , ne font que des figues qui donnent
à cette voyelle un fon pins ou moins ouvert, fans
ancun rapport,à l’intonation ou à la durée du fon„-
Ainfi , nous avons adopté les expreflions anciennes
fans y attacher aucune idée ; puifque ces mots de
grave & d'aigu n’indiquent dans notre langue que-
la forme du figne, & non, comme dans les îângues
anciennes , une prononciation plus grave ou plus
aigue. Nous n’avons que trop d’exemples de ces
inconféquences que le pédantifme & l’incurie ont
introduites dans notre langue*-