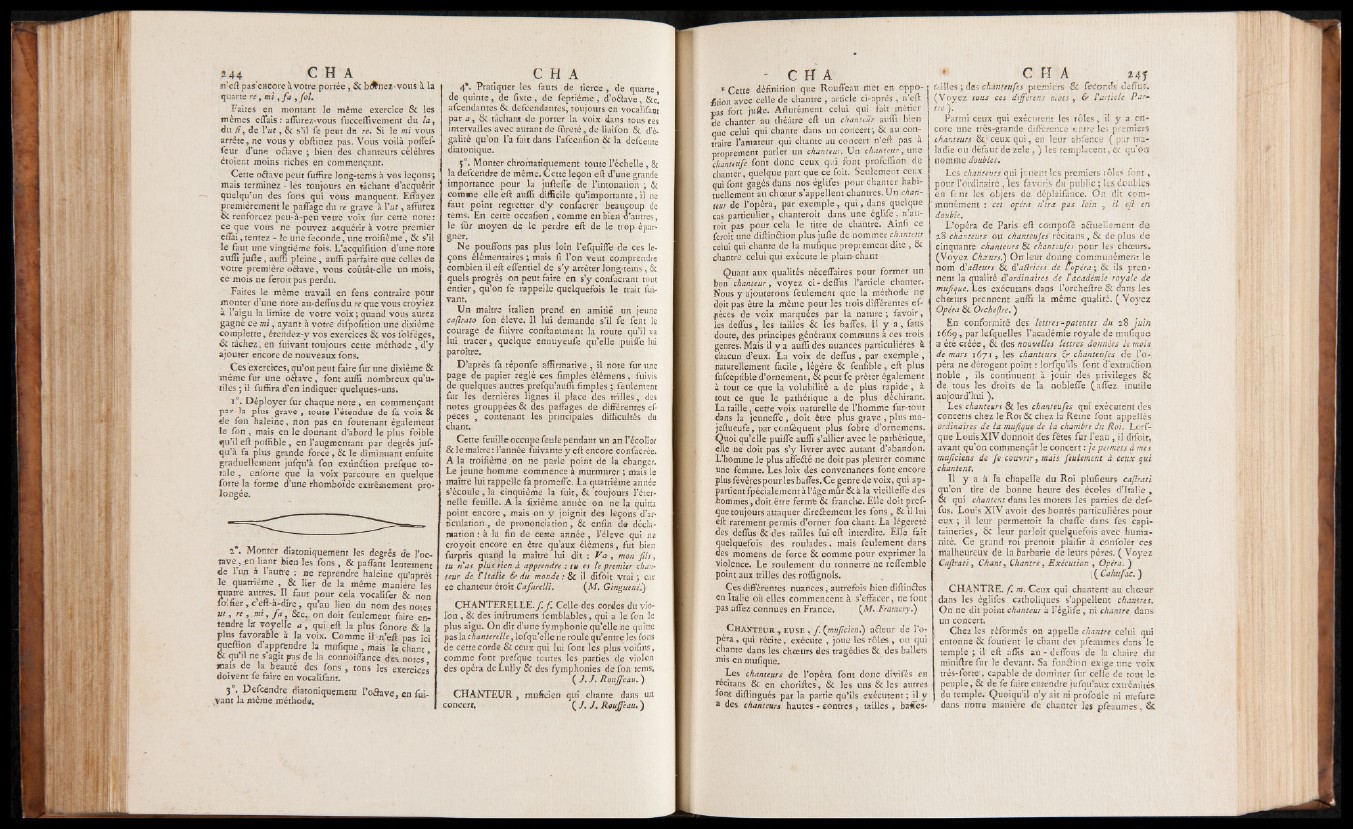
£44 € H A
■ n’eft pas’encore à votre portée, & bêliez-vous k la
•quarte r e , mi, f a , f o l .
Faites en montant le même exercice & les
mêmes effais : aflurez-vous fucceffivement du l a ,
du /f, de Y u t , & s’il fe peut du re. Si le m i vous
arrête, ne vous y obftinez pas. "Vous voilà poffef-
feur d’une oèlave ; bien des chanteurs célèbres
étoient moins riches en commençant.
Cette oâave peut fuffire long-tems à vos leçons ;
mais terminez - les toujours en tâchant d’acquérir
quelqu’ un des fons qui vous manquent. Effayez
premièrement le paffage du re grave à Y u t , affurez
& renforcez peu-a-peu votre voix fur cette note:
ce que vous ne pouvez acquérir à votre premier
eflai, tentez - le une fécondé, une troifième, & s’il
le faut une vingtième fois. L’acquifition d’une note
auffi jufte, aum pleine, aufli parfaite que celles de
votre première oéfave, vous coûtât-elle un mois,
ce mois ne feroit pas perdu.
Faites le même travail en fens contraire pour
monter d’une note au-deffus du re que vous croyiez
à l ’aigu la limite de votre voix ; quand vous aurez
gagne ce m i , ayant à votre difpofition une dixième
complette, étendez-y vos exercices & vos lolfèges,
& tâchez, en fuivant toujours cette méthode , d’y
ajouter encore de nouveaux fons.
Ces exercices, qu’on peut faire fur une dixième &
même fur une oftave, font aufli nombreux qu’utiles
; il fuffira d’en indiquer quelques-uns.
i° . Déployer fur chaque note , en commençant
par- la plus grave, toute l’étendue de fa voix &
de fen haleine, non pas en foutenant également
le fon , mais en le donnant d’abord le plus foible
qu’il eft poflible, en l’augmentant par degrés juf-
qu’à fa plus grande force , & le diminuant enfuite
graduellement jufqu’à fon extinélion. prefque totale
, enforte que la voix parcoure en quelque
forte la forme une rhomboïde extrêmement prolongée.
2*. Monter diatoniquement les degrés de l’octave^,
en liant bien les fons , & palTant lentement
de 1 un a l’autre : ne reprendre haleine qu’après
le quatrième , & lier de la même manière les
ouatre autres. Il faut pour cela vocaîifer & non
Ibiâcr , c cft-a-dire, quau lieu du nom des notes
u t 9 re y m i , f a 9 &Cj, on doit feulement faire entendre
la voyelle a , qui. eft la pins fonore & la
plus favorable à la voix. Comme ifon’eft pas ici
queftion d’apprendre la mufique , mais te chant
& qu’il ne s’agit pas de la connoiffance des notes ’
mais de la beauté des fo n s , tous les exercices
doivent fe faire en vocalifknr.
3°* Descendre diatoniquement I’o â av e , en ful-
vant la même méthode.
4*. Pratiquer les fauts de tierce, de quarte
de quinte, de fixte , de fepftème, d’o â a v e , &c!
afcendantes & defcendantes, toujours en vocalifaat
par a , & tâchant de porter la voix dans tous ces
intervalles avec autant de fureté, de liaifon & d’égalité
qu’on l’a fait dans Pafcenfion & la defcente
diatonique.
5°. Monter chromatiquement toute l’échelle , &
la defcendre de même. Cette leçon eft d’une grande
importance pour la jufteffe de l’intonation ; &
comme elle eft aufli difficile qu’importante, il ne
faut point regretter d’y confacrer beaucoup de
tems. En cette occafion , comme en bien d’autres,
le fur moyen de le perdre eft de le trop épargner.
Ne pouffons pas plus’ loin l’efquiffe de ces leçons
élémentaires ; mais fi l’on veut comprendre
combien il eft effentiel de s’y arrêter long-tems, &
quels progrès on peut faire en s’y confacrant tout
entier, qu’on fe rappelle quelquefois le trait fuivant.
Un maître italien prend en amitié un jeune
caflrato fon éleve. Il lut demande s’il fe fent le
courage de fuivre conftamment la route qu’il va
lui tracer, quelque ennuyeufe qu’elle piaffe lui
parohre.
D ’après fa réponfe affirmative , il note fur une
page de papier réglé ces fimples élémens, fuivis
de quelques autres prefqu’aufü fimples ; feulement
fur les dernières lignes il place des trilles, des
notes grouppées & des paffages de différentes ef-
pèces , contenant les principales difficultés du
chant.
Cette feuille occupe feule pendant un an récolter
& le maître: l’année luivante y eft encore confaerée.
A la troifième on ne parle point de la changer.
Le jeune homme commence à murmurer ; mais le
maître lui rappelle fâ promeffe. La quatrième année
s’écoule, la cinquième la fuit, & toujours l’éter-
| nelle feuille. A la fixième année on ne la quitta
point encore, mais on y joignit des leçons d’ar-
ticulation, de prononciation, & enfin de déclamation
: à la fin de cette année, Féleve qui ne
croyoit encore en être qu’aux élémens, fut bien
furpris quand le maître lui dit ; V a , mon fils,
tu nas plus rien à apprendre : tu es te premier ch an?
teur de Y Italie & du monde: 8c il difoit v ra i; car
ce chanteur étoit Cafarelli. (M. Ginguenél)
CHANTERELLE, ƒ f . Celle des cordes dit violon
, & des iiiftrumetTs femblables, qui a le fon le
plus aigu. On dit d’une fymphonie qu’elle ne quitte
pas la chanterelle, lofqu’elle ne roule qu’entre les fons
de cette corde & ceux qui lui font les plus voifins,
comme font prefque toutes. les parties de violon
des opéra de Lully & des fymphonies de fon tems.
( A J. Roujfeau. )
CHAN T EU R , muficien qui chante dans un
concert. ( J. J. Roujfeau, )
- C H A
* Cette définition que Rouffeau met en oppo-
Ætion avec celle de chantre , article ci-après , n’eft
pas fort jufte. Afîurément celui qui fait métier
de chanter au théâtre eft un chanteur aufli bien
que celui qui chante dans un concert; & au contraire
l’amateur qui chante au concert n’eft pas à
proprement parler un chanteur. Un chanteur, une
chanttufe font donc ceux, qüi font profeflion de
chanter, quelque part que ce foit. Seulement ceux
qui font gagés dans nos églifes pour chanter habituellement
au choeur s’appellent chantres. Un chanteur
de l’opéra, par'exemple , q u i, dans quelque
cas particulier, chanteroit dans une églife, n’au-
roit pas pour cela le titre de chantre. Ainfi ce
feroit une diftin&ion plus jufte de nommer chanteur
celui qui chante de la mufique proprement dite , &
chantre celui qui exécute le plain-chant
Quant aux qualités néceffaires pour former un
bon chanteur, voyez ci-deffus l’article chanter.
Nous y ajouterons feulement que la méthode nç .
doit pas être la même pour les trois différentes ef-
pèces de voix marquées par la nature ; favoir,
les deffus, les tailles & les baffes, il y a , fans
doute, des principes généraux communs à ces trois :
genres. Mais il y a aufli des nuances particulières à ;
chacun d’eux. La voix de deffus, par exemple,
naturellement facile , légère & fenfible | eft plus
fufceptible d’ornement, & peut fe prêter également
à tout ce que la volubilité a de plus rapide, à
tout ce que le pathétique a de plus déchirant.
La taille, cette voix naturelle de l’homme fur-tout
dans la jeuneffe, doit être plus grave , plus ma-
jeftueufe, par conféquent plus fobre d’ornemens.
Quoi qu’elle puiffe aufli s’allier avec le pathétique,
elle ne doit pas s’y livrer avec autant d’abandon.
L’homme le plus afteâé ne doit pas pleurer comme
une femme. Les loix dès convenances font encore
plus févères pour les baffes. Ce genre de voix, qui appartient
fpécialement à l’âge mûr & à la vieilleffe des
hommes, doit être fermé & franche. Elle doit prefque
toujours attaquer dire&ement les fons , & il lui
eft rarement permis cforner fon chant. La légèreté
des defîiis & des tailles lui eft interdite. Elle fait
quelquefois des roulades, mais feulement dans
des momens de force & comme pour exprimer la
violence. Le roulement du tonnerre ne reffemble
point aux trilles des roffignols.
Ces différentes nuances, autrefois bien diftinéles
en Italie ou elles commencent à s’effacer, ne font
pas affez connues en France. (M. Eramery.)
C h an t eu r , eu se , f . (mufiàen. ) aéleur de l’o-
pera, qui récite, exécute , joue les rôles , ou qui
chante dans les choeurs des tragédies & des ballets
mis en mufique.
Les chanteurs de l’opéra font donc divifés en
^écitans & en choriftes, & les uns & les autres
font diftingués par la partie qu’ils exécutent ; il y
a des chanteurs hautes - contres , tailles , baffes-
C H A 141
failles ; des chànteufes premiers & feèoncfs deffus'.
(V oyez tous ces différens mots , & l article Par-
S iP
armi ceux qui exécutent les rôles, il y a encore
une très-grande différence entre les premiers
chanteurs ceux qui, en leur abfence ( par maladie
ou défaut de ze le , ) les remplacent, & qu’on
nomme doubles.
Les chanteurs qui jouent' les premiers rôles font,
pour l’ordinairé , les favoris du publie ; les doubles
en font les objets de déplàifance. On dit communément
: cet opéra dira pas loin , il efi en
double.
L’opéra de Paris eft compofo actuellement de
28 chanteurs ou chànteufes' réckans, & de plus de
cinquante chanteurs & chànteufes pour les choeurs»
(Voyez Choeurs.) On leur donne communément le
nom d'aHeurs & d’a&rices de 1 opéra‘9 & ils prennent
la qualité d’ordinaires de Vacadémie royale de
mufique. Les exécutans dans l’orcheftre & dans les
choeurs prennent aufli la même qualité. ( Voyez
Opéra & Orcheflre. )
En conformité des lettres-patentes du 28 juin
1669,.par lefquelles Pacadémie royale de mufique
a été créée, & dès nouvelles lettres données le mois
de mars 1671 , les chanteurs chànteufes de l’o-
[ péra ne dérogent point : lorfqu’iîs font a extraéiion
noble , iis continuent à jouir des privileges &
de tous les droits de la noblefle (_affez inutile
aujourd’hui ).
Les chanteurs & les chànteufes qui exécutent des
concerts chez le Roi & chez la Reine font appelles
ordinaires de la mufique de la chambre du Roi. Lcrft-
que Louis XIV donnoit dès fêtes fur Feau , il difoir,
avant qu’on commençât le concert : je permets à mes
muficiens de fe couvrir, mais feulement à ceux qui
.chantent.
Il y a à la chapelle du Roi plufieurs cafirati
qu’on tire de bonne heure des écoles d’ Italie ,
& qui chantent dans les motets les parties de deffus.
Louis XIV avoit des bontés particulières pour
eux ; il leur permettoît la chaffe dans fes capitaineries,
& leur partait quelquefois avec humanité.
Ce grand roi prenoit plaifir à confoler ces
malheureux de la barbarie de leurs pères. (V o y e z
Cafirati, Chant, Chantre, Exécution , Opéra. )
{( Cakufac. )
CHANTRE, ƒ m. Ceux qui chantent au choeur
dans les églifes catholiques s’appellent- chantres.
On ne dit point chanteur à l’égllfe, ni- chantre dans
un concert.
Chez lès réformés on appelle chantre^ celui qui
entonne & foutient le chant des pfeaumes dans le
temple ; il eft affis au - deffons de la chaire dir
miniftre fur le devant. Sa fomftion exige une voix
très-forte’, capable de dominer fur celle de tout le
peuple, & de fe faire entendre jufqu’aux extrémités
du temple. Quoiqu’il n’y ait ni profodie ni mefure
' dans notre maniéré de chanter les pfeaumes, &