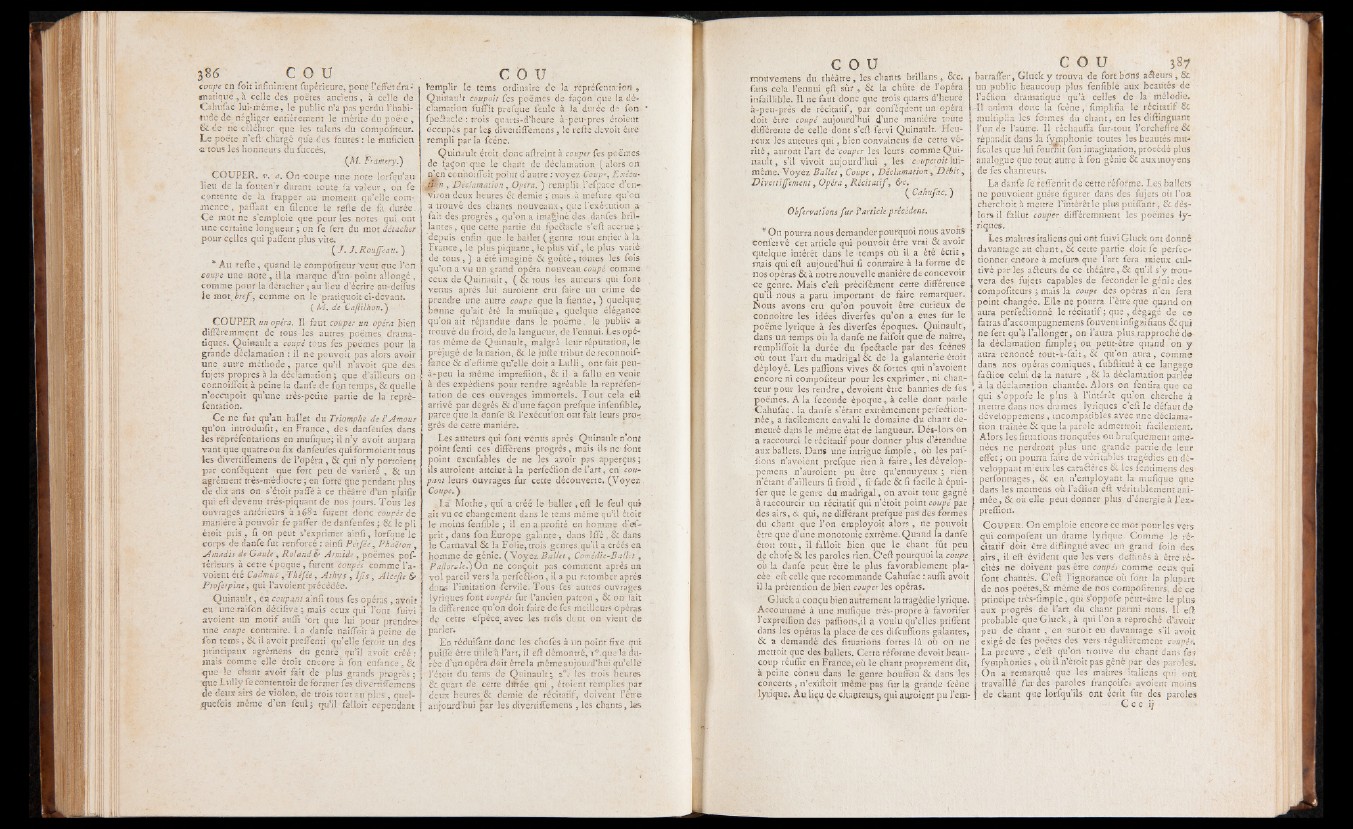
386 C O U
coupe en foit infiniment fupérieure, pour l’effet dramatique
, a celle cîes poètes anciens, à celle de
Cahufac lui-même, le public n’a pas perdu l’habitude
de négliger entièrement le mérite du poète ,
& de ne célébrer que les taie ns du compofiteur.
Le poète n’efl chargé que des fautes: le muficien
<a tous les honneurs dufuccés.
{M. Framzry.')
COUPER, v. a. On -coupe une noje lorfqu’au
lieu de la foutenr durant toute fa valeur , on fe |
contente de la frapper au moment qu’elle com-,
rnence, paffant en filence le refie de fa durée..
C e mot ne s’emploie que pour les notes qui ont
une certaine longueur ; on fe fert du mot détacher.
pour celles qui paffent plus vite.
( J. J. Rouffe.au. )
* Au refie, quand le compofiteur veut que l’on
coupe une note , ilia marque d’un- point allongé ,
comme pour la détacher ; au lieu d’écrire au-defïùs
le mot. b r e f , comme on le pratiquoit ci-devant.
( M. de Caflïlhon.')
COUPER un opéra. Il faut couper un opéra bien
différemment de tous les autres poèmes dramatiques.
Quinault a coupé tous fes poèmes pour la
grande déclamation : il ne pouvoit pas alors avoir
une autre méthode, parce qu’il n’avoit que des.
fujets propres à la déclamation ; que d’ailleurs on J
connoiffoit à peine la danfe .de fon temps, & quelle
n’ocCupoit qu’une très-petite partie de la repré-
fentation.
C e ne fut qu’au ballet du Triomphe de VAmour
qu’on introduifit, en France, des danfeufes dans
les rèpréfentations en mufiaue; il n’y avoit aupara
vant que quatre ou Ex danfeufes quiformoient tous
les divertiffemens de l’opéra , 8c qui n’y portoient
par conféqùént què fort peu de variété , & un
agrément très-médiocre ; en forte que pendant plus
de dix ans on s’étoit paffé à ce théâtre d’un plaifir
qui efl devenu très-piquant de nos jours. Tous les
ouvrages antérieurs à 1682 furent donc coupés de
manière à pouvoir fe paffer de danfeufes ; & le pli
étoit pris , fi on peut s’exprimer ainfi, lorfque le
corps de danfe fut renforcé : ainfi P et fé e , Phaèton ,
Amadis de Gaule , Roland & Armide , poèmes pof-
térieurs à cetre époque-, furent coupes comme l’a-
voient été Cadmus , Théfée -, Athys , I f s , Aies fie &
Proferpine, qui Pavoient précédée.
Quinault, es coupant ainfi tous fes opéras , avoit
eu une raifon dêcifive ; mais' ceux qui l’ont fuivi :
avoient un motif auffi fort que lui pour prendre»
une coupe contraire. La danfe naiffoir à peine de
fon terns, & il avoit prefienti qu’elle ferait un des
principaux agrémens du genre qu’il avoit crée:
mais comme elle étoit encore â fon enfance , &
que le chant avoit fait de plus grands progrès;
que Lully fe contentoit de former fes divertiffemens
de deux airs de violon, de trois tour au plus , quelquefois
même d’un feul; qu’il falloir cependant
c o u
Remplir le .teins ordinaire de la repréfentaiiou ,
Quinault çoupoït fes poèmes de façon que la déclamation
fuffît prefque feule à la durée de fora
fpeélacle : trois quarts-d’heure à-peu-pres étoient
occupés par les divertiffemens, le refte devoir être
rempli par la fcène.
Quinault étoit donc aflrelnt à couper fes poèmes
de façon-que le chant de déclamation (alors en
n!en connoiffoit point d’autre : voyez Coup?, E x é c u -
tifn , Déclamation, Opéra. ) remplît l’efpace d’environ
deux heures .& demie ;'mais à mefure qu’on
a trouvé des chants nouveaux , que l’exécution a
fait des progrès , qu’on a imaginé des danfes brillantes
, que cette partie du fpeélacle s’efl accrue y
depuis enfin que le ballet ( genre tout entier à la
France, le plus piquant , 1e plus v if , le plus varié
de tous , ) a été imaginé 8t goûté, toutes les fois
qu’on a vu un grand opéra nouveau coupé comme
ceux de Quinault, ( 8c tous les aureurs qui font
venus après lui auroient cru faire un crime de
prendre une autre coupe que la fienne, ) quelque
bonne qu’ait été la mufîque, quelque élégance
qu’on ait répandue dans le poème, le public a
trouvé du froid, de la langueur, de l’ennui. Les opéras
même de Quinault, malgré leur réputation, le
préjugé de la nation, & le jufle tribut de reconnoif-
fance & d’eftime qu’elle doit à L u lli, ont fait peu-
à-peu la même impreffion, & il a fallu en venir
à des expédiens pour rendre agréable la repréfen-
tation de ces ouvrages immortels. Tout cela eâs
arrivé par degrés & d’une façon prefque infenfible,,
parce que la danfe 8c l’exécution ont Fait leurs progrès
de cette manière* .
Les auteurs qui font venus après Quinault n’ont
point fenti ces différens progrès , mais ils ne font
point excufables de ne les avoir pas apperçus ;
ils auroient atteint à la perfeâion de l’art, en coupant
leurs ouvrages fur cette découverte. (Voyez
Coupe*)
T a “ Mothe,- qui a créé le ballet, efl le feul qui
ait vu ce changement dans le tems même qu’il étoit
le moins fenfible ; il en a profité en homme d’esprit
, dans fon Europe galante-, dans Iffé . 8c dans
le Carnaval & la Folie, trois genres qu’il a créés en
homme de génie. (V o y e z B a lle t y C om éd ie -B a lle t,
P a flore le.') On ne conçoit pas comment après un
vol pareil vers la perfeérion, il a pu retomber après
dans- Limitation ferviie. Tous fes autres ouvrages
lyriques font coupés fur Pâncien.-patron& on fait
la différence qu’on doit faire de fes meilleurs opéras
de cette efpècet avec les trois dont on vient de
parler.
En réduifant donc les choies à un point fixe qui
puifie être uriie'à Part, il éfl démontré, i°.que la durée
d’un opéra doit êtrela même aujourd’hui qu’elle
PétOit du tems de Quinault; 20. les trois heures
& quart de cetre durée qui , étoient remplies par
deux heures & demie de récitatif, doivent l’être
aujourd'hui par les divertiffemens , les chants, les
g o u
mouvemens du théâtre, les chants brillans, &c.
fans cela l’ennui efl sûr , 8c la chute de l’opéra
infaillible. Il ne faut donc que trois quarts d’heuré
à-peu-près de récitatif, par conféquent un opéra
doit être coupé aujourd’hui d’une manière toute
différente de celle dont s’eff feryi Quinault. Heureux
les auteurs q u i, bien convaincus de cetre vérité,
auront Part dQ'couper les leurs comme Quinault,
s’il vivoit aujourd’hui ,; les c;uperoït lui-
même. Voyez Ballet, Coupe, Déclamation, Débit,
Diverti (fement, Opéra, Récitatif, &c.
( Cahufac. )
Obfervatîons fur Carticle précédent.
* On pourra nous demander pourquoi nous avons
fconfeivé cet article qui pouvoit être vrai & avoir
quelque intérêt dans le temps où il a été écrit,
mais qui efl: aujourd’hui fi contraire à la forme de
nos opéras & à notre nouvelle manière de concevoir
ce genre. Mais c’efl précifément cette différence
qu’il nous a paru important de faire remarquer.
Nous avons cru qu’on pouvoit être curieux de
connoître les idées diverfes qu’on a eues fur le
poème lyrique à fes diverfes époques. Quinault,
dans un temps où la danfe ne faifoit que de naître,
rempliffoit la durée du fpeélacle par des fcènes
où tout Part du madrigal & de la galanterie étoit
déployé. Les pallions vives & fortes qui n’avoient
encore ni compofiteur pour les exprimer, ni chanteur
pour les rendre, dévoient être bannies de fes
poèmes. A la fécondé époque , à celle dont parle
-Cahufac-, la danfe s’étant extrêmement perfedion-
née, a facilement envahi le domaine du chant demeuré
dans le même état de langueur. Dès-lors on
a raccourci le récitatif pour donner plus d’étendue
aux ballets. Dans une intrigue fimple , où les paf-
. fions n’avoient prefquè rien à faire, les dévelop-
pemens n’auraient pu être qu’ennuyeux ; rien
n’étant d’ailleurs fi froid', frfade 8c fi facile à épui-
fer que le genre du madrigal, on avoit tout gagné
à raccourcir un récitatif qui n’étoit point coupé par
des airs, & qui, ne différant prefque paS des formes
du chant que l’on emploÿoit alors , ne pouvoit
être que d’une monotonie extrême. Quand la danfe
étoit tout, il falloit bien que le chant fût peu
de chofeSc les paroles rien..C’efl pourquoi la coupe
où la danfe peut être le plus favorablement placée
efl celle que recommande Cahufac : auffi avoit
il la prétention de bien couper les opéras.
Gluck a conçu bien autrement la tragédie lyrique.
Accoutumé à une müfique très-propre à favorifer
Pexpreffion des paffions,il a voulu qu’elles priffent
dans les opéras 1^ place de ces difeuffions galantes,
& a demandé dès fituations fortes là où on 11e
mettoit que des ballets. Cette réforme devoit beaucoup
réuffir en France, où le chant proprement dit,
à peine connu dans le genre bouffon & dans les
concerts , n’exiffoit même pas fur la grande fcène
lytique. Au lieu de cliaeteufs, qui auroient pu l’eni-
C O U 387
barraffer, Gluck y trouva de fort bônâ a&eurs, 8c
un public beaucoup plus fenfiblè aux beautés de
l’aâion dramatique qu’à celles de la mélodie.
-Il anima donc la fcène, fimplifia le récitatif 8c
multiplia les formes du chant , en les diftinguant
l’un de l’autre. Il réchauffa fur-tout l’orchëfire Sc
répandit dans la fympîionie toutes les beautés mu*
ficales que lui fournit fon imagination, procédé plus
analogue que tout autre à fon génie 8c aux moyens
de fes chanteurs.
La danfe fe reffentit de cette réforme. Les ballets
ne pouvoient guère figurer dans des fujets où I’oa
chercboit à mettre l’intérêt le plus puiffant, 8c dès-
lors il fallut couper différemment les poèmes ly riques.
Les maîtres italiens qui ont fuivi Gluck ont donné
davantage ait chant, 8c cette partie doit fe perfectionner
encore à mefure que Part fera mieux cultivé
par les aéteurs de ce théâtre, 8c qu’il s’y trouvera
des fujets capables de féconder le génie des
compofiteurs ; mais la coupe des opéras n’en fera
point changée. Elle ne pourra l’être que quand on
aura perfectionné le récitatif ; que , dégagé de c©
fatras d’accompagnemens fouvent infigaifians 8c qui
Ine fert qu’à l’allonger, on l’aura p 1 usj approché d©
la déclamation fimple; ou peut-être quand on y
aura-renoncé tout-à-fait, 8c qu’on aura, comme
dans nos opéras comiques , fubftitué à ce langage
- faétice celui de la nature , 8c la déclamation parlee
à la déclamation chantée. Alors on fentira.que ce
qui s’oppofe le plus à l’intérêt qu’on cherche à
mettre dans nos drames lyriques c’efi le défaut de
développeniens , incompatibles avec une déclamation
traînée 8c que la parole-admettrait facilement.
Alors les fituations tronquées ou brufquemenr amenées
ne perdront plus une grande partie de leur
effet ; on pourra faire de véritables tragédies en développant
mieux les caractères 8c les fenrimens des
perfonnages, 8c en n’employant la mufique que
dans les momens où Paélien efl véritablement animée
, 8c où elle peut donner plus d’énergie à f ’ex-
preffion.
C o u p e r . On emploie encore ce mot pour les vers
qui compofent un drame lyrique Comme le récitatif
doit être diffingué avec un grand foin des
airs, il efl évident que les vers deffinés à être récités
ne doivent pas être coupés comme ceux qui
font chantés. C ’efl l’ignorance où font la plupart
de nos poètes,8c même de nos compofiteurs, de ce
principe très-fimple, qui s’oppofe peut-être le plus
•aux progrès de Part du chant parmi nous. Il efl
probable que Gluck , à qui l’on a reproché d’avoir
peu de chant , en -aurait eu davantage s ïl avoit
exigé-de fes poètes des vers régulièrement coupér.
La preuve , c’efl qu’on trouve du chant dans fes
fymphonies , où il n’étoit pas gêné par des paroles.
On a remarqué que les maîtres italiens qui ont
travaillé fur des paroles françoifes avoient moins
de chant que lorfcju ils ont écrit fur des paroles